Un aperçu de toutes les chartes


Numéro 1
Adolf Ier (d'Altena), archevêque de Cologne, déclare que Gozewijn IV, seigneur de Valkenburg, avec le consentement de sa femme, Dame Jutta, a donné au monastère de Sainte Marie à Heinsberg et à l'hermitage de Saint Gerlach, sa ferme à Munstergeleen avec tous les serfs, revenus et dépendances et la moitié du droit de patronage. Il a fait cela pour compenser la croisade à Jérusalem qu'il avait promise mais non réalisée. Adolf Ier libère à son tour Gozewijn IV de sa promesse et l'indemnise de toute sanction future pour l'avoir rompue.
Adolf Ier (d'Altena), archevêque de Cologne, déclare que Gozewijn IV, seigneur de Valkenburg, en compensation de sa croisade inachevée, avec le consentement de sa femme, Dame Jutta, a donné sa ferme à Munstergeleen avec tous les serfs, revenus et dépendances et la moitié du droit de patronage lié à cette femme, au monastère de Sainte-Marie à Heinsberg et à l'hermitage de Saint Gerlach.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives du couvent Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 74, reg. n° 1. Doublé. Endommagé avec perte de texte. Selon b, en 1869, l'original était encore en possession de Ch. Guillon, notaire à Roermond.
Notes au revers : 1° par une main du 14e/15e siècle : De bonis [...]b[...]ock prope Monstergeleen. - 2° par la main du dernier quart du XIVe siècle : B j. - 3o par la main du XVIIe siècle : 1202. - 4o de la main du 18e siècle : Num. 69.
Scellement : deux sceaux apposés à la fin, qui ont été annoncés, à savoir : S1 d'Adolf Ier (d'Altena), archevêque de Cologne, en cire brune, endommagé. - S2 de Gozewijn IV, seigneur de Valkenburg, en cire brune, endommagé ; et un emplacement d'attache pour le sceau annoncé de Jutta, épouse de Gozewijn IV, seigneur de Valkenburg (LS3). Pour une description et une image de S1 et S2, voir Venner, 'Seals convent Sint-Gerlach', respectivement 150 et 156.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, accès n° 14.D003, archives couvent Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 1 (cartulaire) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 113-115, sous la rubrique : Littera confirmationis domini Adulphi, archiepiscopi Coloniensis, de bonis in Munsterglene, et en marge : Num. 69, avec spécification de trois lieux de scellement, d'après A.
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 1-3, no. 1, d'après A. - b. Habets, 'Houthem-Sint-Gerlach', 203-206, no. 3 (daté 1202), d'après B.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 67, reg. nr. 1. - Idem, Liste chronologique, 34, reg. nr. 51. - REK, II, 331-332, n° 1620.
Dates
L'utilisation du style de Noël est supposée, conformément à l'utilisation par l'archevêque de Cologne à cette période, voir Polak et Dijkhof, Livre des chartes Kloosterrade, XVI. Dans ce cadre, le terminus antequem est en outre déterminé par la cinquième indiction donnée, qui a duré jusqu'au 23 septembre. Dans la ligne de date, un concurrent erroné est donné, on s'attend au chiffre 1.


Numéro 1
Le roi romain Otto Ier accorde à son vassal Ansfried les droits de monnayage et de marché de Kessel, situé dans le district Maasland. Désormais, Ansfried peut également percevoir le péage d'Echt à Kessel. La concession est faite par l'intervention du duc Coenraad.
<Rooms-koning Otto I schenkt aan zijn leenman Ansfried de munt- en marktrechten te Kessel en bepaalt dat de tol van Echt naar Kessel wordt verplaatst.>
original trompeur
<A>. Maastricht, HCL, toegangsnr. 01.187A, archief Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. nr. 1.
Edition
a. Gysseling en Koch, Diplomata Belgica, 369-370, nr. 219, naar <A>.
Inauthenticité
La présente charte est considérée comme un falsum pour des raisons paléographiques, voir l'édition de Gysseling.
Localisation
Pour l'identification de Casallum avec Kessel, nous suivons l'édition de Gysseling et Koch, ainsi que Gysseling, Toponymic Dictionary, 560, et Van Berkel et Samplonius, Dutch place names, 117. Les lieux proposés par d'autres auteurs comme Kesselt, Neeroeteren et Kessenich (voir entre autres Kluge, Deutsche Münzgeschichte, 27-36, et Baerten, 'Les Ansfrid', 1145) nous semblent peu probables d'un point de vue linguistique et onomastique.
Dates
Dans la datatio, la date indiquée est l'année d'incarnation 966, avec les éléments de datation associés. Conformément à l'édition de Sickel, Monumenta Germaniae DO I 210, n° 129, la charte falsifiée dans l'édition de Gysseling et Koch est datée de l'année 950.


Numéro 1
Adelbert de Saffenberg et son fils Adolf font don à l'abbaye de Kloosterrade de possessions dans la terre de Rode, dont cinq fermes à Rode, des dîmes levées là et à la ferme de Spekholz, des possessions entre autres à Ahrweiler venant d'Embrico et de son père, deux fermes à Crombach données par le comte palatin Siegfried, et le domaine de Koenraad à Morsbach, à l'exception de la gestion, par laquelle eux et l'évêque Otbert de Liège accordent aux frères le droit d'élire un supérieur, de baptiser les enfants des libres, de les admettre à la communion et de les enterrer.
Adelbert de Saffenberg et son fils Adolf dotent l'abbaye de Kloosterrade, sous réserve de la gestion, de possessions dans la terre de Rode, dont cinq fermes à Rode, des dîmes à Rode et à la ferme de Spekholz, des possessions entre autres à Ahrweiler provenant d'Embrico et de son père, deux fermes à Crombach données par le palatin Siegfried et le domaine de Koenraad à Morsbach, à l'abbaye de Kloosterrade par laquelle eux et l'évêque Otbert de Liège accordent aux frères le droit d'élire un supérieur, de baptiser les enfants des libres, de les admettre à la communion et de les enterrer.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 673.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 1-9, n° 1, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 1
(Le roi Henri IV confirme la donation par Otto, margrave de Thuringe, et son épouse Aleid de leurs biens à Weert et Dilsen au chapitre de Saint-Servaas à Maastricht en échange de trois cents livres d'argent et de l'usufruit d'Oijen, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk et Hees..
(Le roi Henri IV confirme la cession par Otto, margrave de Thuringe, et son épouse Aleid de leurs biens à Weert et Dilsen au chapitre de Saint-Servaas à Maastricht en échange de trois cents livres d'argent et de l'usufruit d'Oijen, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk et Hees..
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 883.
Sceau : un point d'attache pour le sceau imprimé annoncé d'Henri IV, avec des restes de cire blanche, n'est pas disponible (SD1).
Copies
B. 1282 6 avril, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives Chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 884, charte du roi romain Rodolphe Ier, d'après A, voir Collection du Chapitre de Saint-Servace, n° 46. - C. fin du XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 5v-6r (= nouveau fol. 22v-23r), n° 8, à A. - D. fin du XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 18r-18v (= nouveau fol. 35r-35v), n° 40, à A. - E. fin du XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 18r-18v (= nouveau fol. 35r-35v), n° 40, à A. 40, à B. - E. 1640, Ibidem, idem, inv. no. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 13-14, sous le titre : 9, Henricus quartus Romanorum rex confirmat donationem factam per marchionem Ottonem (ci-après quoad barré) de Thuringia quoad Werdt, à A. - F. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, p. 87, sous le titre : " Henricus quartus Romanorum rex confirmat donationem factam per marchionem Ottonem (ci-après quoad barré) de Thuringia quoad Werdt, à A. - F. avant 1768" : Henricus quartus, Romanorum rex, confirmat donationem factam per marchionem Ottonem de Thuringia quoad Weerdt, die 11ma calendas octobris anno 1062, copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier municipal de Maastricht, à [C].
Dépenses
a. Posse, Codex Diplomaticus, 320-321, n° 120, à D. - b. Gladiss et Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, 118-120, n° 91, d'après A. - c. Gysseling et Koch, Diplomata Belgica I, 383-384, n° 230, d'après A. - d. Hackeng, The Medieval Land Property, 279-280, n° 39a (incomplet), d'après b et l'argument de Deeters, Servatiusstift, 51-52. - f. DiBe ID 3906, à c.
Références
Voir DiBe ID 3906.
Authenticité et genèse
L'authenticité de la présente charte est mise en doute depuis la fin du XIXe siècle. Giesebrecht, Geschichte, 1100-1101, fut le premier à s'exprimer à ce sujet, en se basant sur ce qu'il considérait comme la présence douteuse en Allemagne de "Godefridi, marchionis", ainsi que sur la mention du margrave de Thuringe et du comte de Bruxelles. Il n'a cependant effectué aucune recherche paléographique ou diplomatique. Posse, Codex Diplomaticus, 80, mentionne les objections de Giesebrecht à l'égard de cette charte, mais son édition n'inclut pas le document en tant que falsum.
Niermeyer, Onderzoekingen, 172-179, a été le premier à soumettre la charte de 1062 à un examen approfondi dans le cadre de son étude des chartes de Liège et de Maastricht. Il a établi, sur la base de critères paléographiques, que la présente charte ne devait pas avoir été produite au XIe siècle, mais au milieu du XIIe siècle, et il a attribué le faux à un scripteur nommé Hand S. Selon lui, cette personne a également rédigé le contexte de la fausse charte d'Henri V de 1109 pour le chapitre de Saint-Servaas à Maastricht (voir Collection de Saint-Servaas, n° 3). Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, 118-119, partage ces observations. Selon lui, la charte actuelle de 1062 est basée sur une charte insoupçonnée rédigée par le chancelier Fredericus B (pour ses activités en tant qu'un des notarii de la chancellerie du roi romain Henri IV, voir Gladiss et Gawlik, o.c., XXIX-XXXI).
Niermeyer n'était pas seulement convaincu que les chartes de 1062 et 1109, qu'il croyait fausses, avaient été écrites par une seule et même main ̶ dans laquelle Gladiss l'avait suivi ̶ , il considérait également ce scripteur comme responsable d'une ligne interpolée dans une charte du roi romain Charles III pour le chapitre de Saint Servatius de 1146 (original conservé à Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/9 ; pour une édition, voir Camps, ONB I, 71-73, n° 46). Selon Niermeyer, o.c., 177, la charte de Koenraad III de 1146 - à l'exception de la ligne interpolée -, aurait été rédigée par le scripteur du chancelier royal Arnold A. Cela nous semble toutefois peu probable, puisque son travail de chancelier, selon Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, XXII, se situe d'avril 1138 à l'été 1140. En outre, Hausmann n'identifie pas le scripteur du texte de la charte avec Arnold A, mais avec le chapelain Heribert, qui a travaillé à la chancellerie royale de 1140 à 1146 et en 1151. Selon Hausmann, o.c., 268, n° 147, le faussaire a tenté d'imiter l'écriture d'Heribert dans cette ligne interpolée (pour un aperçu des chartes produites par Heribert, son identification et son travail pour la chancellerie royale, voir Hausmann, o.c., 258-273).
En se basant sur l'observation que l'interpolation dans la charte de 1146 a été écrite par le scripteur qui aurait également mis en sourdine les chartes du chapitre de Saint-Servaas de 1062 et 1109, Niermeyer conclut que ces deux falsa ont été produites après 1146 et vraisemblablement après la mort du roi romain Cunraad III en 1152. Comme terminus ante quem possible, il mentionne environ 1174, l'année où il a trouvé cette main d'écriture encore dans une charte de l'empereur Frédéric Ier (Niermeyer, o.c., 176, note 3). Enfin, il date les deux falsa plus précisément vers 1160, sans plus de précision. Gladiss soutient que les falsa de 1062 et 1109 auraient été produites vers le milieu du XIIe siècle dans le cadre de discussions prolongées entre le prévôt et les chanoines du chapitre de Saint-Servace.
Gysseling et Koch, Diplomata Belgica I, 383-384, no. 230, considèrent également la présente charte de 1062 comme un falsum produit à Maastricht sans autre justification. Ils ne peuvent cependant pas se rallier, pour des raisons paléographiques, à l'argument de Niermeyer, qui date la fabrication d'environ 1160, et postulent que la scriptio doit se situer à la fin du XIe siècle.
Selon Niermeyer, o.c., 175-177, la dictée de la présente charte est tirée de chartes non suspectes de Fredericus B, chancelier du roi romain Henri IV. Mais il identifie un certain nombre de dispositions de la dispositio qu'il juge suspectes : 1. où il est dit que Weert et Dilsen ne seront pas subordonnés au prévôt, mais que le doyen, avec l'avis des frères, les confiera à un frère qu'il désire et trouve convenable ; 2. où Oijen, Mechelen-to-the-Maas, Meeswijk et Hees appartiennent "ad fratrum prebendam" ; 3. où personne ne peut prétendre à la tutelle, sauf celui choisi par les frères ; 4. la sanctio avec l'amende élevée. Ces passages, sur le fond, amènent Niermeyer à 1128/1130 comme terminus a quo pour la genèse de la charte de 1062, car les litiges entre le prévôt de Saint-Servace d'une part et le doyen et les frères d'autre part apparaissent pour la première fois dans une charte datée du 13 juin 1128 (original conservé à Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/5 ; pour une édition, voir Ottenthal et Hirsch, Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza, 14-15, no. 12), ainsi que parce qu'une charte de donation de 1130 contient une clause dirigée contre le prévôt (copie conservée à Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 10180, fol. 171r ; pour une édition partielle, voir Hackeng, The medieval landed property, 288-289, no. 59).
Gladiss est d'accord avec Niermeyer en ce qui concerne les refus de dicter les chartes du chancelier Fredericus B ainsi que les passages suspects.
Deeters, Servatius Stift, considère également que la présente charte est un falsum et suit Niermeyer et Gladiss en ce qui concerne l'emprunt de la dictée à une charte authentique du roi romain Henri IV. Il fait référence au rasuur avec l'interpolation dans la charte de 1146 et, sur cette base, considère qu'il est plus probable de prendre 1146 comme point de référence pour l'époque de la falsification de la charte de 1062, plutôt que la fin du 11ème siècle comme le suggèrent Gysseling et Koch. Comme terminus ante quem, il suggère environ 1165, en se basant sur l'utilisation de la formule pénitentielle entièrement similaire dans une charte du roi romain Cunraad III de 1146 pour le chapitre de Saint Servaas (original conservé à Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/10 ; pour une édition, voir Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, 508-510, no. 293). Cette charte de 1146 est un falsum qui, selon Hausmann, a été publié vers 1165 par un scripteur liégeois. Deeters suit Niermeyer en ce qui concerne les passages suspects, mais indique également que le contenu essentiel trouve une confirmation dans une source narrative de la fin du XIe siècle. En effet, le transfert d'Otto, margrave de Thuringe, et de son épouse au chapitre de Saint-Servatien est mentionné par Jocundus dans sa vita de Saint-Servatien, rédigée entre 1070 et 1087 environ (voir l'édition de Köpke, "Iocundi translatio s. Servatii", 117, caput 63). Il considère cependant trois passages en particulier comme des insertions falsifiées : l'élimination du prévôt ("hac conditione ... committat"), le libre choix des tuteurs par les frères ("et ne quis advocatiam ... eligerent") et l'amende exceptionnellement élevée ("si quis huic traditioni ... potestati").
En ce qui concerne le sceau imprimé, Niermeyer, o.c., 174, indique qu'une charte du roi Henri IV datée du 14 octobre 1062 a servi d'exemple à l'abbaye de Verdun (original conservé à Reims, Archives municipales et communautaires de Reims, Collection P. Tarbé, Carton I, n° 21 ; pour une édition, voir Gladiss et Gawlik, o.c., 120-121, n° 92). Selon lui, cette charte aurait été éditée et rédigée par Fredericus D, qui travaillait à la chancellerie royale dans les années 1062-1065. Ce chancelier est le Fredericus B mentionné par Gladiss, qui le considère comme responsable de la dictée de la charte pour l'abbaye de Verdun, mais qui n'est pas sûr de la scriptio, qui pourrait également avoir été fournie par un ingrossator inconnu.
En résumé, des soupçons ont été émis à l'égard de la présente charte, tant en raison de son apparence que de son contenu. Selon Gysseling et Koch, Niermeyer, Gladiss et Deeters, la date d'origine de ce falsum se situe entre la fin du XIe siècle et le milieu du XIIe siècle, avec un terminus ante quem vers 1174.
Nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions de Niermeyer concernant l'identification des mains. Les recherches paléographiques ont montré qu'il n'y a pas de similitude entre les chartes de 1062 et de 1109, comme il l'a soutenu et comme l'a fait Gladiss. Si les écritures de 1062 et 1109 présentent une forte affinité scribale, elles ne sont pas identiques. Selon Niermeyer, ce scribe S, qui aurait écrit à la fois la présente charte et le falsum de 1109, ainsi que la règle interpolée sur le rasur dans une charte de 1146, a été actif jusqu'en 1174. La similitude de la présente charte avec la règle interpolée dans la charte de 1146 ne peut être suivie, à notre avis, car il est impossible de l'établir sur la base d'une seule règle. Par conséquent, le terminus ante quem formulé par Niermeyer, sur la base des identifications susmentionnées et des activités supposées de ce scripteur S jusqu'en 1174 environ, n'est pas défendable. Cela invalide également le point de référence de 1146 proposé par Deeters pour la date de genèse de la présente charte.
La date d'origine de la présente charte, que Gysseling et Koch datent de la fin du XIe siècle, ne peut être ni confirmée ni infirmée. Le manuscrit minuscule typiquement diplomatique peut dater aussi bien de 1062 que de la fin du XIe siècle. Par conséquent, on ne peut pas exclure a priori la possibilité d'un mundering en 1062.
Le fait que l'écriture de la charte de 1062 n'apparaisse pas dans les chartes du roi romain et de l'empereur Henri IV n'est pas un argument en faveur de la spoliation. La raison en est que la possibilité d'une destinatarisation est perdue de vue. C'est surtout sous les rois Henri IV, Henri V et Lothar que le nombre de destinations a augmenté, voir Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 462. Le nombre considérable de chartes royales d'Henri IV qui n'ont pas été délivrées par sa chancellerie entre le 9 mars 1062 et le 2 octobre 1064 (voir Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, nos 83, 84, 88, 89, 132 et 136, datées du 9 mars 1062, du 13 mars 1062, du 13 juillet 1062, du 19 juillet 1062, du 19 juillet 1064 et du 2 octobre 1064) montre qu'il faut tenir compte de cette réalité. Un hybride intéressant a d'ailleurs été trouvé dans une charte du roi romain Henri IV datée du 10[6]2 octobre 14, qui a été éditée par le destinataris et où seul l'eschatocol a été ajouté par le chancelier Frédéric B (voir Gladiss, o.c., n° 92). Une scriptio du destinataris, le chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, s'inscrit également dans cette époque, juste après le coup d'État de Kaiserswerth en avril 1062, qui a entraîné des changements de personnel inhabituellement rapides et profonds dans la chancellerie royale (voir Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches, 287-288 ; Gladiss, o.c., XXIX-XXX).
Non seulement nous ne sommes pas d'accord avec les identifications paléographiques de Niermeyer, mais nous avons également des doutes quant à son analyse des dictées. Pour la redactio du falsum, le chapitre de Saint-Servaas aurait utilisé des chartes de 1063, rédigées par le chancelier Fredericus B (pour une édition des chartes en question, voir Gladiss, o.c., nos 100, 106 et 117). Non seulement la sélection de ces chartes peut être remise en question (la n° 100 n'a pas été éditée par Fredericus B), mais l'appartenance au diktat peut également être soulignée. Niermeyer puise au hasard dans ces chartes et dans d'autres et identifie des sections de texte qui devraient prouver l'emprunt à la dictée de Fredericus B, mais c'est le contraire qui se produit. Non seulement il y a des divergences significatives, mais des emprunts et des constructions de texte très frappants apparaissent déjà dans des chartes plus anciennes du roi Henri IV éditées par la chancellerie (Gladiss, o.c, n° 3, 21, 47, 50 et 73, datées du 29 décembre 1056, du 28 mai 1057, du 5 février 1059, du 4 mars 1059 et du 7 août 1061) ainsi que dans des chartes de destinatarisation (Gladiss, o.c., n° 60 et 101, datées du 22 novembre 1059 et du 14 juin 1063). Il n'y a donc aucune preuve tangible d'un emprunt de dictée aux chartes royales de 1063, éditées par Fredericus B, alors qu'une comparaison plus poussée des dictées montre en outre la possibilité d'un emprunt à des chartes royales plus anciennes. Il est donc évident que le texte de la charte a été édité par le chapitre de St Servaas, peut-être même sur la base d'une charte royale plus ancienne. Un éventuel lapsus, en mentionnant "ad usum confratrum" au lieu de l'habituel "ad usus fratrum", semble aller implicitement dans ce sens. Par ailleurs, le texte de la charte est parfaitement adapté à la constellation politique après le coup d'État de Kaiserswerth au début du mois d'avril 1062, au cours duquel la régence sur l'enfant Henri a été retirée à sa mère Agnès et transférée à Anno, archevêque de Cologne. La mention "ob interventum ac petitionem dilecte genitricis nostre Agnetis imperatricis auguste", habituelle dans les chartes d'Henri IV avant avril 1062, n'apparaît donc pas dans la présente charte.
Après les découvertes paléographiques qui ont conduit Niermeyer à une date extrême d'origine du falsum vers 1174, il a cherché des arguments de fond pour réfuter ce qu'il considérait comme des passages suspects concernant la position du prévôt. Il a notamment invoqué des chartes de 1128/1130 et 1130, dans lesquelles des conflits entre le prévôt et le chapitre sont mentionnés pour la première fois et où apparaît une clause dirigée contre le prévôt. Sur la base de ces chartes du XIIe siècle, il a estimé que les dispositions contre le prévôt dans la présente charte étaient impossibles. Le fait qu'aucun autre document n'ait survécu avant 1128/1130 mentionnant des conflits ou l'exclusion du prévôt n'est cependant pas un argument pour qualifier les dispositions de 1062 d'anticipées ou de falsum.
Une charte de 1050 pourrait nous éclairer davantage sur une éventuelle position indépendante du chapitre avant 1062. Dans cette charte, Godefroy II, barbe de Lorraine, transfère l'allodium de Ramioul au chapitre de Saint-Servace "ad usum fratrum ibidem Deo et sancto Servatio famulantium ... eo iure et libertate qua possedi ... et ut nullum advocatum habeant preter advocatum altaris sancti Servatii, scilicet ipsum regem". Cette charte ne peut malheureusement pas jouer un rôle adductif quant à l'authenticité de la présente charte, car elle est considérée comme un falsum du XIIe siècle par le chapitre de Saint-Servatius (original conservé à Liège, Archives de l'État, archives de l'abbaye du Val-Saint-Lambert, n° 2 ; pour une édition ainsi que des références bibliographiques à Roland, Despy, Dierkens et Guilardian, entre autres, voir DiBe 3402). La main de ce falsum, dont la date d'origine oscille entre 1100 et 1200, présente d'ailleurs d'étroites affinités scribales avec la présente charte.
L'amende élevée mentionnée en 1062 ne peut pas non plus être utilisée comme critère d'un falsum pour des raisons d'exceptionnalité. Cette inscription peut tout aussi bien être une première attestation précoce et/ou exceptionnelle. Deeters, suivant les conclusions paléographiques de Niermeyer, s'appuie sur une formule d'amende exactement identique dans une charte falsifiée de 1165 environ du chapitre de St Servaas de 1146, pour la considérer comme un "Vorlage" pour la charte de 1062 et, par conséquent, comme un terminus ante quem. Toutefois, le raisonnement peut également être inversé : étant donné que ce faux a vu le jour vers 1165, la clause de pénitence peut également avoir été tirée de la charte actuelle de 1062.
En conclusion, le transfert de possession lui-même est incontesté dans la dispositio, puisqu'il est confirmé par une source narrative du XIe siècle, et aucune autre justification n'a été trouvée pour les arguments de fond avancés par Niermeyer qui seraient décisifs pour la falsifiabilité de la présente charte. Non seulement la correction des résultats paléographiques de Niermeyer supprime le fondement d'une datation au XIIe siècle, mais une scriptio en 1062 ne peut pas non plus être exclue pour des raisons paléographiques. L'analyse de la dictée conduit également à d'autres conclusions, qui rendent une destinatarisation très probable. Une falsification de la présente charte ne nous semble donc pas prouvée.
Localisation
Selon Driessen, "Silva Ketela", col. 101-106, la silva, Ketela dicta, doit être identifiée avec la forêt de Ketel, la forêt du royaume ou la "forêt royale" de Nimègue. Gysseling et Koch ne situent pas ce lieu (inconnu).


Numéro 2
Reinier, doyen, et le chapitre de Notre-Dame de Maastricht déclarent que Lambert Sutor et sa mère, avec leur consentement, ont vendu des champs situés à Houthem au couvent Sint-Gerlach à Houthem. Ces champs étaient imposables d'accises par le chapitre. La vente a eu lieu par la main de Willem, curé de Houthem et chanoine du chapitre de Notre-Dame.
Reinier, doyen, et le chapitre de Notre-Dame à Maastricht déclarent que Lambert Sutor et sa mère, par la main de leur confrère chanoine Guillaume, curé, ont vendu des champs imposables à Houthem au monastère Sint-Gerlach (à Houthem) avec leur consentement au chapitre.
Original
A. Maastricht, RHCL, numéro d'accès 14.D003, archives Sint-Gerlach couvent de Houthem, inv. n° 38, reg. n° 3.
Notes sur le revers : 1° par une main du XIIIe siècle : Littera terreLambertiSutoris de Houtheim et matris eiusdem en parum valet. - 2° par une main du dernier quart du XIVe siècle : U j. - 3° par une main du XVIIe siècle : 1231.- 4°par une main du XVIIIème siècle : Num. 80.
Sceau : un sceau apposé, suspendu, et annoncé, à savoir : S1 du Chapitre de Notre-Dame à Maastricht, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, " Seals convent Sint-Gerlach", 155.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 126-127, sous le titre : Renuntiatio domini decani et capituli beate Marie in Trajecto super certos census ex bonis in Holtheijm, et en marge : Num. 80, indiquant un point de scellement, à A.
Edition
a. Gerlach, IV, 5-6, no. 3, d'après A.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 68, reg. no. 3. - Idem, Liste chronologique, 39, reg. no. 69.
Dates
On suppose que les évêques de Liège sont passés du style de Noël au style de Pâques vers 1230 et que les institutions religieuses du diocèse ont suivi quelque temps plus tard, voir Camps, ONB I, XXI. Par conséquent, l'utilisation du style de Noël a été supposée pour la datation de cette charte.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 2
Le roi romain Otto III donne à Ansfried la propriété des biens que le comte détenait jusqu'à présent en fief, ainsi que tous les avantages qui y sont liés, notamment les terres, les bâtiments, les eaux et les routes. En outre, Ansfried peut décider de l'utilisation de ces biens. Il s'agit d'une partie du péage, de la monnaie et des accises de Medemblik, ainsi que des biens situés dans le comté de Frise et dans la Basse-Meuse. Otto effectue ce transfert de propriété par l'intermédiaire de sa mère Théophano.
Le roi romain Otton III, par l'intermédiaire de l'impératrice Theofano et l'intervention de l'archevêque de Mayence et des évêques de Worms et de Liège, fait don au comte Ansfried d'une partie des revenus royaux provenant du péage, de la monnaie et des cijns de Medemblik, que ce dernier tenait jusqu'alors en fief de lui, ainsi que des fiefs du roi dans le comté de Frise et dans le pays de la Basse-Meuse.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. n° 2 (très abîmé).
Edition
a. Koch, OHZ I, 100-103, n° 54, d'après A.


Numéro 2
Le pape Calixte II, à la demande de l'abbé Richer et des chanoines de Kloosterrade, confirme la règle de vie de l'abbaye, prend l'abbaye et tous ses biens sous sa protection, fait élire l'abbé et stipule que les dîmes des terres cultivées par l'abbaye appartiennent à l'abbaye.
Le pape Calixte II, à la demande de l'abbé Richer et des chanoines de Kloosterrade, confirme la règle de vie de l'abbaye, prend l'abbaye et tous ses biens sous sa protection, fait élire l'abbé et stipule que les dîmes des terres cultivées par l'abbaye appartiennent à l'abbaye.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 674.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 9-12, n° 2, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 2
L'empereur Henri IV rend impérial le chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, réserve la prévôté au chancelier royal ou impérial et la garde de l'autel de Saint-Servaas à lui-même et à ses successeurs légaux.
L'empereur Henri IV rend impérial le chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, réserve la prévôté au chancelier royal ou impérial et la garde de l'autel de Saint-Servaas à lui-même et à ses successeurs légaux.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 36. Endommagé avec perte de texte.
Sceau : un sceau imprimé, non annoncé, à savoir : S1 de l'empereur Henri IV, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une illustration de S1 et de son attribution problématique, voir Venner, 'Seals', no 41.
Copies
B. 1232 décembre, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives Chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 39, insertion dans une charte de l'empereur Frédéric II, à A. - C. deuxième quart du XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 37, vidimus par le Chapitre de Notre-Dame à Maastricht, à A. - D. 1273 15 octobre, Ibidem, idem, inv. n° 40, vidimus par Maître Baudouin d 'Autre-Église , chanoine du chapitre cathédral de Liège et official de Liège, à B. - E. 40, vidimus de Maître Baudouin d'Autre-Église, chanoine du chapitre cathédral de Liège et official de Liège, à B. - E. 1282 9 avril, Ibidem, idem, inv. n° 42, insertion dans une charte du roi romain Rodolphe Ier, à B. - F. avant 1768, Ibidem, inv. n° 37, vidimus du chapitre Notre-Dame de Maastricht, à A. - D. - F. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, p. 101-103, sous le titre : Diploma Henrici quarti, regis et imperatoris, quo ecclesia Sancti Servatii declarat omnino libera ab omni iurisdictione, solum tantum sub rege et imperatore qui etiam solus habet collationem prepositure et avocatie altaris sancti Servatii in eadem ecclesia, datum Aquisgrani, indictione X 1087, copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier municipal de Maastricht, d'après A.
Dépenses
a. Nelis, "Examen", 13-14 , à A. - b. Muller et Bouman, OSU I, 225, n° 251, à A. - c. Gysseling et Koch, Diplomata Belgica I, 384-386, n° 231, à A. - d. Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-2, 522-523, n° 395, à A. - e. Hackeng, The Medieval Land Property, 311-312, n° 96c (incomplet), à d. - f. DiBe ID 5153, à d.
Références
Voir Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-2, 522, no 395, et DiBe ID 5153.
Authenticité et genèse
La présente charte, non pas pour des raisons de fond mais sur la base de ses caractéristiques extérieures, a été considérée comme un falsum depuis le dix-neuvième siècle. Stumpf-Brentano, Die Reichskanzler, 240-241, no. 2886, affirme que cette charte est un pseudo-original. Selon Waitz, Die Deutsche Reichsverfassung, 356, le proosdij de St Servatius à Maastricht n'appartient qu'au chancelier du royaume "nach einer freilich falschen Urkunde", à savoir cette charte. Selon lui, la concession reposait sur le droit coutumier. Ficker, Vom Reichsfürstenstande, 363, Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 453, et Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches, 159, parlent également d'un pseudo-original, mais n'émettent aucune réserve quant à l'authenticité de son contenu. Ficker rappelle que le chapitre de Saint-Servaas était impérial, comme en témoigne un arrangement conclu par Henri V en 1109 grâce à l'intervention de leur prévôt, le chancelier impérial Adelbert (voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 3).
Nelis, 'Examination', 9, states that 'paléographiquement parlant, le diplȏme a l'aspect des plus bizarres'. Il indique que la ligne du signum et le monogramme ne sont pas écrits par la même main que le reste de la charte. L'espace entre l'avant-dernière ligne du texte de la charte et la ligne du signum est exceptionnellement réduit, ce qui est rare dans les chartes qui sont l'œuvre de la chancellerie impériale. Cet élément, ainsi que le fait que la ligne du signum et le monogramme sont d'une main différente, l'amènent à supposer que la présente charte est une couverture. Ici, le parchemin serait vierge, à l'exception de la ligne signum et du monogramme, délivré par l'empereur Henri IV, après quoi le destinataris, le chapitre de Maastricht de Saint-Servaas, aurait rédigé le texte de la charte. Il signale également l'absence du chrismon. Selon lui, l'invocatio oblongue est l'œuvre d'un notaire inexpérimenté à la chancellerie ou d'un scriptor à l'extérieur. De même, l'écriture bancale de l'invocatio indique un scribe peu familiarisé avec ce type d'écriture, qui ne peut être paléographiquement rattaché aux scriptores des rois et empereurs germaniques. Il date les deux mains d'écriture de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe siècle.
Nelis indique que les mots de fin "G. filius eius cum multis aliis" ne peuvent pas être la fin originale du texte, étant donné la rature qui suit après et en dessous. Son expérience avec une préparation chimique a révélé une autre ligne de texte (illisible) au niveau de la rime. Il suppose que les mots raturés devaient faire partie de la signature oblongue du chancelier et n'a aucun doute sur le fait que celle-ci devait se lire "Hermannus, cancellarius vice Wezelonis, archicancellarii, recognovi". Pour la transcription de "Hermannus", il s'appuie sur l'édition de De Borman, "Notice", 14-15, qui a édité une autre charte de 1087, concernant Echt, d'après un cartulaire de saint Servatius conservé à Paris (Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/2). Or, selon ce cartulaire, l'orthographe est "Herimannus", comme c'est souvent le cas dans les chartes originales d'Henri IV (voir Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-2).
En ce qui concerne le sceau, il identifie un vestige informe qui a été maladroitement restauré et qui ne correspond pas à celui de l'empereur Henri IV en termes de taille. Selon lui, il aurait dû être deux fois plus grand et couvrir une partie du mot "imperatoris" dans la ligne du signum. Il en conclut que le sceau a certainement été apposé après l'écriture de cette ligne.
Gysseling et Koch, Diplomata Belgica I, 384-385, mettent également en doute l'authenticité de la présente charte, mais n'étayent pas leurs doutes. Ils la qualifient de faux simultané possible.
Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-2, 522, considère la charte comme un falsum sur la base de l'écriture et date sa production au début du douzième siècle. Il souligne les plis du parchemin qui étaient déjà présents avant la scriptio et autour desquels l'écriture a été faite, ainsi que l'encre plus claire avec laquelle la ligne du signum et le monogramme ont été appliqués. Toutefois, sans autre argumentation, il ne partage pas l'avis de Nelis selon lequel il s'agirait ici d'une couverture munie d'un sceau authentique et d'une règle de signum appliquée par la chancellerie. Cette possibilité est également rejetée pour des raisons de fond par Deeters, Servatius Stift, 41-42. En ce qui concerne le sceau, Gladiss observe que "das Siegel ist roh gearbeitet und unecht", une observation également reprise par Deeters. La datation précoce du falsum par Gysseling et Koch, rejetée par Gladiss, n'est pas non plus reprise par Deeters. Enfin, Hübinger, "Libertas imperii", 93, date la rédaction du falsum au XIIe siècle.
Selon Nelis, o.c., 14-17, la dictée de la présente charte diffère substantiellement de celles émises par le bureau du chancelier. Cela concerne l'invocatio, l'intitulatio, l'arenga, l'emplacement de la datatio et l'absence de la subscriptio du chancelier. Il a cependant trouvé une affinité de dictée avec la charte de 1087, transmise en copie, dans laquelle Henri IV confirme la restitution de l'église d'Echt au chapitre de Saint-Servaas (conservée à Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin, Manuscrits n° 9307/2 ; pour une édition, voir Gladiss, o.c., 521-522, n° 394).
Gladiss, o.c., 522, identifie également les emprunts de la dictée par le faussaire mentionné par Nelis. Dans son édition de la charte d'Henri IV de 1087 concernant Echt, il affirme que cette Vorlage contient également un certain nombre d'irrégularités, mais il n'y voit aucune raison de la qualifier de falsum. Selon lui, le document a dû être rédigé sans l'intervention de la chancellerie impériale. Quant à la charte actuelle, il suppose que sa création a au mieux consolidé une situation dans laquelle le proosdij de Saint-Servatien était lié à la fonction des chanceliers allemands, le premier étant Adelbert sous Henri V vers 1109.
Deeters, o.c., 41-42, suivant Nelis et Gladiss, identifie la relation de dictée avec la charte de 1087 concernant Echt. Il suggère également que, compte tenu des rasures, le parchemin de la charte d'Echt a pu être utilisé pour la présente charte. On peut toutefois en douter, car les rasures ne concernent pas l'ensemble du texte de la charte, mais seulement des mots accessoires, à l'exception des nombreuses rasures laissées sur et sous la ligne du signum.
Comme d'autres auteurs, Nelis ne doute pas de l'authenticité du contenu. La charte actuelle proclame l'indépendance impériale, établit l'indépendance spirituelle et séculaire du chapitre et exclut les prétentions de gardiens gênants. Tout cela, dit-il, doit être considéré à la lumière des conflits continus et prolongés depuis le milieu du XIe siècle entre le chapitre et diverses parties, notamment avec un riche citoyen de Cologne, un comte palatin, un duc de Brabant, un comte de Namur, un comte de Wassenberg et l'évêque d'Utrecht. Le conflit avec le comte de Wassenberg n'a été réglé que par l'intervention de l'empereur Lothar III en 1128.
La clause relative au proosdij plaide en faveur d'une authenticité substantielle, selon Nelis. L'attribution du proosdij de saint Servatius au chancelier de l'Empire romain, et donc pas au chapitre de saint Servatius lui-même, n'aura pas été initiée de l'intérieur du chapitre. De plus, cette clause ne peut être qualifiée d'anachronique, car le cumul de la chancellerie avec la proosdorship d'autres chapitres était très courant à partir du XIe siècle. L'établissement de l'indépendance vis-à-vis de tout pouvoir séculier, à l'exception de celui de l'empereur, s'explique, selon Nelis, par la relation problématique avec l'archevêque de Trèves à la fin du XIe siècle. Il voit dans la charte de 1087 un écho des sentiments exprimés dans les sources narratives à l'encontre de Trèves en tant qu'église la plus ancienne de l'Empire allemand. Il fallait à tout prix éviter de revenir à la situation où l'église Saint-Servaas appartenait à Trèves (en ce qui concerne la concession et la donation à Trèves et les démêlés entre les rois de Franconie orientale et occidentale et les archevêques de Trèves, voir Hackeng, o.c., 37-38).
Enfin, Nelis, o.c., 32, conclut que vers 1087 ou la même année, le chapitre de Saint-Servaas a été favorisé par l'empereur Henri IV dans un triple but : obtenir son indépendance vis-à-vis de Trèves et sa proclamation en tant que chapitre impérial, unir le proosdij de Maastricht à la chancellerie de l'Empire romain et protéger le chapitre des empiétements des gardiens laïcs. Selon lui, la présente charte n'a pas été délivrée par la chancellerie impériale, mais la scriptio a été laissée au chapitre, qui a reçu une couverture contenant la subscriptio, le monogramme et le sceau d'Henri IV. Même si la dictée s'écarte des règles habituelles de la chancellerie, il affirme qu'elle reflète les intentions du chancelier et ne contredit pas le cours des événements au début du XIIe siècle. Il situe la fabrication du falsum à la fin du XIe/premier quart du XIIe siècle.
Deeters, o.c., 59-60, met fortement l'accent dans son argumentation sur le passage concernant l'attribution du proosdij au chancelier et l'exercice de tutelle qui y est associé, ce qui était effectivement le cas dans la première moitié du douzième siècle. Plus précisément, cela le conduit à une fabrication du falsum sous le prévôt Gérard d'Are (1154-1160). Au cours de cette période, l'association des fonctions a été mise sous pression, car Gérard d'Are a longtemps été le premier prévôt à ne pas avoir acquis la prévôté grâce à son lien avec la chapelle ou la chancellerie de la cour d'Allemagne. En revanche, son successeur, Christiaan von Buch, connu comme prévôt du chapitre de Saint-Servaas en 1164-1165, a de nouveau cumulé les deux fonctions à partir de 1162. À notre avis, il est toutefois très douteux que cette interruption temporaire de l'exercice des fonctions au sein du chapitre de Saint-Servaas ait entraîné la nécessité d'une charte impériale. D'ailleurs, la plus ancienne mention du chapitre de Saint-Servaas en tant que chapitre impérial se trouve déjà dans une charte de l'empereur Lothaire III datant de 1132 (voir l'édition dans Ottenthal et Hirsch, Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza, 66-68, no. 41), qui fait état d'une proclamation en tant que chapitre impérial avant 1154-1160. La date qu'il propose pour l'origine du falsum, à savoir la seconde moitié du XIIe siècle, doit, à notre avis, être rejetée.
Nous ne pouvons pas non plus souscrire à l'opinion de Linssen, Historical essays, 130ff, en ce qui concerne la date d'origine du falsum. Ignorant complètement l'argument de Nelis, il s'émerveille du fait que la charte, si elle a été produite au début du XIIe siècle, comme le suppose Gladiss, n'est pas mentionnée avant 1232. Il y a eu plusieurs occasions, dit-il, où la charte a été utilisée comme preuve. Il fait référence à la preuve sans équivoque de l'immunité de l'empire et des droits d'immunité, qui sont stipulés dans la charte de 1087. Sur la base de son contenu, il date l'élaboration de la charte des premières décennies du 13e siècle. Selon lui, la charte s'oppose à l'octroi d'un fief, qui n'a pas eu lieu au 11e siècle, mais seulement en 1204. C'est à cette date que le roi Philippe de Souabe a investi le duc de Brabant de Maastricht, de l'église Saint-Servaas et de tout ce qui en faisait partie. Il mentionne également le moment où, en 1214, après une période mouvementée, le duc de Brabant a repris Maastricht en fief et en a hérité. À notre avis, cela ne peut cependant pas avoir joué un rôle dans le chapitre, car l'église Saint-Servaas n'en faisait pas partie (voir Hackeng, o.c., 86). Selon Linssen, la formulation dans laquelle tous les droits royaux dépendent du pape et du Saint-Siège correspond à la courte période qui a suivi la paix de San Germano et Ceprano, conclue le 23 juin 1230. Pour expliquer le fait que le falsum de 1087 n'a manifestement pas été écrit par une main du XIIIe siècle, il invoque une "antiquation" beaucoup plus tardive. Cela ne nous semble pas plausible d'un point de vue paléographique. Suivant l'argument de Linssen, Hackeng, o.c., 311, considère la charte actuelle comme un falsum du milieu du douzième/premier quart du treizième siècle.
Plusieurs auteurs ont, à juste titre, émis des réserves sur un certain nombre de caractéristiques extérieures de la présente charte, mais rien ne s'oppose à une datation substantielle en 1087. Même dans l'hypothèse d'une destinatarisation, la fixation du sceau à l'extrême droite du parchemin, l'emplacement de la ligne du signum et la ligne entre crochets à côté et au-dessous des derniers mots du texte de la charte restent problématiques. L'emplacement du sceau reste curieux, mais la conviction de Nelis selon laquelle le vestige ne correspond pas au format du sceau de l'empereur Henri IV ne peut être confirmée. Tout d'abord, selon Venner, "Sceaux", n° 41, vers 1972, on avait déjà constaté que les fragments du sceau avaient été mal assemblés dans le passé. En outre, le mauvais état du sceau avait déjà été constaté au XVIIe siècle, comme en témoigne une copie certifiée datée du 28 mai 1668 : "et erat subimpressum sigillum ex parte confractum pre vetustate" (voir Maastricht, HCL, numéro d'accès 14.B002A, chapitre des archives de Sint-Servaas à Maastricht, 1062-1797, inv. no. 12, fol. 34). On peut également avancer qu'un espace de 8 cm de diamètre a été prévu sur le parchemin pour le sceau. Le sceau rond d'Henri IV sur une charte de 1062 a un diamètre de 6,8 cm sans bord (Karlsruhe, Generallandesarchiv, Signatur A 97). Il y avait donc suffisamment de place pour le sceau du roi. Le sceau impérial circulaire joint à une charte de 1102 a un diamètre sans bord de 9 cm (Ibidem, Signatur A 116). Le sceau ne couvre donc qu'une petite partie du texte de la charte. Avec cette différence minime, il faut tenir compte du fait que plusieurs chartes sont également connues où une partie du texte de la charte se trouve sous le sceau imprimé. Par exemple, dans une charte d'Otbert, évêque de Liège, datée de 1096 (Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B001, archives Chapitre Notre-Dame de Maastricht, 1096-1796, inv. n° 640), de Frédéric II, archevêque de Cologne, datée de [1157 25 décembre -] 1158 [15 décembre] (Ibidem, n° d'accès 14.D004, archives Abbaye de Kloosterrade, inv. no. 802.2), de la magistra de l'église Saint-Maurice de Cologne de 1158 (Ibidem, accès no. 14.B001, archives Chapitre de Notre-Dame de Maastricht, 1096-1796, inv. no. 633) et de l'abbesse de Thorn datant de (1171 25 décembre -) 1172 (23 septembre) (Ibidem, accès no. 01.187A, archives Royaume libre de Thorn, inv. no. 6). Il n'est donc pas exclu que la présente charte ait été scellée du sceau impérial d'Henri IV.
Une explication bien étayée du texte ombré reste difficile, car les conclusions de Nelis ne sont plus vérifiables. L'examen du parchemin à l'aide d'une lampe à quartz n'a révélé aucune trace du texte ombré. Il n'est donc pas certain que ce soit là que se trouvait le recognitio. Si tel était le cas, la rature pourrait indiquer la direction d'un recognitio qui a été supprimé plus tard par nécessité, par exemple parce que le nom du chancelier ne correspondait pas (plus) à celui du fonctionnaire au moment de la validation de la charte. Il semble très probable que le texte ait été effacé peu après la scriptio, puisqu'il ne figure ni dans la charte de Frédéric II datée de 1232 décembre (voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 16), ni dans le vidimus du chapitre Notre-Dame de Maastricht du deuxième quart du XIIIe siècle (voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 18), ni dans aucun des exemplaires copiés à partir de l'original dans la cartularia.
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 460-462, et Gladiss et Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, XLIII-XLV, indiquent que les destinataires de cette période ont souvent joué un rôle important dans l'émission des chartes royales et impériales, tant dans la redactio que dans la scriptio. Il s'agissait d'une variété de formes mixtes, notamment lorsque le destinataris pouvait modifier le contexte et certaines parties du protocole, soit sur la base d'une dictée fournie par le destinataris lui-même, soit sur la base d'une dictée fournie par le chancelier, après quoi les chanceliers se contentaient d'ajouter les formules de validation de l'eschatocol ou de certaines parties de ce dernier. Une forme plus poussée était la remise d'une couverture par la chancellerie au destinataris avec seulement les formules de validation, où le destinataire pouvait alors écrire le texte qui était ensuite vérifié au moment du scellement ; ou bien on laissait la scriptio entièrement au destinataris et on ajoutait plus tard seulement le scellement et le monogramme.
Ainsi, de nombreuses formes sont envisageables pour la production de la présente charte. On peut exclure avec certitude une émission de la chancellerie ; la rédaction et la dictée peuvent être attribuées au destinataire, le chapitre de Maastricht de Saint-Servaas. Si l'on suit le raisonnement de Nelis concernant la couverture, selon lequel la chancellerie aurait remis au chapitre de Saint-Servaas le parchemin non écrit et plié avec la ligne du signum et le monogramme, la question se pose toujours de savoir pourquoi la ligne du signum aurait été inscrite à mi-chemin sur le parchemin, immédiatement après une rature. En effet, dans les chartes émises par les chancelleries des rois et empereurs romains, la ligne signum est placée non pas à côté, mais en dessous du texte de la charte ; en outre, on n'attache jamais le sceau à droite au-dessus de la ligne signum (cf. http://www.hgw-online.net/abbildungsverzeichnis/deutschland/salier/heinrich-iv ; Gladiss et Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, XCVI-XCVII). Par ailleurs, le sceau n'est pas annoncé, ce qui est tout à fait inhabituel.
Si nous ne suivons pas l'avis de Nelis concernant la couverture, alors une scriptio du texte de la charte par le chapitre de Saint-Servaas entre en ligne de compte, sans la règle du signum, mais éventuellement avec la recognitio qui a pu être mise entre parenthèses plus tard dans la chancellerie, lors du scellement et de l'écriture de la règle du signum. Il n'est pas exclu que l'invocatio oblonisée ait été écrite de la même main que le texte de la charte, même si une encre plus claire a été utilisée. La ligne du signum, en revanche, a été ajoutée par une autre main.
La présente charte a été émise en 1087, dans une période turbulente pour la chancellerie. Le 4 octobre 1084, un archichancelier (allemand) est à nouveau mentionné pour la première fois depuis 1077, à savoir Wezelo de Mayence (voir Gladiss et Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, XLI, et Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-2, n° 369). Cette charte est reconnue par le chancelier Gebehard. Un mois plus tard, une charte impériale fut émise sans recognitio (Gladiss, o.c., no. 370), alors que Gebehard ne mourut que le 26 juin 1089. Le 1er juin 1085, Heriman semble avoir été mentionné pour la première fois comme son successeur dans deux falsa (Gladiss, o.c., nos 373 et 374). Une charte insoupçonnée du 9 novembre 1085 mentionne Burchard, chancelier de la chancellerie italienne (Gladiss, o.c., n° 376), et ce n'est que le 28 décembre 1085 que l'on trouve la première mention du chancelier Heriman dans une charte insoupçonnée (Gladiss, o.c., n° 377). Sa dernière reconnaissance date du 5 avril 1089 (Gladiss, o.c., n° 405). Dans l'hypothèse d'une fabrication de la présente charte en 1087, l'observation de Gladiss, o.c., 524-525, no. 396, doit être rapprochée d'une charte impériale de la même année : "In der Datierung findet sich kein Anhaltspunkt einer Beteiligung der Kanzlei ; doch scheint damals überhaupt durch einen Wechsel der Notare deren regelmäßiger Geschaftsgang gestört gewesen zu sein". Un élément non négligeable au regard des caractéristiques extérieures remarquables de la présente charte. En particulier, les caractéristiques externes anormales de cette période sont également évidentes dans Gladiss, o.c., 502-503, n° 377, daté du 28 décembre 1085, où le labarum se trouve avant le chrismon et la recognitio se trouve à droite au-dessus de la subscriptio impériale. Cette charte a également été créée en dehors de la chancellerie.
A la lumière de ce qui précède, il est tout à fait concevable que le chapitre de Saint-Servais ait édité et rédigé le texte de la présente charte, y compris la recognitio, avant de le soumettre à la chancellerie impériale pour qu'elle le scelle et le reconnaisse. La perturbation du cours des événements à la chancellerie peut avoir eu pour conséquence que la reconnaissance n'a été effectuée qu'après la mort du chancelier Heribert, ce qui pourrait expliquer le berceau de la recognitio et l'emplacement étrange de la règle du signum. Nous ne pouvons pas approuver le fait que cette charte ait été scellée avec un faux sceau d'Henri IV, comme l'indique Gladiss, qui présente pour lui la contrefaçon. En effet, le sceau était déjà très endommagé au XVIIe siècle et, à l'époque de ses recherches, irrémédiablement fragmenté et incorrectement restauré.
Bien que cette charte présente un certain nombre de caractéristiques externes et internes frappantes, la question de la falsification ne semble pas se poser ici. La charte est sans aucun doute une destinatarisation, ce qui explique un certain nombre de particularités, et son contenu n'est pas contesté. À l'instar de Nelis, il semble très probable que le chapitre de Saint-Servaas ait cherché à assurer son lien particulier avec les rois et empereurs allemands, et par conséquent sa position unique par rapport aux autres souverains, au moyen d'un document écrit. Au passage, la combinaison actuelle de la chancellerie et de la proosdodie de Saint-Servais a également été établie. Pour la dictée, le chapitre de Saint-Servaas se basa sur la charte d'Henri IV concernant Echt, qui ne subsiste plus que sous forme de copie, une destinatarisation accordée par le chapitre également en 1087.
Cohérence
Pour la confirmation de la présente charte par l'empereur Frédéric II en date de 1232 décembre et par le roi romain Rodolphe Ier en date de 1273 novembre 5, voir Collection du Chapitre de Saint-Servais, n° 16 et 37. Pour la confirmation du 9 avril 1282 de la charte de Frédéric II datée de 1232 décembre, voir Collection du Chapitre de Saint-Servais, n° 49. Pour le vidimus du deuxième quart du XIIIe siècle du Chapitre de Notre-Dame de Maastricht, voir Collection du Chapitre de Saint-Servais, n° 18.
Edition de texte
Dans la présente charte, certaines parties du texte sont reprises de la charte de l'empereur Henri IV datée de 1087 concernant l'église d'Echt. Pour le texte de cette charte, voir Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-2, 521-522, n° 394. Pour les parties du texte dérivées de cette charte préliminaire et imprimées en caractères plus petits, voir Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 36-37.


Numéro 3
Jan Gruszere, avec le consentement de l'église Notre-Dame de Thorn, a vendu ses champs soumis à accises, situés à Houthem (dans la seigneurie de Valkenburg), au couvent Sint-Gerlach de Houthem. C'est par l'action de Rutger, bailli de Thorn, que la demoiselle Clementia van Geilenkirchen, religieuse de Sint-Gerlach, a reçu ces champs des mains de l'abbesse et du bailli de Thorn. L'église de Thorn recevra du couvent Sint-Gerlach les accises habituelles de ces champs et de la main morte (impôt au décès) pas plus que les accises doubles. Si Clementia quitte le couvent Sint-Gerlach pour entrer dans un couvent avec une règle de vie plus stricte ou si elle et ses consœurs sont transférées dans un autre lieu pour fonder un nouveau couvent, le couvent Sint-Gerlach ne paiera pas la main morte à l'abbaye de Thorn à ce moment-là, mais seulement après que sa mort a été reconnue.
Il est proclamé que Jan Gruszere, avec le consentement de l'église Notre-Dame de Thorn, par la main de Rutger, bailli de Thorn, a vendu au monastère Sint-Gerlach (à Houthem) des champs imposables à Houthem dans la seigneurie de Valkenburg et que la moniale Clementia van Geilenkirchen, qui s'y trouve, les a reçus des mains de l'abbesse et du bailli de Thorn à condition que le couvent , lorsqu'elle se retirera pour fonder un nouveau couvent, ne paye pas la main morte à Thorn, avant que Thorn n'ait reconnu sa mort.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 39, n° de registre 12.
Notes sur le revers : 1° par une main du dernier quart du XIVe siècle : G j. - 2° par une main du XVIIe siècle : 1232. - 3° par une main du XVIIIème siècle : Num. 77.
Sceau : un sceau apposé, suspendu, et annoncé, à savoir : S1 de Hildegonde, abbesse de Thorn, de cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals monastery Sint-Gerlach', 156.
Copies
B. 1287 9 août, Maastricht, RHCL, accès n° 01.187A, archives Royaume libre de Thorn, inv. n° 69, par Willem, prévôt de Sint-Gerlach à Houthem, à A. - C. 1735, Maastricht, RHCL, accès n° 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 1 (cartulaire) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 123-124, sous l'intitulé : Renuntiatio ecclesie Thorensis de uno et viginti denariis Leodiensibus super agris in Houthem, et en marge : Num. 77, indiquant un point de scellement, à A.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 6-7, n° 4, après A (daté de 1232).
Références
Habets, Archives Thorn, 12, n° 12 (daté de 1232). - Haas, Inventaris Sint Gerlach, 68-69, reg. nr. 4 (daté de 1232). - Idem, Liste chronologique, 41, registre n° 76 (daté de 1232).
Dates
On suppose que les évêques de Liège sont passés du style de Noël au style de Pâques vers 1230 et que les institutions religieuses du diocèse ont suivi quelque temps plus tard, voir Camps, ONB I, XXI. Par conséquent, pour la datation de la présente charte, on suppose l'utilisation du style de Noël. Le terminus ante quem est déterminé par le cinquième acte d'accusation, qui par l'indictio Bedana commence le 24 septembre 1232].

Numéro 3
Hilzondis, comtesse de Strijen, sur les conseils de son mari Ansfried, fait construire une église sur sa propriété de Thorn, où elle et sa fille Benedicta mèneront la vie monastique. Elle donne à cette église ses propres biens dans le pays de Strijen, autrefois donnés par le roi Zwentibold, à savoir l'église de Strijen, Geertruidenberg, la villa Gilze avec ses accessoires, la villa Baarle avec l'autel de Remigius qu'elle a fondé, le château Sprundelheim sur la Merbatta, et une forêt telle qu'elle se trouve entre les deux Marches.
<Hilzondis, gravin van Strijen, sticht op aanraden van haar echtgenoot Ansfried een kloosterkerk op haar eigen goed Thorn, waar zij en haar dochter Benedicta het kloosterleven zullen leiden, en schenkt aan het klooster geheel haar eigen goed in het land van Strijen, dat eertijds door koning Zwentibold was geschonken, bestaande uit de kerk van Strijen, Geertruidenberg, de villa Gilze met toebehoren, de villa Baarle met het door haar, Hilzondis, gestichte Remigiusaltaar, het slot Sprundelheim aan de Merbatta, en een bos zoals het ligt tussen de twee Marcas.>
original trompeur
[<A>]. Schijnorigineel of ontwerp hiervoor niet voorhanden, of hebben mogelijk niet bestaan.
Copie
B. ca. 1640, Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives État libre Seigneurie de Thorn, C (anciennement Bruxelles, ARA, Archives ecclésiastiques du Brabant), préliminaires inv. no. 19231/37 = document libre, in dorso : Fundatio in (sic ) Thorn, simple copie, directement ou indirectement d'après un registre perdu, compilé par Michiel Piggen, greffier du Conseil et de la cour des comptes de Breda, compilé ca. 1545-ca. 1610, probablement ca. 1565-1587.
Edition
a. Dillo-Van Synghel, ONB II, 16-29, no. 892.
Edition de texte
Dans l'Oorkondenboek van Noord-Brabant, on n'a pas publié une seule charte reconstruite de ce falsum, mais les deux principales traditions sont présentées en deux colonnes. La traduction est celle de la tradition la plus ancienne qui se trouve dans la colonne de gauche, et qui représente le meilleur texte.


Numéro 3
Frédéric Ier, archevêque de Cologne, accorde à l'abbaye de Kloosterrade les dîmes de ses terres défrichées et plantées de vignes à Ahrweiler.
Frédéric Ier, archevêque de Cologne, accorde à l'abbaye de Kloosterrade les dîmes de ses terres défrichées et plantées de vignes à Ahrweiler.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 763.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 12-14, n° 3, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 4
Le pape Grégoire IX protège le monastère de Notre-Dame Sint-Gerlach à Houthem et les moniales qui y vivent, et confirme le monastère dans toutes ses possessions présentes et futures.
Le pape Grégoire IX prend sous sa protection le monastère de Notre-Dame Sint-Gerlach (à Houthem) et le confirme dans toutes ses possessions présentes et futures.
Original
A. Maastricht, RHCL, numéro d'accès 14.D003, archives Sint-Gerlach couvent de Houthem, inv. n° 3, reg. n° 5. Lignée. Endommagée avec perte de texte.
Notes sur le revers : 1o d'une main du dernier quart du XIVe siècle : A j. - 2o d'unemain du XVe siècle : Bos. - 3° par une main du XVIIème siècle : Confirmatio possessionum bonorum et potestas a [***]. - 4°d'une main du XVIIIe siècle : Num. 68.
Scellement : aucune trace du scellement par découpe du bas du parchemin.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 112-113, sous le titre : Bulla Gregorii, pape, exemptionis monasterii sancti Gerlaci et eiusdem bonorum, et en marge : Num. 68, indiquant une place de sceau, à A.
Dépenses
a. Gerlach, IV, 7-8, n° 5, d'après A. - b. Habets, 'Houthem-Sint-Gerlach', 219-220, n° 14 (daté par erreur du 10 janvier 1376), d'après B.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 69, reg. no. 5. - Idem, Liste chronologique, 41, reg. no. 77.


Numéro 4
Le roi romain Henri II accorde à l'abbaye de Thorn les droits de marché et de péage ainsi que la juridiction de Thorn. Il ratifie également la concession à l'abbaye des églises de Bree, Hemert et Avezaath par l'évêque Notger.
Le roi romain Henri II accorde à l'abbaye de Thorn des droits de marché, de péage et de juridiction à Thorn et confirme la donation par l'évêque Notger de Liège des églises de Bree, Hemert et Avezaath.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 4.
Edition
a. Muller et Bouman, OSU I, 154-155, n° 163, d'après A.


Numéro 4
Adelbero II, évêque de Liège, certifie que Rudolf de Turri, serviteur du comte Adolf de Saffenberg, avec le consentement de sa femme Waldrade et de ses fils Paganus, Gevehard et Herman, par l'intermédiaire de son seigneur, gérant de l'abbaye de Kloosterrade, a fait don à l'abbaye de ses terres situées à Hubach, sur lesquels a été construit un couvent de femmes (Marienthal), et règle les relations entre l'abbaye et le couvent-fille.
Adelbero II, évêque de Liège, certifie que Rudolf de Turri, ministériel du comte Adolf de Saffenberg, avec le consentement de son épouse Waldrade et de ses fils Paganus, Gevehard et Herman, par l'intermédiaire de son seigneur, gardien de l'abbaye de Kloosterrade, a fait don à l'abbaye de ses biens à Hubach, sur lesquels a été construit un couvent de femmes (Marienthal), et règle les rapports entre l'abbaye et le couvent-fille.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 676.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 15-19, n° 5, d'après A.
Authenticité
Sur le caractère éventuellement fallacieux de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 3
Le roi romain Henri V renouvelle et confirme, par l'intermédiaire d'Adelbert, son chancelier et prévôt de l'église Saint-Servaas de Maastricht, et à la demande des chanoines, les règles de droit précédemment écrites ainsi que l'échange de deux sabots à Maastricht, effectué vers 1076 par son père, l'empereur Henri IV.
Le roi romain Henri V renouvelle et confirme, par l'intermédiaire d'Adelbert, son chancelier et prévôt de l'église Saint-Servaas de Maastricht, et à la demande des chanoines, les règles de droit précédemment écrites ainsi que l'échange de deux sabots à Maastricht, effectué vers 1076 par son père, l'empereur Henri IV.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 43. Endommagé avec perte de texte.
Sceau : un sceau imprimé, annoncé, à savoir : S1 du roi romain Henri V, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals', no 42.
Copies
[B]. 1218 10 juin, non disponible, mais connu par C, vidimus par Otto van Everstein, prévôt du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, après A. - C. 1268 22 septembre, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 48, vidimus par le roi romain Richard de Cornouailles, après A. - D. fin XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum] fol. 13v-14r (= nouveau fol. 30v-31r). - D. fin XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 13v-14r (= nouveau fol. 30v-31r), n° 25, après A. - E. XVe siècle, Ibidem, accès n° 14.B001, chapitre d'archives de Notre-Dame de Maastricht, 1096-1796, inv. n° 31 (cartularium), fol. 181r-182r, sous le titre : Item tenores omnium et singulorum exhiborum sequuntur per ordinem in hunc modum et sunt tales, et sous caput : Item tenores litterarum imperialium felicis recordationis domini Heynrici, Romanorum regis quinti, sigillo quondam confundo et leso in quo ymago imperatoris in dextera ceptrum regale, in sinistra vero pommum imperiale cum cruce superposita gestantur, sana et integra habebantur in margine inferiori ipsarum litterarum affixo sigillatarum et bullatarum atque signo quodam quadrato lineationibus et pluribus caracteribus composito dulsis etiam subtus caracteribus expressis signatarum sequuntur et sunt tales, d'après A. - F. 1640, Ibidem, accès no. 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. no. 1741 (cartulaire) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 14-16, sous le titre : 10, Privilegium Henrici imperatoris pro immunitate officiatorum, à A. - G. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, p. 109-111, sous le titre : Diploma Henrici quinti, Romanorum regis, quo declarat prepositam, decanum et capitulum omnes habere iurisdictiones, seclusis omnibus presentibus iudicibus, tam in eorum domibus claustris viis quam in templo et atriis, et quo modo hi eorum iurisdictiones exercere debeant, datum indictione secunda anni 1108 (corrigé de 1109), copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier de Maastricht, à A. - H. avant 1768, Ibidem, idem, pp. 245-247, sous le titre : Otto, prepositus Aquensis, declarat se vidisse integras et non cancellatas litteras Henrici quarti, Romanorum regis, quibus dat ministris ecclesie Sancti Servatii exemptionem et immunitatem, videlicet coco, pistori, bracedario et campanariis, in octavis Pentecostes 1218, à [B].
Dépenses
a. Böhmer, Acta imperii selecta, 69-71, n° 75 (voir aussi les éditions plus anciennes), d'après A. - b. Waitz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 18-25, n° 8, d'après a.- c. Van de Kieft, 'Recueil', 427-429, n° 17 ( incomplet) , d 'après b. - d . Thiel , Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde , n° 283 , d'après b. 17 (incomplet), à A. - d. Thiel, Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, no. 283, à b. - e. Hackeng, The Medieval Land Property, 310-311, no. 96b (incomplet), à d.
Références
Voir le numéro a, ainsi que le DiBe ID 6930.
Localisation
En ce qui concerne la localisation des deux sabots à Maastricht, voir Hackeng, Medieval land ownership, 210-211, ainsi que 719, carte 31.
Authenticité et genèse
Böhmer, Acta imperii selecta, 70-71, disqualifie la présente charte sur la base d'un certain nombre de caractéristiques extérieures, sans qualifier explicitement le document de falsum. Selon lui, ce qui est frappant, c'est que le texte est écrit autour des plis allant de haut en bas, comme dans les chartes de Saint-Servaas du 21 septembre 1062 et de 1087 (voir Collection de Saint-Servaas, nos 1 et 2). Il signale également l'espace vide après "Dates" et "Actum", après lequel la date et le nom du lieu sont absents, ainsi que l'absence d'"Amen".
Niermeyer, Investigations, 172-179, à la suite de Böhmer, qualifie cette charte de faux original. Il souligne entre autres le format inhabituel du parchemin, qui est environ une fois et demie plus large que haut, la position étrange des lignes du signum et de la reconnaissance l'une par rapport à l'autre, le retrait des trois dernières lignes du contexte au profit du sceau apposé dans le coin le plus à droite, et l'espace disproportionné laissé ouvert après "Datum" et "Actum", où les données correspondantes sont manquantes.
Niermeyer, o.c., 200 et 223, affirme que la présente charte a été rédigée par la personne qui a également produit ce qu'il considère comme la fausse charte de 1062. Les recherches paléographiques ont cependant montré qu'il n'y a pas de similitude (voir également le point 1 ci-dessus). Il affirme également que cette main a frappé les deux falsa papales de l'archevêché de Hambourg de 885 et 912/913 (pour une édition, voir Curschmann, Die älteren Papsturkunden, 29-30, n° 8 et 36-37, n° 13 ; en ce qui concerne le groupe d'écriture auquel appartiennent ces falsa, voir Curschmann, o.c, 124-126) et que cette main d'écriture possède des caractéristiques remontant à une charte rédigée par l'évêque de Liège avec la main L (pour la main L, voir Niermeyer, o.c., 188). L'identification de Niermeyer doit cependant être considérée avec prudence, comme le montrent également ses observations concernant la charte épiscopale de 1151 rédigée par la main O pour Kloosterrade (voir Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 61). Cependant, son identification des caractéristiques remarquables de marquage avec le texte écrit autour des plis allant de haut en bas dans la charte actuelle de 1109 et dans les deux falsa papales pour Hambourg est justifiée.
Sur la base des recherches paléographiques effectuées à partir d'une image de ces chartes papales, on peut provisoirement conclure que le scripteur de la présente charte est très probablement le même que celui des deux falsa papales. Toutefois, il est souhaitable de poursuivre les recherches à Hanovre pour identifier la main au moyen de mesures des angles de pente, des angles d'écriture, etc.
En ce qui concerne le sceau, Niermeyer, citant Posse, Siegel Kaiser 1, tableau 19, 1, que celui-ci ne correspond pas au véritable sceau royal d'Henri V. En effet, le sceau de la présente charte présente sur le trône, de part et d'autre, les extrémités enroulées d'un coussin, éventuellement terminé par deux têtes d'animaux. Or, ces éléments, qui figurent sur les deux sceaux impériaux d'Henri V, sont absents du véritable sceau du roi. Sur la base de cette image anormale, Niermeyer conclut que le sceau de la charte actuelle est faux et qu'il a probablement imité un sceau impérial d'Henri V. Ses conclusions ne sont plus vérifiables en raison de l'état fragmentaire actuel du sceau.
En ce qui concerne le dictat, Niermeyer, o.c., 180-181, signale ce qui suit : 1. une forte relation de dictat avec une charte d'Henri V pour Liège datée du 23 décembre 1107 (= Stumpf-Brentano, o.c., no. 3021 ; pour une édition, voir Waitz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 18-25, no. 7) ; 2. l' emprunt du passage sur l'intervention du prévôt du chapitre de Saint-Servais d'une charte d'Henri V pour le chapitre de Saint-Servais datant d'environ 1109, transmise en transcription (= Stumpf-Brentano, o.c. no. 3215 ; pour une édition, voir Thiel, Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, no 41) ; 3. une corroboratio différente et une liste de témoins manquante en comparaison avec la charte d'Henri V datée du 23 décembre 1107, mais une concordance dans la corroboratio avec la formulation qui était courante dans la chancellerie d'Henri IV, plus précisément dans une charte d'Henri IV pour le diocèse de Halberstadt datée du 20 août 1063 (= Stumpf-Brentano, o.c, n° 2628 ; pour une édition, voir Böhmer, Acta imperii selecta, 59, n° 61) et ce qu'il considérait comme une fausse charte datée de 1062 (voir Collection Saint Servais, n° 1).
La charte du 23 décembre 1107 a sans doute servi de document préliminaire à la redactio de la présente charte. L'emprunt du passage concernant l'intervention du prévôt n'est cependant pas spécifique à la charte de 1109 environ, mais se trouve déjà dans une charte d'Henri V datée du 14 février 1106 (pour une édition, voir Böhmer, Acta imperii selecta, 67-68, n° 72), où le choix des mots "interventu" est encore plus étroitement lié que dans la charte de 1107 à celui de "peticione". La corroboratio renvoie à l'échange des deux sabots mentionné dans la dispositio, effectué par Henri IV vers 1076. En effet, cette corroboratio diffère de celle des chartes d'Henri V et ressemble fortement à la formulation des chartes d'Henri IV, en particulier la charte de 1062.
Niermeyer conclut que le falsum 1109 "se montre immédiatement dépendant" de la charte de Liège de 1107, qui a été élargie et modifiée. Ce faisant, la charte du 23 décembre 1107, qui n'a survécu que par le biais de transcriptions dans une version interpolée (surtout dans les articles 3 et 5), a servi de base à la charte de 1109 dont il est question ici, voir Niermeyer, o.c., 162-165. Dans sa conclusion finale, il avance la thèse selon laquelle le falsum 1109 appartient à un groupe de falsa de Maastricht qui a vu le jour après 1146 et vraisemblablement autour de 1160.
Van de Kieft, 'Recueil', 427-429, adopte le point de vue de Niermeyer en ce qui concerne la présente charte. Selon Hausmann, Reichskanzlei, 17, note 4, la charte de 1109 est un falsum de la fin du XIIe siècle. Selon lui, le document n'a pas non plus été édité et/ou rédigé par l'un des notarii d'Henri V (en effet, il est absent de la liste de Hausman, o.c., 64-67, avec les notarii qui, sous Adelbert de Sarrebruck, chancelier du roi romain Henri V, étaient responsables de la rédaction, du dictat ou des deux à la fois).
Deeters, Servatiusstift, 56 et 61-62, date l'origine de la présente charte au début du XIIe siècle et suit Niermeyer en ce qui concerne les emprunts de dictées à la charte pour Liège du 23 décembre 1107 mentionnée ci-dessus. Selon lui, la charte de 1109 ne contient aucun indice substantiel permettant de dater la falsification. Bien qu'il considère la charte comme un faux formel, son contenu correspond, selon lui, à une situation juridique existante.
Hackeng, The medieval land tenure, 310, qualifie la présente charte de falsum en se référant à Niermeyer, Van de Kieft et Böhmer. Citant Deeters, il date sa création au 12e siècle, au plus tard en 1204.
A notre avis, la présente charte n'a pas été éditée et/ou rédigée dans la chancellerie d'Henri V, mais est une destinatarisation par le chapitre de Saint-Servaas à Maastricht sur la base de la charte du roi romain Henri V datée du 23 décembre 1107 pour les chanoines de Liège. La corroboratio différente de celle du Vorlage dans la présente charte, qui présente au contraire une similitude remarquable avec celle du destinatarisoorkonde du chapitre de Saint-Servaas de 1062, indique également un environnement d'origine au sein du chapitre. Un certain nombre de caractéristiques externes de la présente charte sont particulières, mais ne sont pas décisives pour qualifier cette charte de falsum. La position inhabituelle de la ligne du signum, à mi-chemin du parchemin, peut éventuellement être attribuée au destinataris. Dans la charte d'Henri IV datée de 1087 (voir Collection Saint-Servatius, n° 2), qui est également une charte de destinataris, la ligne du signum se trouve à mi-chemin de la ligne d'écriture. Il n'est pas possible de vérifier si le sceau a été falsifié, comme le suppose Niermeyer, en raison de son mauvais état matériel. La dernière ligne de la datatio de la présente charte, "Data, actum feliciter in nomine Domini", est exactement la même que celle de la charte préfacière de 1107, sauf qu'après "Data" et "actum", un espace a été laissé libre pour ajouter la date et le lieu exacts de l'émission. Apparemment, cela a été inexplicablement négligé lors de la reconnaissance, de la signature et du scellement. Aucune objection n'a été soulevée ou ne peut être soulevée à l'encontre du contenu de la présente charte. En outre, l'échange de deux sabots par Henri IV, daté de manière très précise, semble tout à fait plausible. Il est possible que cet échange n'ait pas été annoncé par Henri IV et que le chapitre de Saint-Servaas ait profité de la confirmation des règles de droit par son successeur, le roi romain Henri V, pour consigner cet échange par écrit.
Cohérence et édition du texte
Dans la présente charte, certaines parties du texte sont tirées de la charte du roi romain Henri V pour Liège, datée du 23 décembre 1107. Pour le texte de cette charte, voir Waitz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 18-25, no. 7. Les parties du texte dérivées de cette pré-charte sont en caractères plus petits. Pour les parties du texte dérivées de cette charte préliminaire et imprimées en caractères plus petits, voir Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 44-45. Le passage du paragraphe 4 est reproduit dans la charte de confirmation de l'empereur Frédéric II, datée du 28 juillet 1215, voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 10. Pour le vidimus du roi romain Richard de Cornouailles, daté du 22 septembre 1268, voir Collection du chapitre de Saint-Servais, n° 28. Les lacunes du point A ont été comblées au point C.

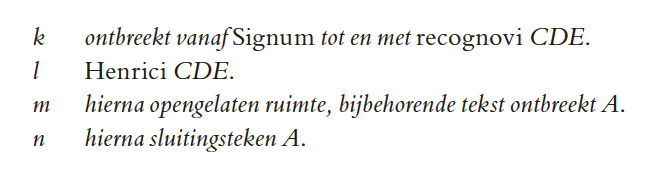


Numéro 4
Le roi romain Lothar III confirme l'échange par les frères du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht de leur allodium à Monsheim contre l'église de Güls avec l'abbaye de Hersfeld.
Le roi romain Lothar III confirme l'échange par les frères du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht de leur allodium à Monsheim contre l'église de Güls avec l'abbaye de Hersfeld.
Original
[A]. non disponible.
Copies
B. fin XIIe/premier quart XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 336, d'après [A]. - C. Fin du XIIIesiècle , Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 6r-6v (= nouveaux fol. 23r-23v), n° 10, d'après [A]. - D. 1640, Ibidem, idem, inv. no. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 17, sous le titre : 12, Confirmat Lotharius est permutationem factam cum bonis de Gielsa, à [A].
Dépenses
a. Ottenthal et Hirsch, Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza, 10-11, no. 9, d'après B. - b. Hackeng, The Medieval Land Property, 287, no. 57b (incomplet), d'après B. - c. DiBe ID 5422, d'après a.
Références
Voir DiBe ID 5422.
Dates
Selon Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 90, n° 336, la copie B date du XIIIe siècle, tandis qu'Ottenthal et Hirsch supposent une scriptio dans la seconde moitié du XIIe siècle. Sur la base de son affinité paléographique avec une charte non datée de l'abbé de Kloosterrade, par Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 114-116, no. 52, datée entre 1201 et 1211, et avec une charte du doyen et du chapitre de Notre-Dame à Maastricht d.d. 26 mars 1225 (voir Maastricht, HCL, numéro d'accès 14.B001, archives Chapitre de Notre-Dame à Maastricht, 1096-1796, inv. no 1011), nous datons cette copie de la fin du douzième/premier quart du treizième siècle.
Origines et édition du texte
Selon Ottenthal et Hirsch, le texte de la présente charte n'a pas été édité à la chancellerie royale. Le texte a été édité sur la base de B, avec les variantes de C dans les notes.


Numéro 5
Henri, administrateur des cloîtres de Sainte-Marie à Heinsberg et Sint-Gerlach à Houthem, déclare que Mathilde, magistrat de Sint-Gerlach, a destiné un intérêt annuel de quatre "schellings", provenant de dons antérieurs de deux maisons d'Aix-la-Chapelle, et d'un "malder" de seigle à Daniken pour l'infirmerie de Sint-Gerlach. Il donne une liste du bétail et approuve cette destination par Mathilde à l'infirmerie.
Henri, prévôt des cloîtres (de Sainte-Marie) de Heinsberg et Sint-Gerlach (de Houthem), déclare que Mathilde, magistrat de Sint-Gerlach, a affecté un intérêt annuel de quatre shillings de deux maisons d'Aix-la-Chapelle et d'un "malder" de seigle à Daniken à l'infirmerie de Sint-Gerlach, et donne la liste du bétail et approuve l'affectation.
Original
A. Bruxelles, ARA, Chartes diverses de la deuxième section, boîte 1, date d'annonce 1236 septembre 2 (n° 16594).
Notes au verso : 1° de la main du XVIe siècle : Van den seickhuis. - 2° par la main du 17ème siècle:No XXIIII.
Scellement : deux sceaux, apposés à l'extrémité, doublement percés, qui ont été annoncés, à savoir : S2 du cloître de Sainte-Marie à Heinsberg, en cire blanche, endommagé. - S3 du couvent Sint-Gerlach à Houthem, en cire blanche, endommagé ; et un lieu de fixation pour un sceau non annoncé (LS1). Compte tenu de ce positionnement, le premier sceau à gauche a été apposé par erreur à cet endroit. Pour une description et une image de S3, voir Venner, "Seals convent Sint-Gerlach", 151-153.
Copie
Non disponible.
Edition
a. Ramackers, 'Niederrheinische Urkunden', 77-78, n°8, d'après A.
Regest
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 69, registre n° 6 (daté de 1236).


Numéro 5
Anselm, homme libre, en présence de plusieurs témoins, transfère volontairement sa fille Mechteld et trois acres de sa propriété à Oe à l'autel de Notre-Dame à Thorn. Mechteld recevra les revenus de cette terre aussi longtemps qu'elle vivra. Quiconque viole ce transfert volontaire est menacé d'excommunication.
Anselme, homme libre, remet sa fille Mechteld ainsi que trois arpents de propriété allodiale dans la commune de Oe à l'autel de Notre-Dame de Thorn par la main de Gérard, comte de Gelre, à condition que Mechteld jouisse à vie des revenus qui en découlent.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid de Thorn, inv. n° 5. Légèrement endommagé.
Annotation au verso : 1ode la main du XIIIe siècle : De censu capitali 1102. - 2o de la main du XVIe siècle : De tribus bonariis terre sitis in loco de O. - 3ode la main du XVIIe siècle: lettre et C barrés .
Sceau : un sceau inséré, non annoncé, à savoir : S1 d'une personne ou d'une institution non identifiée, en cire blanche, endommagé. Pour l'identification et la représentation problématiques de S1, voir Venner, "Seals Thorn", 16-19.
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire révisé Épine, 10-11, n° 5, après A. - b. Habets, Archives Épine, 8, n° 5, après a.
Regest
Haas, liste chronologique, 21, no. 8.
Authenticité et genèse
L'authenticité de la présente charte a été mise en doute par Venner et Kersken. Venner, "Seals Thorn", 16-19, n'a pas pu attribuer le sceau non-annoncé ni à une institution ni à une personne. Sur la base de sa représentation sous la forme d'un sceau de trône et de sa forme ovale, il met en doute son authenticité. Il évoque la possibilité que la charte n'ait pas été scellée initialement et qu'un faux sceau ait été apposé dans les dernières décennies du XIIe siècle. Bien que cela suggère que la charte est authentique, il continue à la remettre en question. Cependant, hormis sa référence aux emprunts de textes de chartes papales et au rôle remarquable du comte de Gelre dans le transfert, il affirme que l'enquête sur l'authenticité n'entre pas dans le cadre de sa contribution.
Sur la base de cette charte, Schiffer, Grafen von Geldern, 64, conclut que le comte de Gelre assumait la tutelle de Thorn dès 1002, bien que Venner signale que la première mention concrète de la tutelle de Thorn ne date que de 1244. Sur cette question de la tutelle, Kersken, Zwischen Glaube, 180, souligne en outre que le rôle d'intermédiaire du comte n'implique pas une relation fonctionnelle directe avec l'abbaye de Thorn. Il met également en doute la qualification du témoin Geldolf en tant que sous-gardien de l'évêque de Liège, comme le suppose Linssen, Contribution, 8. Les premières mentions fiable d'une tutelle de Thorn datent de 1230/1231, lorsque l'abbaye a émis deux chartes, l'une pour le duc de Limbourg sur la tutelle d'Übach et l'autre pour leur tuteur, le duc de Brabant (Kersken, 182-183).
Kersken partage l'argument de Venner concernant l'authenticité du sceau et les doutes qui en découlent quant à l'authenticité de la charte. Bien qu'il n'ait pas mené d'enquête paléographique et diplomatique approfondie, Kersken fait état d'un certain nombre de constatations qui renforcent ses doutes. Il signale l'écriture dans un "ungelenker diplomatischer Minuskel" et l'invocatio oblongue dans une "ungelenker littera elongata" qui ne serait pas compatible avec le mobile modeste de la rédaction de cette charte. Sur la base de recherches comparatives concernant le ductus, l'écriture, les abréviations utilisées et les ligatures, il parvient à la conclusion provisoire que la charte a pu être rédigée par une main vraisemblablement inexpérimentée du douzième siècle.
Selon lui, la formule de sanctio en deux parties, calquée sur le modèle papal, est une caractéristique interne frappante, que l'on ne s'attend pas à trouver dans une "Privaturkunde" (ici une charte émise par une personne privée au nom d'une abbaye). La liste des témoins le laisse également songeur. Ce n'est que dans le cas des nobles seigneurs de Horn et de Kessenich que des liens de parenté peuvent être établis, mais dans chaque cas, il s'agit de la plus ancienne mention de ces familles dans des chartes précédant de plusieurs décennies la suivante (respectivement en 1138 et en 1155). En outre, il considère que l'utilisation précoce de noms de lieux n'est pas plausible à la lumière de leur signification politique. Sur la base de ces objections, Kersken déclare qu'il ne peut pas étayer davantage les soupçons qui pèsent sur la charte actuelle de 1102, faute d'autres chartes. Il penche néanmoins pour la conclusion que cette charte est un faux créé plus tard et muni alors d'un sceau falsifié. Il évoque la possibilité d'établir un lien avec une charte de Thorn non datée (voir collection Thorn, n° 7), classée par Habets , selon Kersken, à la fin du XIIe siècle pour des raisons paléographiques. Habets n'a cependant pas argumenté cette datation dans son édition, ni daté concrètement la charte à la fin du XIIe siècle. Son édition est basée sur Franquinet qui date cette charte du XIIe siècle. Sur la base de recherches paléographiques, nous avons daté cette charte de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle (voir Collection Thorn, n° 7).
En résumé, les objections et les conjectures de Venner et de Kersken, concernant les caractéristiques externes et internes, n'ont pas permis de déclarer sans équivoque la fausseté de la présente charte. Il se peut que nous ayons affaire à une charte authentique, rédigée en 1102, à laquelle a été apposé ultérieurement le sceau d'un scelleur jusqu'ici non identifié, comme le suggère Venner. Cette idée n'est pas illogique si l'on considère que l'annonce du sceau ne figure pas dans le texte. Il pourrait également s'agir d'une falsification matérielle : dans ce cas, l'acte juridique qui a eu lieu au début du XIIe siècle n'aurait été consigné par écrit que plus tard. Cela signifie que le contenu de la charte est authentique, mais que la forme est fausse. Il se peut aussi que l'abbaye de Thorn ait produit un falsum, c'est-à-dire une charte fausse à la fois dans son contenu et dans sa forme.
En ce qui concerne l'écriture, on peut observer ce qui suit. Il y a bien une instabilité de la main d'écriture (visible aux bâtons du r et du f qui descendent sous la ligne d'écriture ; avec la lettre p : parfois un empattement au bas du bâton qui monte à droite, parfois non). En outre, le texte de la charte comporte un certain nombre de fautes d'orthographe gênantes : viginis au lieu de virginis, Gehardus au lieu de Gerhardus et Heinco au lieu de Heinrico. Il convient de noter l'ornement sous la forme d'une boucle unique dans les hampes supérieures des lettres b, d, f, h, l et s, ainsi que d'une boucle comme signe d'abréviation, évoquant des réminiscences de la structure en treillis/boucle dans les chartes de la principauté de Liège.
Selon Stiennon, L'écriture diplomatique, 59, 62-63, 75, le type d'écriture ornée de boucles, qui ne se limitait pas au diocèse de Liège, a été emprunté aux chartes impériales allemandes. Dans les chartes liégeoises, les boucles sont encore embryonnaires dans les années 60 du XIe siècle et l'évolution vers une forme exubérante se manifeste dans le dernier quart du XIe siècle. Dans la région Meuse-Rhin, on observe une stabilisation vers une forme modeste au XIIe siècle. Il est remarquable que Stiennon n'ait pas inclus les chartes de Thorn dans son étude, bien qu'il ait examiné d'autres archives du Limbourg (néerlandais).
Les institutions ecclésiastiques de la Meuse ont connu très tôt des chartes avec des structures en treillis : Thorn a reçu une telle charte du roi en 1007, les chapitres de Notre-Dame et de Saint-Servais à Maastricht possèdent des chartes du roi et de l'évêque datant du XIe siècle, et l'abbaye de Kloosterrade une charte de l'archevêque de Cologne datant de 1126-1127.
La recherche d'une tradition d'écriture au sein de l'abbaye de Thorn aux XIe et XIIe siècles est rendue presque impossible par l'absence de documents originaux de l'époque. Nous ne possédons qu'une charte royale falsifiée au Xe siècle (950), (voir Collection Thorn, n° 1), une charte royale très endommagée de 985 (voir Collection Thorn, n° 2), une charte royale de 1007 (voir Collection Thorn, n°4), une charte de l'abbesse de Thorn de 1172 (voir Collection Thorn, n° 6) et une charte non datée de Reinwidis d'Übach (voir Collection Thorn, n° 7). L'original suivant ne date que de peu avant le 13 juillet 1234 (voir Collection Thorn, n° 8).
Avec une seule charte dans le chartarium, émise par l'abbesse de Thorn, aucune déclaration ne peut être faite à propos des caractéristiques spécifiques et de l'évolution de l'écriture présentes dans les chartes de Thorn. Mais c'est précisément cette charte de 1172 qui contient les caractéristiques de l'écriture carolingienne typique avec la structure en treillis et aussi l'abréviation des us en forme de tire-bouchon. Si nous la comparons à la charte actuelle de Thorn datée de 1102, les éléments suivants sont frappants : les décorations sont sobres, les hampes supérieures relativement longues et les queues caractéristiques de 1172 sont absentes, les extrémités des lettres p et q s'inclinent vers la droite, ce qui est plutôt une caractéristique de l'écriture livresque. Cette écriture se rattache à des chartes de 1178 (Abbaye de Neufmoustier, Stiennon, L'écriture diplomatique, 94) et à une charte de 1121-1128 (Chapitre de Saint-Paul de Liège, Stiennon, L'écriture diplomatique, figure 161) qui, selon Stiennon, ne peut cependant être placée avant le milieu du XIIe siècle en raison de son caractère fortement gothique.
La grande marge au bas de la présente charte, avec le sceau sur le côté droit du parchemin, est typique des chartes royales et impériales allemandes. L'abbaye de Thorn possède une charte du roi romain Henri II datant de 1007 (voir n° 4 ci-dessus) avec cette disposition et un sceau imprimé sur le côté droit. Cette disposition était courante au moins jusqu'au milieu du XIIe siècle, avec une encoche sur le côté droit du parchemin pour l'insertion du sceau, comme en témoigne une charte de l'évêque de Liège datée du 28 août 1140 pour l'abbaye de Kloosterrade (voir Maastricht, HCL, numéro d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. no. 676). L'abbesse de Thorn elle-même a également émis en 1172 une charte présentant la même disposition en 1172.
En ce qui concerne le sceau, Venner note qu'un sceau de trône ovale est remarquable en 1102. Il signale un sceau de trône ovale exceptionnellement prématuré de 1090 de l'évêque de Noyon-Tournai, mais les archevêques de Cologne et de Trèves n'ont introduit le sceau de trône qu'en 1105 et 1115 respectivement, les évêques de Liège les premiers en 1123. On peut ajouter que dans le diocèse de Liège, des sceaux de trône ovales n'ont été attestés chez les abbés de Saint-Trond, par exemple, qu'à partir de 1158 et 1164 (voir Bruxelles, ARA, Collection de moulages de sceaux, nos 963 et 958). Un sceau de trône ovale dans une charte d'un particulier pour l'abbaye de Thorn en 1102 semble donc être un spécimen très prématuré.
En ce qui concerne les caractéristiques internes, la structure générale de la dictée (invocatio/notificatio, dispositio, sanctio, corroboratio et datatio) et les formules de dictée correspondent à celles des chartes du XIIe siècle. Toutefois, deux remarques supplémentaires peuvent être faites ici. Tout d'abord, la sanctio frappante dans une charte émise par un particulier, qui, selon Venner, aurait été empruntée aux chartes papales. A propos de cette sanctio, on peut mentionner que des sanctions similaires circulaient abondamment à la fin du XIe/XIIe siècle dans les chartes des évêques de Liège au profit d'institutions spirituelles limbourgeoises ou dans des chartes les impliquant. Nous avons retrouvé la sanctioformula de la charte de 1102, entre autres, dans deux chartes d'Otbert, évêque de Liège, destinées au chapitre Notre-Dame de Maastricht et au chapitre Notre-Dame de Dinant en 1096 (voir DiBe ID 88 et DiBe ID 2594) et dans des chartes d'Henri, évêque de Liège, au profit des abbayes d'Hélécine, de Flône, d'Hélécine et concernant l'église St Amor de Maastricht, respectivement en 1147, 1154, 1154 et 1157 (voir Camps, ONB I, no. 50, et Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, n° 23, 24 et 28). Dans les chartes décrétées par les abbés de Saint-Trond, de telles formules de sanction ne sont utilisées qu'à partir du milieu du XIIe siècle (voir Van Synghel, DONB, n° 1148.09.23(après 1147.12.24), 1167.09.23(après 1166.12.24), 1175.12.24(après 1174.12.24) et 1186.12.24(après 1185.12.24)). Pour autant que la tradition le permette, Thorn n'a pas reçu de chartes épiscopales de Liège aux XIe et XIIe siècles. Il est toutefois à noter que la charte non datée de Reinwidis (voir Collection Thorn, n° 7, datée, pour des raisons paléographiques, de la fin du XIIe siècle ou du début duXIIIe siècle ) contient le même anathema-sanctio.
Une deuxième observation concerne la datatio : manquent ici, l'année de règne de l'empereur Henri ainsi que l'année d'épiscopat d'Otbert, ce qui n'est pas exceptionnel.
Le fait que la charte actuelle de 1102 soit la plus ancienne mention des nobles seigneurs de Horn et de Kessenich, des décennies avant la suivante, n'est pas un argument pour la déclarer fausse.
Les réflexions précédentes conduisent à la conclusion suivante : la charte de 1102 d'Anselme, homme libre, pour l'abbaye de Thorn peut être considérée comme le produit d'une main inexpérimentée utilisant une forme embryonnaire de la structure en boucle. Cette structure en boucle apparaît des années plus tard, au moins en 1172, dans une version joliment équilibrée dans une charte de l'abbesse de Thorn. L'examen des caractéristiques externes et internes n'a pas révélé d'arguments solides susceptibles d'étayer les soupçons de Venner et de Kersken en matière de fausseté. Le caractère embryonnaire et la main inexpérimentée vont plutôt dans le sens d'une inscription ancienne, du début du 12e siècle. La problématique du sceau reste cependant dans l'indécision. Il n'est pas inconcevable que le sceau, dont le signataire n'a pas été identifié jusqu'à présent, ait été apposé plus tard sur cette charte. Ce n'est toutefois pas une raison pour qualifier la présente charte de falsum.


Numéro 5
Arnold Ier, archevêque de Cologne, atteste que Rudolf de Turri, serviteur du comte Adolf de Saffenberg, avec le consentement de sa femme Waldrade et de ses fils Paganus, Gevehard et Herman, par l'intermédiaire de son seigneur, gérant de l'abbaye de Kloosterrade, a fait don à l'abbaye de ses biens situées à Hubach, sur lesquels a été construit un couvent de femmes (Marienthal). Arnold Ier règle également les relations entre l'abbaye et le couvent-fille.
Arnold Ier, archevêque de Cologne, atteste que Rudolf de Turri, ministériel du comte Adolf de Saffenberg, avec le consentement de sa femme Waldrade et de ses fils Paganus, Gevehard et Herman, par l'intermédiaire de son seigneur, gardien de l'abbaye de Kloosterrade, a fait don à l'abbaye de ses biens à Hubach, sur lesquels un couvent de femmes (Marienthal) a été construit, et règle les relations entre l'abbaye et le couvent de filles.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 675.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 19-22, n° 6, d'après A.
Authenticité
Sur le caractère éventuellement fallacieux de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 5
Le roi romain Koenraad III fait don du pont de la Meuse à Maastricht au chapitre de Maastricht de Saint-Servaas.
Le roi romain Koenraad III fait don du pont de la Meuse à Maastricht au chapitre de Maastricht de Saint-Servaas.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 435.
Sceau : un sceau imprimé, qui a été annoncé, à savoir : S1 du roi romain Cunraad III, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals', no 43.
Copies
B. 25 mars 1282, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 438, insertion dans une charte du roi romain Rodolphe Ier, après A. - C. fin du XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 8v-9v (= nouveau fol. 25v-26v), n° 15, à A. - D. fin du XIIIe siècle, Ibidem. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 8v-9v (= nouveau fol. 25v-26v), n° 15, à A. - D. fin du XIIIe siècle, Ibidem, idem, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 21r-22r (= nouveau fol. 38r-39r), n° 43, à B. - E. XIVe siècle, Ibidem, accès n° 14.B002H, archives Broederschap der kapelanen van Sint-Servaas te Maastricht, 1139-1797, inv. no. 6, copie à A. - F. 1640, Ibidem, idem, inv. no. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 20-21, sous le titre : 15, Donatio pontis Mose Conrardi secundi, après A. - [G]. non disponible, mais connu par H, cartulaire du chapitre de St Servaas à Maastricht = Liber A, fol. 2v. - H. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, p. 147-148, sous le titre : Conrardus, Romanorum rex, concedit canonicis Sancti Servatii omnia iura et emolumenta in pontem supra Mosam quam nostri iuris indubitanter esse constat, 10ma calendas julii, anno 1139, copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier de la ville de Maastricht, d'après A.
Dépenses
a. Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, 49-50, no. 31, d'après A. - b. Hackeng, The Medieval Land Property, 291, no. 64 (incomplet), d'après A. - c. DiBe ID 6101, d'après a.
Références
Voir DiBe ID 6101.
Origine et cohérence
Selon Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, 49, cette charte s'inspire d'une charte papale éditée par Arnoud, chancelier du roi romain Cuncil III, et rédigée par Arnoud A, l'un des notarii travaillant à la chancellerie.
Cette donation a été confirmée par le pape Innocent II en date du 18 décembre 1139, voir Collection du Chapitre de Saint-Servaas, n° 6. Le 17 septembre 1274, le roi romain Rodolphe Ier émit une charte concernant l'entretien du pont de la Meuse, voir Collection du Chapitre de Saint-Servais, n° 39. Le 25 mars 1282, le roi romain Rodolphe Ier confirme et renouvelle la concession du roi romain Coenraad, voir le Recueil du chapitre de Saint-Servais, n° 46. Pour la grâce accordée par quatre archevêques et quinze évêques pour la construction du pont de la Meuse, datée du 29 janvier 1284, et l'approbation de Jean IV (de Flandre), évêque de Liège, datée du 8 mai 1287, voir Collection du Chapitre de Saint-Servais, nos 51 et 57.


Numéro 6
Beatrix, dame de Valkenburg, confirme que Gérard Buc a déclaré devant elle, devant ses serviteurs, devant tous les habitants de Valkenburg et auprès de ses fidèles, que son père, le seigneur Emmo van Klimmen, a fait don au monastère Sint-Gerlach d'une maison avec terrain à Voheim. La maison faisait partie de son patrimoine et a été dûment transférée au monastère à perpétuité.
Beatrix, dame de Valkenburg, a donné mandat à Gérard Buc de déclarer devant elle, devant ses ministres, devant tous les habitants de Valkenburg et devant ses fidèles que son père, le seigneur Emmo de Klimmen, sur ses biens allodiaux , a fait don au monastère Sint-Gerlach d'une maison avec des terres à Voheim et que celle-ci a été dûment transférée dans la possession perpétuelle.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 95, n° de registre 2.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 de Beatrix, dame de Valkenburg, en cire brun clair, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals convent Sint-Gerlach', 156-157.
Copie
Non disponible.
Edition
a. Gerlach, IV, 3-4, no. 2, d'après A.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 67-68, registre n° 2 (daté entre 1228 et 1237). - Idem, Liste chronologique, 38, reg. nr. 67 (daté 1228-1237).
Dates
Cette charte ne peut être datée qu'approximativement. Dans cette charte, Beatrix agit en tant que Dame de Valkenburg après la mort de Dirk I, Seigneur de Valkenburg, au nom de leur fils Dirk, "adhuc puero". Le terminus post quem est la mort de Dirk Ier le 4 novembre 1227. Le terminus ante quem est l'année 1237, lorsque Dirk II apparaît pour la première fois comme seigneur de Valkenburg (voir Venner, 'The first knight's seal', 57, et Corsten, 'Die Herren', 178-181).
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 6
Odilia, abbesse de Thorn, annonce que Godefroy de Heinsberg a transféré la jeune fille Aleid, qui appartenait à l'église de Geilenkirchen, à l'église de Thorn en tant que ministérielle, avec le consentement du curé de Geilenkirchen. En présence de plusieurs témoins et conseillers, Aleid prête serment à l'église de Thorn et fait allégeance à l'abbesse. Si Aleid donne naissance à des enfants, son dernier fils lui succèdera en tant qu'héritier. Si elle n'a pas de fils, ce sera la dernière fille. Tous les autres enfants seront répartis entre l'église de Thorn et Godefroy de Heinsberg.
Odilia, abbesse de Thorn, déclare que Godfrey, seigneur de Heinsberg, a confié la servante Aleid, appartenant à l'église de Geilenkirchen, à l'église de Thorn en tant que ministérielle avec le consentement de Gozewijn, curé de cette église, et que ses enfants seront répartis entre Godfrey et l'église.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Rijksheerlijkheid Thorn, inv. n° 6. Doublé, légèrement endommagé.
Notes au verso : 1o de la main du XIIIe siècle : De censu capitali. - 2o dela main du XVIe siècle : 1172. - 3o de la main du XVIIe siècle : V, k.
Sceau : un sceau apposé à la charte, annoncé, à savoir : S1 de l'abbaye de Thorn, de cire blanche. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals Thorn', 31-33.
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire révisé Thorn, 8-10, n° 4, après A (daté de 1172). - b. Habets, Archives Thorn, 9-10, n° 6 (daté de 1172), à a.
Regest
Haas, liste chronologique, 29, no. 35.
Dates
L'usage du style de Noël dans le diocèse de Liège a été supposé, voir Camps, ONB I, XX, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII. Le terminus ante quem est déterminé par la fin de la cinquième imposition fiscale.


Numéro 6
Arnold Ier, archevêque de Cologne, confirme l'acquisition par l'abbaye de Kloosterrade d'un certain nombre de biens déterminés.
Arnold Ier, archevêque de Cologne, confirme l'acquisition par l'abbaye de Kloosterrade d'un certain nombre de biens déterminés.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 677. Quelques pertes de texte dues à l'usure, surtout sur le côté gauche.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 25-28, n° 8, d'après A.
Authenticité
Sur le caractère éventuellement fallacieux de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.
Édition de texte
Pour l'achèvement des passages endommagés, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 6
Le pape Innocent II confirme la donation du pont de la Meuse à Maastricht par le roi romain Coenraad III au chapitre de Maastricht de Saint-Servais.
Le pape Innocent II confirme le don du pont de la Meuse à Maastricht par le roi Coenraad III au chapitre de Maastricht de Saint Servatius.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 436. Doublé. Légèrement endommagé avec perte de texte.
Notes au verso : 1o de la main du XIIIe siècle: Confirmatio privilegii pontis (complétée par une main postérieure) per Innocentium II. - 2o de la main du XVe siècle: R XXXVII. - 3o de la main du XVIIe siècle: Excopiatum nu. 12 - 4o de la main du XVIIe siècle: In capsula pontificum. - 5o dela main du XVIIIe siècle: 41 Cap. Ia.
Sceau : un seul sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 du pape Innocent II. Pour une description de S1, voir Venner, 'Seals', no. 1.
Copie
B. première moitié du XVIIe siècle (avant 1648), Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 11 (cartulaire) = Cartularium ecclesiae collegialis Sancti Servatii Traiecti ad Mosam, tomus primus, pontificalia et episcopalia, fol. 13r-14r, sous le titre : Pontificalia, et sous la rubrique : Innocentius 2 confirmat donationem pontis cum illius reficiendi obligatione et reliqui fructus inter prepositum et fratres divisione ac administrationis paritate, copie certifiée conforme par Hendrik Lenssens, secrétaire du chapitre et notaire public, autorisé par le Conseil de Brabant, à A.
Dépenses
a. Schaepkens, "Archives", 171-172, d'après B. - b. Willemsen, "Inventaire", 164-165, n° 4, d'après A. - c. Hackeng, La propriété foncière médiévale, 292, n° 64b (incomplet), d'après A.
Références
Wauters, Table chronologique II, 212. - Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, 892, n° 8064. - Doppler, 'Collection', 243-244, n° 43.- Haas, Liste chronologique, 23-24, n° 17. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 100, n° 436. - DiBe ID 8241.
Cohérence
Pour la donation du pont de la Meuse par le roi romain Cunraad III, voir Collection de Saint-Servaas, n° 5. Le 17 septembre 1274, le roi romain Rodolphe Ier émit une charte concernant l'entretien du pont de la Meuse, voir Collection du Chapitre de Saint-Servaas, n° 39. Pour l'indulgence de quatre archevêques et quinze évêques pour la construction du pont de la Meuse, datée du 29 janvier 1284, et l'approbation de Jean IV (de Flandre), évêque de Liège, datée du 8 mai 1287, voir Collection du Chapitre de Saint-Servais, nos 51 et 57.

Numéro 7
Jan, l'administrateur, et le couvent du monastère de Sainte-Marie à Heinsberg font savoir au maître et au couvent de Sint-Gerlach à Houthem qu'ils sont traditionnellement liés l'un à l'autre par la piété et la foi et que, en partie à cause de cela, ils accompliront les services commémoratifs dus aux frères et sœurs de leur communauté, tant clercs que laïcs. Ils s'abstiendront de le faire si les deux monastères y voient une objection ou ont stipulé par écrit que ce serait trop dangereux.
John, prévôt, et le couvent du monastère (de St Mary) à Heinsberg annoncent au magister et au couvent de Sint-Gerlach (à Houthem) qu'ils sont traditionnellement associés et feront les services commémoratifs habituels pour les frères et sœurs, clercs et laïcs, de leur communauté, sauf si les deux ont convenu et consigné par écrit que cela est trop onéreux et dangereux.
Original
[A]. Non disponible.
Copies
[B]. avant 1735, non disponible, mais connu par la section dans C. - C. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archives klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = "Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach", p. 357, sous la section : Copia literarum amplissimi domini Ioannis, prepositi de Heinsbergh, et en marge : Num. 217, sans indication de l'apposition du sceau, à [B].
Edition
Non publié auparavant.
Dates
On suppose que les évêques de Liège sont passés du style de Noël au style pascal vers 1230 et que les institutions religieuses du diocèse ont suivi quelque temps plus tard, voir Camps, ONB I, XXI.Par conséquent, l'utilisation du style pascal a été supposée pour la datation de cette charte.


Numéro 7
Reinwidis of Übach annonce qu'elle a été donnée jadis par ses parents à l'autel de Notre-Dame de Thorn en vertu du droit suivant : ses fils verseront une certaine somme d'argent à cet autel chaque année le 11 novembre, ses filles verseront une somme par l'intermédiaire d'un parent masculin de leur choix ; elles paieront également pour être autorisées à se marier sans la charge ou l'intervention d'un tuteur ; à leur mort, elles fourniront un très bon animal quadrupède de leur propriété pour le droit d'"afliph". S'il n'est pas possible de fournir un quadrupède de leur propriété, ils donneront un vêtement dûment porté. Pour tous ceux qui enfreignent cette charte, l'excommunication est imminente.
Reinwidis d'Übach Déclare qu'elle et ses descendants sont redevables du droit d'accise et de l'inspection à l'abbaye de Thorn.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 7.
Annotation au verso : 1ode la main du XVIe siècle: Littera certa ( ?) de Vbach Regewidis de curmede et ut sue posteri nubere possent. - 2o de la main du XVIIe siècle: J barré, V. - 2o de la main du XVIIIe siècle : Littera Regewidis quod posteri eius nubere possent.
Sceau : un seul point d'attache, probablement pour le sceau annoncé de l'abbaye de Thorn (LS1).
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire révisé Épine, 11, n° 6 (daté du XIIe siècle), d'après A. - b. Habets, Archives Épine, 10, n° 7 (daté du XIIe siècle), d'après a.
Regest
Haas, liste chronologique, 33, no. 50.
Dates
La présente charte n'a pas été datée. Franquinet, suivi par Habets, a daté cette charte du XIIe siècle sans autre argumentation. D'un point de vue paléographique, elle peut être datée de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Le document présente un caractère informel en raison de l'utilisation d'un petit morceau de parchemin découpé de façon oblique, d'une mise en page peu soignée et d'un interlignage irrégulier. En outre, les mots sont éradiqués et superposés. La charte n'est pas rédigée en minuscule diplomatique, comme c'était souvent le cas au XIIe siècle, mais présente un certain nombre de caractéristiques de l'écriture gothique (grattages, d inclinés) avec un caractère quelque peu posé. Ce dernier se reflète également dans l'utilisation de majuscules dans les mots Marie et Martini.
La comparaison de cette écriture avec les chartes limbourgeoises jusqu'à environ 1240 a montré que ce type d'écriture n'apparaît pas avant le tournant du douzième au treizième siècle. Une écriture très similaire a été trouvée dans une charte de l'abbé de Kloosterrade datant de la période du 25 décembre 1201 au 30 avril 1211 (Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 846) et dans une charte de Lothaire, comte de Hochstaden, concernant des dîmes à Noorbeek et à 's-Gravenvoeren datant de 1204 (Ibidem, n° d'accès 14.D022, archives des Jésuites de Maastricht, inv. n° 55). Il est donc vraisemblable que cette charte date de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle.


Numéro 7
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
Apparemment original
<A>. Maastricht, HCL, toegangsnr. 14.D004, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 782.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 43-46, n° 14, d'après A.
Authenticité
Cette charte est sans aucun doute fallacieuse et a vu le jour quatre ou cinq siècles plus tard, voir l'édition de Polak et Dijkhof.
Édition de texte
L'utilisation fréquente du o supérieur sur u ou v n 'a pas été adoptée.


Numéro 7
Siegfried, doyen, et les chanoines du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht mettent Marsilius, abbé de Saint-Gillis sur le Publémont à Liège, en possession de neuf arpents près du village d'Aaz et trois sabots à Aaz, de sorte que l'abbaye en a la possession héréditaire tant que l'abbé n'enfreint pas les conditions établies.
Siegfried, doyen, et les chanoines du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht mettent Marsilius, abbé de Saint-Gillis sur le Publémont à Liège, en possession de neuf arpents près du village d'Aaz et trois sabots à Aaz, de sorte que l'abbaye en a la possession héréditaire tant que l'abbé n'enfreint pas les conditions établies.
Original
[A]. Non disponible.
Copie
B. simultanément, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1707, inv. n° 306, très abîmé, à [A].
Dépenses
a. Habets, "Codex diplomaticus", 31-33, n° 37 (daté de 1173), à B. - b. Flament, "The State Archives", 434-435 (daté de 1173), à B. - c. Hackeng, The Medieval Land Property, 300-301, n° 78 (incomplet) (daté de 1173), à B.
Références
Doppler, " Collection ", 250-251, n° 51 (daté de 1173). - Haas, Liste chronologique, 29-30, n° 36 (daté de 1173). - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 86, n° 306 (daté de 1173). - DiBe ID 10985 (daté de 1173).
Dates
L'usage du style de Noël dans le diocèse de Liège est supposé. Le terminus ante quem est en outre déterminé par la fin de la sixième indication spécifiée, qui court jusqu'au 23 septembre 1173.
Origine
Le vélin de la présente charte est très abîmé et les trois dernières lignes sont écrites autour d'un grand creux circulaire. Des traces d'un autre texte ont été observées dans ce renfoncement à l'aide d'une lampe à quartz, ce qui indique que le parchemin a été réutilisé. Il est fort probable que le chapitre de Saint-Servaas ait produit une copie presque simultanément pour ses propres registres de loyers. Flament, "The State Archives", 434, considère le document mentionné sous B comme l'original, plus précisément comme un renversement de l'accord avec l'abbaye de Saint-Gillis sur le Publémont à Liège. Dans ce cas, il aurait dû être au nom de l'abbaye liégeoise. Il signale également un sceau jeté, mais aucune trace de cire n'a été trouvée sur le parchemin. Il est vrai qu'une partie du texte de la charte est écrite autour de la niche, ce qui pourrait indiquer l'application d'un sceau imprimé, mais il n'y a pas de coupe disponible ou de morceau de parchemin pour y attacher le sceau. Il est donc peu probable que cette charte ait jamais été scellée. Le texte de la charte n'annonce pas non plus de scellement. Il est donc évident qu'il s'agit d'une copie contemporaine du chapitre de Saint-Servaas.
Edition de texte
Les lacunes dans B ont été comblées dans l'édition de Flament, qui est meilleure que celle de Habets.



Numéro 8
Dirk II, seigneur de Valkenburg, a vendu à l'administrateur et au monastère de Sint-Gerlach à Houthem sa forêt de Vorbusde, située dans son fief de Houthem, et a fait don d'une partie du prix d'achat au monastère.
Dirk II, seigneur de Valkenburg,a venduà la prévôté et au monastère de Sint-Gerlach (à Houthem) sa forêt Vorbusde, situéedans l'allodium de Houthem, et a fait don d'une partie du prix d'achat au monastère.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 40, n° de registre 7.
Notes au verso : 1° par une main du XIIIe siècle : Littera de silva monasterii.- 2° par une main du dernier quart du XIVe siècle : A j. - 3° par une main du XVIIe siècle : 1241.- 4° d'une main du XVIIIe siècle : Num. 62.
Sceau : deux sceaux joints, annoncés, à savoir : S2 de Dirk II, seigneur de Valkenburg, de cire verte, endommagé, avec CS2, endommagé. - S4 de Gozewijn Dukere, en cire brun clair, endommagé ; et deux pièces jointes aux sceaux annoncés d'Alard de Haasdal, chevalier, et d'Adam de Borgharen, chevalier, (LS1) et (LS3). Pour une description et une illustration de S2, CS2 et S4, voir Venner, "Seals monastery Sint-Gerlach", respectivement 157 et 160.
Copies
[B]. avant 1506, copie authentique, non disponible, mais connue par [C], après A. - [C]. 1506, non disponible, mais connu par F, registre du monastère de Sint-Gerlach à Houthem, qui donne par erreur la date du 13 mars 1241, à [B]. - D]. avant le 6 mai 1594, non disponible, mais connu par [E], transcription authentique par le monastère de Sint-Gerlach à Houthem au profit du Conseil du Brabant, probablement à [B]. - [E]. 6 mai 1594, non disponible, mais connu par F, charte de Philippe II, roi d'Espagne, dans laquelle la charte ci-dessous est inscrite, à [D]. - F. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) ="Privelegien ende register der obligatien en andere erfffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach", p. 100-104, sous le titre : Confirmatio donationis piscature et venationis de anno 1594, et en marge : Num. 62, à [E].
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 9-10, no. 6 (daté de 1241 mars), d'après A..
Références
Haas, Inventaire Sint-Gerlach, 69-70, reg. no. 7 (daté de 1241 mars). - Idem, Liste chronologique, 43, n° de registre 84 (daté de 1241 mars).
Dates
L'utilisation du style pascal dans le diocèse de Liège a été supposée, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII. Comme le mois de mars de l'année pascale 1241 s'étend du 1er au 30 mars, et que le 31 mars tombe en 1242, les deux datations 1-30 mars 1241 et 31 mars 1242 sont possibles.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 8
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, avec l'accord de leurs confrères chanoines et les ministériels, pour lutter contre les usuriers, ont trouvé l'arrangement suivant pour payer leurs grosses dettes causées par les incendies, les tempêtes et les vols et ceci pour une période de huit ans. Pour le remboursement des dettes, les revenus des fermes de Baarle et de Gilze seront réservés dîmes incluses. Sont exceptées, les dépendances, ainsi que les dîmes de Hemert et d'Avezaath. Pour les distributions aux moniales, sont attribués : les fermes de Thorn (à l'exclusion de la petite dîme de Thorn), Neer et Eisden, les accises et la gestion d'Oeteren, les champs d'Übach avec la dîme, les biens de Bergeijk et l'île en face de Wessem ; les droits féodaux et le droit de mainmorte des fermes de Neer et d'Eisden. Attribution à l'abbesse : la petite dîme de Thorn (sans les dîmes des dépendances), les dépendances et les droits féodaux et le droit de mainmorte des fermes de Baarle et Gilze, la ferme d'Oeteren sans les accises et gestion, la ferme de Grathem.
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn destinent pour une période de huit ans les revenus d'un certain nombre de biens, dont les cours avec les dîmes de Baarle et de Gilze et les dîmes de Hemert et d'Avezaath, à l'acquittement des dettes et ils se répartissent l'administration des biens.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 13.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 217-219, no. 973, d'après A.


Numéro 8
Henri II, évêque de Liège, confirme la donation par Adelheid, épouse de Reinier van Beek, de l'église de Spaubeek avec la totalité de la dîme et les dos et deux fermes de douze acres à l'abbaye de Kloosterrade.
Henri II, évêque de Liège, confirme la donation par Adelheid, épouse de Reinier van Beek, de l'église de Spaubeek avec la totalité de la dîme et les dos et deux fermes de douze acres à l'abbaye de Kloosterrade.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 817.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 47-49, n° 16, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 8
Un accord est annoncé dans le cadre d'un litige entre les chanoines du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht et l'abbaye de Siegburg au sujet de la dîme de Güls.
Un accord est annoncé dans le cadre d'un litige entre les chanoines du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht et l'abbaye de Siegburg au sujet de la dîme de Güls.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 338.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle: Item de Gulse, ajouté par une autre main: et Sybergense, XXXIII. - 2o de la main du XVIe siècle: P XVI / N I II. - 3o de la main du XVIIIe siècle: Contractus inter abbatem Siburgensem et capitulum Traiectense de quinque caratis vini / B10 / 1189.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, non annoncé, à savoir : S1 de l'abbaye de Siegburg, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals', no 39.
Copies
B. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 16r-16v (= nouveau fol. 33r-33v), n° 33, d'après A. - [C]. non disponible, mais connu d'après D, cartularium du chapitre de Saint-Servace à Maastricht = Liber A, fol. 70. - D. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, p. 210, sous le titre : Transaction tusschen het capittel van St. Servaes ende de moniken van het clooster Cibryen, waerbij voorg. closter cedes haere tyndens soe van lant, weyden, wyngaerdens als van de beesten, gehoorende onder de parochie van Gulsen waergens waarvoor het capittel jaarlijkslycs sal geven vyff caratteren wijn van haar gewasch, niet van den besten, noch niet van den slechtchsten, de 7 indictie 1189, copie de G.J. Lenarts, secrétaire de la ville de Maastricht, peut-être d'après [C].
Edition
a. Hackeng, The medieval land tenure, 304, n° 87 (incomplet) (daté de 1189), d'après A.
Références
De Borman, " Notice ", 25 (daté de 1189) - Doppler, " Collection ", 254-255, n° 58 (daté de 1189). - Haas, Liste chronologique, 32, n° 44 (daté de 1189). - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 90, n° 338 (daté de 1189). - DiBe ID 6187 (daté de 1189).
Dates
L'utilisation du style de Noël dans le diocèse de Liège et l'archevêché de Cologne a été supposée, voir Camps, ONB I, XX, Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII, et Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, XVI. Le terminus ante quem est déterminé par la fin de la septième indication donnée, qui court jusqu'au 23 septembre.
Origine et cohérence
Un renversement de cette charte a été produit au nom de l'abbaye de Siegburg et des chanoines du chapitre de St Servaas à Maastricht, avec la même date. Cette charte a survécu dans son original et est conservée dans le Landesarchiv à Duisburg, NRW Abteilung Rheinland, AA 0504 /Siegburg, Urkunden, no. 63. Pour une édition de ce renversement, voir Beyer, Eltester et Goerz, Urkundenbuch, 132, n° 95 (daté de 1189) et Wisplinghoff, Urkunden Siegburg, 168-169, n° 77. Selon Wisplinghoff, les deux originaux ont été écrits de la même main. Pour la reconnaissance par l'abbé de Siegburg du droit à la dîme de Güls, datée du 4 novembre 1263, voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 23.


Numéro 9
Les échevins de Maastricht annoncent l'accord concernant le litige sur les biens du chevalier Godefroy de Heer, entre d'une part l'administrateur et l'ensemble du couvent de Sint-Gerlach à Houthem et d'autre part Wolter van Mesch, citoyen de Maastricht, Jutta et Mathilde, petites-filles de Godefroy de Heer, et leur tuteur Leonius. Les parties sont convenues, en présence des échevins de Maastricht, du bourgmestre et des échevins de Heer et des parents et amis de Jutta et Mathilde, que l'administrateur et le couvent de Sint-Gerlach recevraient en propriété hériditaire, parmi les biens litigieux, cinq hectares de terre arable, appartenant à la ferme de Heer. Wolter van Mesch, tuteur de Leonius, et Mathilde, mère de Jutta et Mathilde, ont renoncé auxdits cinq hectares de terre arable en faveur de l'administrateur et du couvent. L'administrateur et le couvent renoncent à leur tour, en faveur de Wolter, Jutta et Mathilde, à tous les autres biens de Godefroy de Heer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Maastricht.
Les échevins de Maastricht certifient concernant le litige sur les biens de Godfried van Heer, chevalier, entre le prévôt et le couvent de Sint-Gerlach (à Houthem) d'une part et Wolter van Mesch, citoyen de Maastricht, Jutta et Mathilde, filles d'Adam, fils de Godfried van Heer, et leur tuteur Leonius, d'autre part, que devant eux, le bourgmestre et les échevins de Heer et les parents et amis de Jutta et Mathilde ont convenu que la prévôté et le couvent de Sint-Gerlach auront des biens litigieux cinq bunder de terre arable, dépendant de la cour de Heer, selon le droit héréditaire. Wolter, Leonius et Mathilde, mère de Jutta et Mathilde, ont renoncé auxdits cinq acres au profit du prévôt et du couvent, et le prévôt et le couvent ont à leur tour renoncé au profit de Wolter, Jutta et Mathilde à tous les autres biens de Godefroy de Heer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Maastricht.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 34, n° de registre 8. Ligné.
Notes au verso : 1o d'une main du XIIIe siècle : Littera de Heer. - 2o par une main du dernier quart du XIVième siècle : X. - 3o par une main du XVIIième siècle : 1253. - 4o d'une main du XVIIIième siècle : Litere Godefridi de 5 bonnariis in Here, num. 75.
Scellés : quatre scellés suspendus, doublement percés, annoncés, à savoir : S1 de Godfried Dives, échevin de Maastricht, de cire blanche, endommagé. - S2 de Manegold, échevin de Maastricht, de cire blanche, endommagé. - S3 de Godfried, fils de Lady Osa, échevin de Maastricht, de cire blanche, abîmée. - S4 de Boudewijn de Molendino, échevin de Maastricht, en cire blanche, endommagée. Pour une description de S1, S2, S3 et S4, voir Venner, " Seals convent Sint-Gerlach", 160-162.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 121-122, sous le titre : Litere Godefridi de 5 bonnariis terre arabilis de Lord hereditarie possidendis, et en marge : Num. 75, donnant quatre lieux de scellement, d'après A.
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 10-12, no. 7 (daté avril 1253), d'après A. - b. Nève, Les chartes d'échevins du treizième siècle, 3-4, no. 1253.04.00 (avec traduction), (datées avril 1253), d'après A.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 70, n° de registre 8. (daté d'avril 1253). - Idem, Liste chronologique, 48, reg. n° 101 (daté d'avril 1253).
Dates
L'utilisation du style pascal dans le diocèse de Liège a été supposée, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII. Comme l'année pascale 1253 s'étend du 18 mars 1253 au 10 avril 1254, les deux datations 18-30 avril 1253 et 1-9 avril 1254 sont possibles.
Origine
L'écriture de la présente charte présente des similitudes avec celle de la charte de Dirk II, seigneur de Valkenburg, datée de 1254.07.05, ainsi qu'avec celle qui, quatre ans plus tard, a frappé deux chartes pour le monastère Sint-Gerlach, voir infra nos. 10, 13 et 14. Ces originaux présentent également la même mise en page : le scribe n'a pas écrit le texte de la charte sur l'anneau de la ligne appliquée, mais bien au-dessus de ces lignes.


Numéro 9
Henri IV, duc de Limbourg et comte de Berg, annonce que l'abbesse et le couvent de l'abbaye de Thorn ont cédé à Jan, clerc de Körrenzig et chanoine de Liège, une ferme située à Drinhausen. Jan a payé cette ferme, ce qui lui permet d'en disposer librement tant qu'il vivra. Après sa mort, ses biens écherront à Thorn, exempts d'impôts.
Henri IV, duc de Limbourg et comte de Berg, annonce que l'abbesse et le couvent de Thorn ont cédé à Jan, religieux de Körrenzig et chanoine de Liège, pour la durée de sa vie, une ferme à Drinhausen.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 14.
Notes au verso : 1ode la main du 13e siècle: De curte de Drinhusen. - 2o de la main du XVIe siècle : Donatio, 1235. - 3o de la main du XVIIe siècle : J, V.
Sceau : un sceau pendant, apposé et annoncé, à savoir : S1 d'Henri IV, duc de Limbourg et comte de Berg, de cire blanche, endommagé ; avec contre-sceau endommagé CS1. Pour une description et une illustration de S1 et CS1, voir Venner, 'Seals Thorn', 38-39.
Copie
B. première moitié du XVe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 01.187B, archives Royaume libre de Thorn, inv. n° 1628 (anciennement cartularium n° 1) = Cartularium abbatiae imperialis Thorensis, 966-1600, p. 97 (ancien fol. 53r), sous la rubrique : E, De censu in Bergheyke, d'après A.
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire révisé Thorn, 13-14, n° 8 (daté de 1235 décembre), à B. - b. Habets, Archives Thorn, 13-14, n° 14 (daté de 1235 décembre), à A.
Regest
Haas, Liste chronologique, 43, n° 83 (daté de 1235 décembre).
Dates
On suppose que les évêques de Liège sont passés du style de Noël au style de Pâques vers 1230 et que les institutions religieuses du diocèse de Liège n'ont suivi que plus tard, voir Camps, ONB I, XXI. Par conséquent, la datation de la présente charte supposel'utilisation du style de Noël. Il n'est pas évident que cette charte ait vu le jour dans le voisinage du chancelier, le duc de Limbourg, puisque Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, XVI-XVII, affirment qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'une chancellerie ducale à cette époque. Pour les chartes de la période 1200-1230, ils ont supposé l'utilisation du style de Noël dans les chartes ducales. Si la présente charte provient bien de l'entourage du duc de Limbourg et qu'elle est datée d'après le style pascal, elle doit dater de la période allant du 1er au 31 décembre 1235.


Numéro 9
Arnold Ier, archevêque de Cologne, confirme l'abbaye de Kloosterrade dans la possession de biens à Bornheim, transférés par Jan de Bornheim, à Ameln, de biens achetés à l'abbé Folmer de Lonnig et à d'autres, et de biens à Niedermerz donnés par Werner Rufus de Niedermerz.
Arnold Ier, archevêque de Cologne, confirme l'abbaye de Kloosterrade dans la possession de biens à Bornheim, transférés par Jan de Bornheim, à Ameln, de biens achetés à l'abbé Folmer de Lonnig et à d'autres, et de biens à Niedermerz donnés par Werner Rufus de Niedermerz.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 778.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 49-51, n° 17, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 9
Guillaume, archidiacre de Trèves, déclare que Guillaume, tuteur de Chiny, a donné le droit de patronage de l'église de Jamoigne à l'abbaye d'Orval et que Blihard, chanoine de Reims et curé de Jamoigne, frère du tuteur de Chiny, a transféré ses droits à l'abbaye.
Guillaume, archidiacre de Trèves, déclare que Guillaume, tuteur de Chiny, a donné le droit de patronage de l'église de Jamoigne à l'abbaye d'Orval et que Blihard, chanoine de Reims et curé de Jamoigne, frère du tuteur de Chiny, a transféré ses droits à l'abbaye.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 1791. Doublé.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle XVII. - 2o de la main du XVIIe siècle: Pro patronatu et investitura ecclesie de Jamoigne. - 3o de la main du XVIIIe siècle: Jamoigne 1193.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 de Guillaume archidiacre de Trèves, de cire rouge, sans défaut. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals', no. 17.
Copie
Non disponible.
Dépenses
a. Goffinet, Cartulaire, 110-111, n° LXXI (incomplet) (daté de 1193), d'après une copie dans un cartulaire de l'abbaye d'Orval. - b. DiBe ID 2465 (daté de 1193), d'après un.
Références
Wauters, Table chronologique VII, 386 (daté de 1193). - Tandel, "Les communes luxembourgeoises", 437, n° 8 (daté de 1193). - Haas, Liste chronologique, 32, n° 46 (daté de 1193). - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 186, n° 1791 (daté de 1193).
Dates
L'utilisation du style de message utilisé dans l'archidiocèse de Trèves a été supposée, voir Strubbe et Voet, Chronologie, 54.
Edition de texte
La distinction entre c et t n 'est pas évidente.


Numéro 10
Dirk II, seigneur de Valkenburg, donne à l'administrateur et au couvent du monastère Sint-Gerlach à Houthem neuf arpents de terre à Hatersbruc et quatre arpents dans son fief à Houthem, ainsi qu'une cession de quinze shillings de Liège. Le monastère lui devait ce paiement en raison d'un don antérieur de quatre marks. Dirk stipule également que le monastère est tenu d'allouer chaque année un mark de ces dons pour le service commémoratif de l'anniversaire du décès de son épouse Berta et trois marks pour la célébration perpétuelle d'une messe quotidienne pour les défunts.
Dirk II, seigneur de Valkenburg, fait don au prévôt et au couvent de Sint-Gerlach de neuf bunder de terre à Hatersbruc, de quatre dans son allodium à Houthem et d'une taxe liégeoise de quinze shillings que le couvent lui doit pour une donation antérieure de quatre marks. Il stipula également que le monastère était tenu d'allouer chaque année un mark de cette somme pour la pitance à l'anniversaire annuel de son épouse Berta et trois marks pour la célébration perpétuelle d'une messe quotidienne à l'intention de la défunte.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 152, n° de registre 9. Ligné.
Notes au verso : 1° d'une main du dernier quart du XIVe siècle : Littera de IX bonuaria terre et de IIII bonuaria etcetera. - 2° par une main du dernier quart du XIVe siècle : L j. - 3° par une main du XVIIe siècle : 1254. - 4° par une main du 18ème siècle : Num. 70.
Sceau : trois sceaux apposés pendants, doublement percés, annoncés, à savoir : S1 de Dirk II, seigneur de Valkenburg, de cire brune, endommagé, avec CS1, endommagé. - S2 d'Engelbert (de Valkenburg), archidiacre de Liège, de cire verte, endommagé. - S3 d'Alard de Haasdal, chevalier, en cire brune, sans défaut ; et deux montures, probablement pour les sceaux annoncés de Gozewijn Dukere, chevalier, et Adam de Borgharen, chevalier, (SD4 et SD5). Pour une description et une illustration de S1, S2 et S3, voir Venner, "Seals monastery Sint-Gerlach", respectivement 158, 150-151 et 160.
Copie
B. 1736, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 115-116, sous le titre : Littere Theodorici, domini de Valckenburgh, de novem bonnariis terre et quatuor (corrigé d'après d'autres lettres) iacentibus in Hatersbruc et in Holtheijm, et en marge : Num. 70, indiquant cinq lieux de scellement, à A.
Edition
a. Gerlach, IV, 12-13, no. 8, d'après A.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 70-71, reg. nr. 9. - Idem, Liste chronologique, 48, reg. nr. 102.
Origine
La main du scribe de la présente charte ressemble à celle d'une charte échevinale de Maastricht de 1254 concernant un litige impliquant le prévôt et le couvent de Sint-Gerlach , ainsi qu'à celle qui, quatre ans plus tard, a frappé deux chartes pour le monastère Sint-Gerlach, voir infra nos 9, 13 et 14. Ces originaux présentent également une mise en forme caractéristique identique : le scribe a écrit le texte de la charte non pas sur l'anneau de ligne appliqué, mais bien au-dessus de ces lignes.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.

Numéro 10
Hildegonde, abbesse, et le chapitre de Notre-Dame de Thorn transfèrent à l'unanimité la dîme de Hemert et les revenus d'Avezaath en bail perpétuel à l'abbé et au couvent de l'abbaye Saint-Paul d'Utrecht, moyennant une rente annuelle, à remettre le 1er mai dans l'église de Thorn. En outre, l'abbé reçoit de l'abbesse de Thorn l'église de Hemert avec la dîme, les biens et les autres revenus qui appartiennent maintenant au presbytère.
Hildegonde, abbesse, et le chapitre de Notre-Dame de Thorn donnent à l'abbé et au couvent de l'abbaye Saint-Paul d'Utrecht la dîme de Hemert et les revenus d'Avezaath contre une rente perpétuelle annuelle de six marks de Cologne et stipulent que l'abbé de l'abbaye Saint-Paul sera propriétaire des revenus du personnat après la mort du curé de Hemert.
Original
[A]. Non disponible, mais connu de B.
Copie
B. 1269 25 mars, Maastricht, HCL, n° d'accès 01.187A, archive Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. n° 16, vidimus par Amelis, doyen, et Steven, doyen de l'église Saint-Pierre d'Utrecht, à [A].
Edition
a. Heeringa, OSU II, 312-313, n° 909, d'après B.
Cohérence
Pour le vidimus du doyen et du doyen de l'église Saint-Pierre d'Utrecht daté du 25 mars 1269, voir Collection Thorn, n° 29.


Numéro 10
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de overbrenging van de kloosterzusters vanuit de abdij Kloosterrade en vanuit Scharn naar Sinnich, de dotatie van een nieuw vrouwenconvent aldaar met goederen die evenwel eigendom van de abdij blijven, alsmede de onderhorigheid van dat convent aan de abdij.>
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de overbrenging van de kloosterzusters vanuit de abdij Kloosterrade en vanuit Scharn naar Sinnich, de dotatie van een nieuw vrouwenconvent aldaar met goederen die evenwel eigendom van de abdij blijven, alsmede de onderhorigheid van dat convent aan de abdij.>
Apparemment original
<A>. Maastricht, HCL, toegangsnr. 14.D004, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1700.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 56-60, n° 20, d'après A.
Authenticité
Cette charte est sans aucun doute fallacieuse et a vu le jour quatre ou cinq siècles plus tard, voir l'édition de Polak et Dijkhof.
Édition de texte
L'utilisation fréquente du o supérieur sur u ou v n 'a pas été adoptée .


Numéro 10
L'empereur Frédéric II prend l'église Saint-Servaas de Maastricht sous sa protection et confirme tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs.
L'empereur Frédéric II prend l'église Saint-Servaas de Maastricht sous sa protection et confirme tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 47. Endommagé sans perte de texte.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 de l'empereur Frédéric II, en cire brune, sans défaut. Pour une description et une illustration du sceau, voir Venner, "Seals", n° 44.
Copies
B. 1273 1er novembre, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 54, insertion dans une charte du roi romain Rodolphe Ier, d'après A. - C. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 10r-11r (= nouveau fol. 27r-28r), n° 18, d'après B.
Dépenses
a. Koch, Die Urkunden Friedrichs II, 284-286, n° 313, d'après A. - b. Hackeng, The Medieval Land Property, 309-310, n° 96a (incomplet), d'après A. - DiBe ID 15320, d'après a.
Références
Voir Koch, Die Urkunden Friedrichs II, 285, et DiBe ID 15320.
Origine et cohérence
Dans la présente charte, certaines parties du texte sont reprises de la charte d'Henri V de 1109, voir Collection de Saint-Servaas, n° 3. Pour les parties du texte reprises de cette charte préliminaire et imprimées en caractères plus petits, voir Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 76. Il s'agit également de la préface de la charte du roi romain Henri VII datée du 9 mai 1222, voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 12. La présente charte est également inscrite dans la charte du roi romain Rodolphe Ier datée du 1er novembre 1273, voir Collection du chapitre de Saint-Servais, n° 36. Selon Koch, Die Urkunden Friedrichs II, 285, le scribe de la présente charte n'est pas connu, mais la dictée peut être attribuée à un scribe anonyme de la chancellerie impériale, Anonymus J.

Numéro 11
Wolter, Supérieur des Frères Mineurs à Maastricht, promulgue une charte concernant un legs du Chevalier Gérard de Scherwier au Chevalier Adam de Nuth concernant le paiement de 30 marks provenant de biens acquis illégalement.
Wolter, gardian (des frères mineurs) à Maastricht, crée une charte concernant les biens acquis illégalement par Gérard van Scherwier, chevalier, à l'occasion de sa donation de 30 marks que Adam van Nuth, chevalier, lui devait. (Deperditum)
Original
Non disponible.
Copie
Non disponible.
Notice
Cette charte est connue par la dispositio d'une charte de Gérard de Scherwier, chevalier, voir infra nr. 12, où la présente charte est mentionnée . sub tali forma quod si bona mea iniuste acquisita, que plenius invenientur in litera quam Wolterus, gardianus Traiectensis, super ordinationem mee legationis conscripsit de triginta marcis quasAdam, miles, de Nutte debet mihi, persolvi enim poterunt de proventibus fructuum terre prenominate, persolvuntur de anno in annum quoadusque secundum tenorem dicte litere competenter fuerint persoluta.
Edition
Non publié auparavant.


Numéro 11
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, craignant des taux d'intérêt accablants, ont décidé à l'unanimité de vendre à Godfried, seigneur de Breda, la somme d'argent qu'ils perçoivent chaque année au début du mois d'octobre, provenant de l'argent des fermes de Baarle et de Gilze. Si Godefroi ne reçoit pas les revenus au moment convenu, il recevra leurs gages et réclamera la compensation conformément au jugement des échevins. Robert, évêque de Liège, et Henri, duc de Lorraine et de Brabant, approuvent cette vente par une charte.
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, avec la permission de l'évêque de Liège et du duc de Brabant, vendent à Godefroi IV, seigneur de Breda, cinq marks de Cologne sur les cijns dus annuellement à l'abbaye par les usagers des terres des cours de Baarle et de Gilze.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187B, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. prél. no. 2218.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 262-264, no. 995, d'après A.


Numéro 11
Henri II, évêque de Liège, confirme la donation de l'église de Lommersum avec l'ensemble des dos, familia et dîmes par les descendants de Jutta, épouse du duc Walram II de Limbourg, à l'abbaye de Kloosterrade, église qui avait été transférée à l'abbaye par Jutta lors de son entrée dans les ordres.
Henri II, évêque de Liège, confirme la donation de l'église de Lommersum avec l'ensemble des dos, familia et dîmes par les descendants de Jutta, épouse du duc Walram II de Limbourg, à l'abbaye de Kloosterrade, église qui avait été transférée à l'abbaye par Jutta lors de son entrée dans les ordres.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 802, 1.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 60-63, n° 21, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 11
Otto (van Everstein), prévôt du chapitre Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle et du chapitre Saint-Servatius de Maastricht, fait don au chapitre Saint-Servatius du droit de patronage de l'église Saint-Jean de Maastricht.
Otto (van Everstein), prévôt du chapitre Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle et du chapitre Saint-Servatius de Maastricht, fait don au chapitre Saint-Servatius du droit de patronage de l'église Saint-Jean de Maastricht.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 816.
Notes au verso : 1o de la main du XIIIe siècle: De ecclesia Sancti Iohannis. - 2o de la main du XVIe siècle: 1218 / g II. - 3o de la main du XVIIe siècle: [***] dedit [***]. - 4o de la main du XVIIe siècle: In capsula fab[rice] excopiata numero 7. - 5ode la main du XVIIIe siècle: 1218 mense iulio. - 6o de la main du 18e siècle: 16.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 d'Otto, prévôt du chapitre de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle et du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht, en cire brune, endommagé. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals', no 30.
Copies
B. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 16v (= nouveau fol. 33v), n° 24, d'après A. - C. 1640, Ibidem, idem, inv. n° 1741 (cartulaire) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex iurium. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 27, sous le titre : 21, Otto, prepositus, declarat ecclesiam Sancti Ioannis spectare ad capitulum, après A. - D. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 95r, sous le titre : [Otto, prepositus, declarat ecclesiam Sancti Ioannis spectare ad capitulum] : [Otto, prepositus, cedit ius patronatus ecclesie de Sancti Iohannis Baptiste anno 1218, vide folio 93, peut-être après A. - [E]. non disponible, mais connu de F, cartulaire du chapitre de Saint Servatius à Maastricht = Liber A, fol. 68v. - F. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, p. 236, sous le titre : Otto, prepositus Sancti Servatii confert capitulo libere et absolute ius patronatus ecclesie Sancti Ioannis Baptiste in Traiecto, 8 juillet 1210, après [E].- G. avant 1768, Ibidem, idem, fol. 248, sous le titre : Otto, prepositus Sancti Servatii declarat ecclesiam Sancti Ioannis spectare ad capitulum Sancti Servatii, mense iulii 1218.
Edition
a. Teichmann, ˈAachen', 106, no. 1, d'après A.
Références
Willemsen, "Inventaire", 167, n° 6. - De Borman, "Avis", 28. - Habets, "Codex diplomaticus", 37, n° 52. - Wauters, Table chronologique III, 681. - Doppler, 'Collection', 263, no. 76. - Haas, Liste chronologique, 35, n° 57. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 149, n° 816. - DiBe ID 15962.
Cohérence
Selon une charte non datée, la donation du droit de patronage par Otto d'Everstein a eu lieu avec le consentement du roi romain Frédéric, qui l'a confirmée dans une charte royale datée du 26 décembre 1218 (voir Doppler, "Collection", 263-264, n° 77 (datée avant le 26 décembre 1218), et Idem, "Collection", 264, n° 78). Dans une charte également non datée, Engelbert de Berg, archevêque de Cologne, confirme ce transfert par l'empereur Frédéric II, voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 13. Pour la charte du 9 mai 1222 du roi romain Henri VII, dans laquelle il prend le chapitre de Saint-Servaas sous sa protection, confirme tous ses privilèges et ratifie l'octroi du droit de patronage par Otto d'Everstein, voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 12.

Numéro 12
Le chevalier Gerard van Scherwier a fait don au couvent Sint-Gerlach de Houthem d'une demi-ferme de terres arables provenant de sa propriété franche entre Swier et Laar. Ce don est fait à la condition qu'une dette de 30 marks soit remboursée. Après le remboursement, le couvent Sint-Gerlach sera propriétaire de la moitié de la ferme sans être dérangé, à condition que le couvent organise un service commémoratif perpétuel le jour anniversaire de sa mort, de celle de sa femme Agnès et de ses parents, qu'il célèbre des messes et qu'il paie une cotisation pour le vin.
Gerard van Scherwier, chevalier, fait don au monastère Sint-Gerlach (à Houthem) d'une demi-ferme de terre arable de son allodium entre Swier et Laar à condition qu'une dette de 30 marks soit remboursée à partir de celle-ci et que le monastère lui rende des visites annuelles perpétuelles, ainsi qu'à sa femme Agnès et à ses parents, célèbre des messes et paie une pitance.
Original
[A]. Non disponible, selon B scellé avec deux sceaux.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 188-189, no. 126, sous le titre : Anniversarium Gerardi de Scherwire, et en marge : Num. 126, indiquant deux lieux de scellement, à [A].
Edition
Non publié auparavant.
Cohérence
Cette charte mentionne une charte de Wolter, gardian des frères mineurs de Maastricht, concernant les biens acquis illicitement par Gérard van Scherwier, chevalier : si bona mea iniuste acquisita, que plenius invenientur in litera quam Wolterus, gardianus Traiectensis, super ordinationem mee legationis conscripsit. Pour ce deperditum, voir infra n° 11.


Numéro 12
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn font un partage bilatéral des biens et des revenus à Thorn, Bocholt, Baexem, Cobbenhese, Neer, Avezaath, Hemert, Eisden, Bergeijk, Übach, Wessem, Leveroy, Dasselre, Beersel, Rode, Ell, Haler, Oeteren, Gilze, Baarle et Grathem.
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn font un partage mutuel des biens et des revenus à Thorn, Bocholt, Baexem, Cobbenhese, Neer, Avezaath, Hemert, Eisden, Bergeijk, Übach, Wessem, Leveroy, Dasselre, Beersel, Rode, Ell, Haler, Oeteren, Gilze, Baarle et Grathem.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 20.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 264-266, no. 996, d'après A.


Numéro 12
Frédéric II, archevêque de Cologne, confirme la donation à l'abbaye de Kloosterrade de l'église de Lommersum avec l'ensemble des dos, familia et dîmes par les descendants de Jutta, épouse du duc Walram II de Limbourg, église qui avait été transférée à l'abbaye par Jutta lors de son entrée ; à la suite de l'archevêque Arnold Ier, il confirme également la possession par l'abbaye de plusieurs biens nommés.
Frédéric II, archevêque de Cologne, confirme la donation à l'abbaye de Kloosterrade de l'église de Lommersum avec l'ensemble des "dos", "familia" et dîmes par les descendants de Jutta, épouse du duc Walram II de Limbourg, église qui avait été transférée à l'abbaye par Jutta lors de son entrée ; à la suite de l'archevêque Arnold Ier, il confirme également la possession par l'abbaye de plusieurs biens nommés.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 802, 2.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 73-76, n° 29, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.
Edition de texte
Certains mots de la ligne de date se sont retrouvés sous le sceau collé. Pour le supplément, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 12
Le roi romain Henri VII prend l'église de Saint-Servaas à Maastricht sous sa protection, confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs ainsi que la donation du droit de patronage de l'église Saint-Jean à Maastricht au chapitre de Saint-Servaas par (Otto), prévôt du (chapitre de Notre-Dame à) Aix-la-Chapelle et du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht.
Le roi romain Henri VII prend l'église de Saint-Servaas à Maastricht sous sa protection, confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs ainsi que la donation du droit de patronage de l'église Saint-Jean à Maastricht au chapitre de Saint-Servaas par (Otto), prévôt du (chapitre de Notre-Dame à) Aix-la-Chapelle et du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 17. Doublé. Endommagé avec perte de texte.
Notes au verso : 1o de la main du XIIIe siècle: Henrici VII regis. - 2ode la main du XIVe siècle: Carta de officatis ecclesie. - 3o dela main du XIVe siècle: XII barré. - 4o de la main du XVIe siècle: Anno 1222. - 5o de la main du XVIe siècle: R. M I n. - 6o de la main du XVIIe siècle: In capsula imperialium. - 7o de la main du XVIIe siècle: 25 E I (amélioré de 25 d I). -8o de la main du XVIIIe siècle: De confirmatione privilegiorum etc., immunitate officiatorum ab exactione iure forensi et civili, a teloneo in omni distructu imperii et cessione per dictum prepositum capitulo factus ad usus eorum super parochia sancti Iohannis.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 du roi romain Henri VII, endommagé, en cire blanche. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals', no 46.
Copies
B. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 7r-7v (nouveau fol. 24r-24v), n° 12, d'après A. - C. 1640, Ibidem, idem, inv. n° 1741 (cartulaire) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurum. no. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 74-75, sous le titre : Henricus septimus, imperator, confirmat privilegia ecclesie et maxime quoad libertatem supportatam ab omni exactione, au A. - D. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 12 (cartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (thus) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 25v-27r, sous le titre : Imperialia, et sous le titre : Confirmatio privilegiorum, libertatum etc, specialiter quod officales et ministri ecclesie ab omni iure civili et forensi et omni exactione sint liberi, etiamsi sint mercatores ; item libertas thelonii, plus tard, vers 1757, authentifié par Membrede, secrétaire du chapitre et notaire public, après A. - [E]. non disponible, mais connu par F, cartulaire du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht = Liber A, fol. 204. - F. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, p. 272-273, sous le titre : Hendricus septimus, Romanorum rex, confirmat privilegia Sancti Servatii tam exemptionum talliarum quam accysiarum eorum qui in claustris morantur, hac 7 idus maii 1222, copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier de la ville de Maastricht, d'après A.
Dépenses
a. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica II-2, 738-740, d'après une copie dans un cartulaire du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht (conservé à Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin). - b. De Borman, " Notice ", 31-33, d'après B. - c. Sloet, OGZ I, 471, n° 467 (incomplet), d'après A. - d. DiBe ID 16799, d'après a.
Références
Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires, 53. - Wauters, Table chronologique III, 687. - Böhmer et Ficker, Regesta imperii V-2, 703, n° 3877. - Knipping, Die Regesten derErzbischöfe von Köln III, 63, n° 356. - Doppler, 'Collection', 270-271, n° 94. - Heeringa, OSU II, 152, n° 702. - Haas, Liste chronologique, 36, n° 59. - Böhmer et Zinsmaier, Regesta imperiiV-4, 244. - Nuyens, Inventaire de saint Servais, 49, n° 17.
Cohérence et édition du texte
Le texte de la présente charte est tiré de la charte de l'empereur Frédéric II datée du 28 juillet 1215, voir Collection de Saint-Servaas, n° 10. Pour les parties du texte extraites de cette charte préliminaire et imprimées en caractères plus petits, voir Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 84. Lorsqu'un ou plusieurs mots n'ont pas été reproduits dans les chartes, un astérisque a été utilisé.
Pour la charte de donation d'Otto, prévôt du chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle et du chapitre de Saint-Servaas de Maastricht, datée de 1218 juillet, voir Collection de Saint-Servaas, n° 11, et le lien qui y est fait. Pour la confirmation par le roi romain Rodolphe Ier, datée du 1er novembre 1273, avec insertion de la présente charte, voir le Recueil du chapitre de Saint-Servaas, n° 36. La lacune en A a été ajoutée à B. La distinction entre c et t est difficile à percevoir.


Numéro 13
Jan, administrateur, et le couvent du monastère Sint-Gerlach à Houthem annoncent que le couvent fait don à l'administrateur des biens destinés au réfectoire et des revenus qui découlent des régals que l'administrateur accorde annuellement lors des cérémonies d'anniversaire et qui proviennent de la ferme du couvent au profit de tout le couvent. L'administrateur cède à son tour les biens de Heek sous Klimmen au couvent.
Jean, prévôt, et le couvent du monastère Sint-Gerlach (à Houthem) annoncent que le couvent fait don au prévôt des biens destinés au réfectoire et du revenu des pitances que le prévôt accorde lors des anniversaires à partir de la ferme abbatiale, au profit de l'ensemble du couvent. Le prévôt attribue à son tour au couvent les biens situés à Heek sous Klimmen.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 52, n° de registre 10. Ligné.
Notes sur le revers : 1o d' une main du XVIIième siècle : De Heick, 1257. - 2o d'une main du XVIIIième siècle : Num . 79, 1257.
Scellement : deux points d'attache dont seules deux entailles dans le pli sont visibles, vraisemblablement pour les scellés annoncés des chartes (LS1 et LS2).
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 125-126, sous le titre : Divisio redituum inter prepositum et conventum ecclesie sancti Gerlaci, et en marge : Num. 79, indiquant deux points de scellement, à A.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 13-14, no. 9 (daté de 1257 février), d'après A..
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 71, registre n° 10 (daté de 1257 février). - Idem, Liste chronologique, 50-51, registre n° 109 (daté de 1257 février).
Dates
L'utilisation du style pascal dans le diocèse de Liège a été supposée, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII.
Origine
Cette charte a été rédigée par la même main qui, quelques mois plus tard, a mondé la charte d'Adam d'Amby au profit du monastère Sint-Gerlach, voir infra n° 14. Cette main est également très proche de celle du scribe qui, en 1254, a rédigé une charte pour le seigneur de Valkenburg et une charte échevinale de Maastricht concernant un litige impliquant le prévôt et le couvent de Sint-Gerlach , 9, 10, 13 et 14. Ces originaux présentent également la même mise en forme caractéristique : le scribe a écrit le texte de la charte non pas sur les règles prédessinées, mais bien au-dessus de ces lignes.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 13
Elisabeth, moniale de l'abbaye de Thorn, saine de corps et d'esprit, lègue à l'abbaye de Thorn, sous réserve de son usufruit, tous ses biens, revenus et possessions à Wessem, Thorn, Ittervoort, Grathem et Heeze, qu'elle a légalement acquis par achat et qui appartiennent à l'église de Thorn, et dont une somme annuelle est remise au desservant de l'autel de Sainte-Catherine situé dans la crypte de l'église de Thorn. Le reste des revenus est destiné à l'abbesse, au couvent et aux chanoines, avec l'obligation de distribuer une somme aux pauvres à l'occasion de l'anniversaire d'Elisabeth. En outre, l'abbesse, le couvent et les chanoines sont autorisés à partager équitablement une somme provenant de l'achat d'un terrain à côté de Horn.
Elisabeth, religieuse du couventde Thorn, lègue, sous réserve de son usufruit, à l'église de Thorn et à l'autel de Notre-Dame tous ses biens, ses fiefs et le revenu des accises achetées à Wessem, Thorn, Heeze et sur les moulins d'Ittervoort et de Grathem. Sur ce montant, huit livres de Louvain sont annuellement destinées au prêtre de l'autel de Sainte-Catherine dans l'église de Thorn ; le reste est attribué à l'abbesse, au couvent et aux chanoines avec l'obligation de distribuer douze sous liégeois aux pauvres à l'occasion de son anniversaire annuel. En outre, Elisabeth lègue après sa mort six marks de Liège que Hildegonde et son mari Cono lui doivent pourl'achat d'une terre dans le territoire adjacent à Horn, à partager également entre l'abbesse, le couvent et les chanoines.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 23.
Edition
a. Camps, ONB I, 324-325, n° 245, d'après A.
Cohérence
La présente charte est la préface de celle de N. de Maceriis, chanoine du chapitre de Saint-Jean à Liège et officiant de Liège, datée de 1252.04.08 (voir Collection Thorn, n° 14). Ces chartes ne présentent aucun lien de parenté entre les scribes.


Numéro 13
Alexandre, prévôt du chapitre de Saint-Lambert à Liège et archidiacre, informe les chanoines de ce chapitre, résidant à Visé, qu'Erpo, abbé de Kloosterrade, a acquis la terre pour laquelle Udo de Visé et ses héritiers étaient redevables à l'église de Saint-Pierre de Warsage de l'accise, auprès de Hendrik van Dongelberg, curé de cette église, moyennant le paiement du montant de l'accise annuelle à chaque investiture d'un nouvel abbé.
Alexandre, prévôt du chapitre de Saint-Lambert à Liège et archidiacre, informe les chanoines de ce chapitre, résidant à Visé, qu'Erpo, abbé de Kloosterrade, a acquis la terre pour laquelle Udo de Visé et ses héritiers étaient redevables à l'église de Saint-Pierre de Warsage de l'accise, auprès de Hendrik van Dongelberg, curé de cette église, moyennant le paiement du montant de l'accise annuelle à chaque investiture d'un nouvel abbé.
Originaux
A1. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 823, chirographe, destiné à l'abbaye vu le lieu de découverte.
[A2]. Non disponible, chirographe, destiné à la partie adverse.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 80-81, n° 33, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 13
Engelbert (de Berg), archevêque de Cologne, annonce que son parent Otto, prévôt du chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, avec la permission de l'empereur Frédéric II, a fait don de l'église Saint-Jean de Maastricht aux frères de Saint-Servatius, et approuve cette donation avec le consentement de Hugo, évêque de Liège.
Engelbert (de Berg), archevêque de Cologne, annonce que son parent Otto, prévôt du chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, avec la permission de l'empereur Frédéric II, a fait don de l'église Saint-Jean de Maastricht aux frères de Saint-Servatius, et approuve cette donation avec le consentement de Hugo, évêque de Liège.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 817.
Notes au verso : 1o de la main du XVe siècle: De ecclesia Sancti IohannisBaptiste, et de la main postérieure: approbatio archiepiscopi Coloniensis/ XXII. - 2o de la main du XVIe siècle: R. M II. -3o de la main du XVIIe siècle: In capsula episcoporum. - 4o de la main du XVIIe siècle: approbatio nu. Io.
Sceau : un point d'attache pour le sceau annoncé d'Engelbert de Berg, archevêque de Cologne, qui n'est pas disponible (SD1).
Copies
B. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 17 (nouveau fol. 34r), n° 26, d'après A. - C. 1640, Ibidem, idem, inv. n° 1741 (cartulaire) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex iurium. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 28, sous le titre : Confirmat idem archiepiscopus Coloniensis, d'après A.
Dépenses
a. De Borman, "Notice", 29 (non daté), à B. - b. DiBe ID 16082, à a.
Références
Habets, "Codex diplomaticus", 37, n° 53. - Wauters, Table chronologique III, 682 (daté vers 1218). - Knipping, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln III, 84, n° 523 (daté de 1221-1225). - Doppler, "Collection", 267, n° 86. - Haas, Liste chronologique, 35-36, n° 58 (daté s.d. (1220-1225)). - Nuyens, Inventaire de saint Servais, 150, n° 817.
Cohérence
Voir la collection Saint Servatius, n° 11.
Dates
Le terminus post quem de cette charte non datée est le couronnement impérial de Frédéric le 22 novembre 1220 (Grotefend, Taschenbuch, 113). Le terminus ante quem est la date de la mort de l'archevêque Engelbert de Berg, assassiné le 7 novembre 1225.


Numéro 14
Adam van Amby, chevalier, transfère avec le consentement de ses enfants Jan, Waltelm, Agnes et Catharina une ferme sur le territoire de Borgharen au directeur et au couvent du monastère de Sint-Gerlach à Houthem. Le chevalier Adam a également stipulé que ses descendants, qui maintiendraient cette ferme en usufruit après le transfert et en paieraient les accises, seraient en plus redevables d'une rente annuelle de deux marks de Cologne. Ils devront s'en acquitter lors du service commémoratif organisé le jour anniversaire de sa mort. Si ses descendants manquent à leurs obligations, l'administrateur et le couvent pourront prendre possession des terres arables jusqu'à ce qu'ils aient été indemnisés pour le préjudice subi. Dirk II, seigneur de Valkenburg, en assurera le suivi au profit de l'administrateur et du couvent.
Adam van Amby, chevalier, avec le consentement de ses enfants Jan, Waltelm, Agnes et Catharina, transmet une ferme de terre arable dans le territoire de Borgharen au prévôt et au couvent du monastère Sint-Gerlach (à Houthem), et stipule que ses descendants qui détiendront cette ferme après sa mort par droit de cession seront chargés du paiement d'une rente annuelle de deux marks de Cologne à son anniversaire. S'ils manquent à cette obligation, le prévôt et le couvent pourront prendre possession de la terre et Dirk II, seigneur de Valkenburg, la conservera.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 153, n° de registre 11. Ligné.
Notes au verso : 1° par une main du XIIIième siècle : Bona de Haren. - 2° d'une main du dernier quart du XIVe siècle : M . - 3° de la main du XVIe siècle probablement : [***] sanctiGerlaci, 1258.
Sceau : deux sceaux doublement percés, pendants, annoncés, à savoir : S2 d'Engelbert (de Valkenburg), archidiacre de Liège, de cire blanche, endommagé. - S3 d'Alard de Haasdal, chevalier, de cire blanche, endommagé ; et deux points d'attache, vraisemblablement pour les sceaux annoncés de Dirk II, seigneur de Valkenburg, et Adam de Borgharen, chevalier, (LS1 et LS4). Pour une description et une illustration de S2 et S3, voir Venner, " Seals monastery Sint-Gerlach", respectivement 150-151 et 160.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 128-129, sous le titre : Donatio Ade de Ambiie, militis, de uno manso terre arabilis in territorio de Haren, et en marge : Num. 82, indiquant quatre points de scellement, à A.
Edition
a. Gerlach, IV, 14-16, no. 10, d'après A.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 71, reg. no. 11. - Idem, Liste chronologique, 51, reg. no. 112.
Dates
L'utilisation du style pascal dans le diocèse de Liège a été supposée, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII.
Origine
Cette charte a été rédigée par la même main qui, quelques mois plus tôt, a mondé la charte du prévôt et du couvent du monastère Sint-Gerlach , voir infra n° 13. Cette main est également très proche de la main du scribe qui, en 1254, a rédigé une charte pour le seigneur de Valkenburg et une charte échevinale de Maastricht concernant un litige impliquant le prévôt et le couvent de Sint-Gerlach , voir infra n° 9, 10, 13 et 14. Ces originaux présentent également la même mise en forme caractéristique identique : le scribe n'a pas écrit le texte de la charte sur les règles prédessinées, mais bien au-dessus de celles-ci.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 14
N. de Maceriis, chanoine du chapitre de Saint-Jean à Liège et officiant de Liège, annonce qu'Elisabeth, moniale de l'abbaye de Thorn, a fait son testament en sa présence, par lequel elle a donné, sous réserve de son usufruit, tous ses biens, revenus et possessions à l'abbaye de Thorn dont elle a déterminé la répartition entre abbesse, couvent et chanoines.
N. de Maceriis, chanoine du Chapitre de Saint-Jean à Liège et officiant de Liège, annonce qu'Elisabeth, moniale du couvent de Thorn, a légué tous ses biens, fiefs et revenus des récoltes, achetés à Wessem, Thorn, Heeze et sur les moulins de Ittervoort et Grathem, à l'église de Thorn et à l'autel de Notre-Dame. Sur ce montant, huit livres louvanistes sont annuellement destinées au prêtre de l'autel de Sainte-Catherine dans l'église de Thorn ; le reste est alloué à l'abbesse, au couvent et aux chanoines dans le but de distribuer douze "pennings" liégeois aux pauvres lors de son anniversaire. Elisabeth lègue également, sous réserve de son usufruit après sa mort, six "marks" liégeois que Hildegonde et son mari Cono lui doivent pourl'achat d'une terre dans le territoire adjacent à Horn, à répartir également entre l'abbesse, le couvent et les chanoines.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 24.
Notes sur l'avers : 1o de la main du XIIIe siècle : M CC LIIo. - Annotation sur le revers : 1ode la main du13e/14e siècle : De altari sancte Katherine. - 2o de la main du XVIe siècle : In Thoren, in cripta, 1252. - 3o de la main du XVIIe siècle: F.
Sceau : un sceau pendant, apposé et annoncé, à savoir : S1 de l'Officialité de Liège, de cire verte, fortement endommagé.
Edition
Non publié auparavant.
Références
Franquinet, Inventaire révisé Thorn, 18-19, no. 11. - Habets, Archives Thorn, 19-20, n° 24. - Haas, Liste chronologique, 47, n° 97.
Origine et cohérence
Cette charte est basée sur la charte d'Elisabeth, moniale du couvent de Thorn, datée du 7 avril 1252 (voir Collection Thorn, no 13). Pour les parties du texte des post-chartes actuelles qui sont dérivées des pré-chartes et imprimées en caractères plus petits, voir Van Synghel, Oorkonden Thorn, 54. Ces chartes ne montrent aucune relation entre les scribes.


Numéro 14
Erpo, abbé de Kloosterrade, promulgue l'arrangement par lequel Reimar, doyen du chapitre de Wissel, achète au profit de l'abbaye de Kloosterrade, pour quatre-vingts marks, une ferme à Linzenich et le fief de Gunther, à condition que l'abbaye lui verse quatre marks deux fois par an durant sa vie et, après sa mort, l'admette dans la confrérie de prière et célèbre son anniversaire annuel.
Erpo, abbé de Kloosterrade, promulgue l'arrangement par lequel Reimar, doyen du chapitre de Wissel, achète au profit de l'abbaye de Kloosterrade, pour quatre-vingts marks, une ferme à Linzenich et le fief de Gunther, à condition que l'abbaye lui verse quatre marks deux fois par an durant sa vie et, après sa mort, l'admette dans la confrérie de la prière et célèbre annuellement sa mémoire.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 822.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 87-89, n° 37, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 14
Schouten, échevins et citoyens de Maastricht s'engagent à respecter les privilèges, les libertés et les droits du chapitre de Maastricht de Saint Servatius.
Schouten, échevins et citoyens de Maastricht s'engagent à respecter les privilèges, les libertés et les droits du chapitre de Maastricht de Saint Servatius.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 75. En bas à gauche, la plique contient deux encoches destinées au vidimus transfiguré daté du 25 septembre 1455, mentionné dans la copie E.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle: VIIa / f IIII / De compositione inter ecclesiam et cives Traiectenses / XXXI. - 2o de la main du XVIe siècle: R. M I n. - 3o de la main du XVIe siècle: anno 1227 / g I 9 / M. - 4o de la main du XVIIe siècle: In capsula Traiectensis / In capsula Traiectensis. - 5o de la main du XVIIe siècle: caps. 8 (oblitéré, amélioré en 24).-6o de la main du XVIIe siècle: Excopiatum nu. 10, compositionum.
Sceau : un sceau apposé suspendu, annoncé, à savoir : S2 de la Communauté urbaine brabançonne de Maastricht, en cire brune, fortement endommagé ; et un apposé, vraisemblablement pour le sceau annoncé de la Communauté urbaine liégeoise de Maastricht (LS1). Pour une description et une illustration de S2, voir Venner, 'Seals', no 57.
Copies
B. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 16r (= nouveau fol. 33r), n° 31, d'après A. - [C]. 25 septembre 1455, non disponible, mais connu par une copie dans Ibidem, idem, inv. no. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 8v-10r et fol. 39r-40v, vidimus par Bartholomeus de Eijck, doyen du chapitre Sainte-Catherine à Eindhoven, anciennement transcrit par A, à A. - D. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 1r, sous le titre : Magistratus Traiectensis promit servare privilegia et libertates ecclesie Sancti Servatii, anno 1227, peut-être après A. - [E]. non disponible, mais connu par F, cartulaire du chapitre de Saint-Servace à Maastricht = Liber A, fol. 981. - F. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, p. 303, sous la rubrique : Schulteti, scabini etc. Traiectenses promittunt quod in perpetuum observabunt privilegia et libertates ecclesie Sancti Servatii concessas, 3 maii 1227, copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier municipal de Maastricht, d'après B.
Dépenses
a. Schaepkens, 'Emblěmes', 223, no. 1, d'après A. - b. Wauters, De l'origine, 101, d'après une copie à l'ARA de Bruxelles (Registre des chartes déposées en 1498 et 1500, fol. 145). - c. De Borman, "Notice", 38-39, d'après B. - d. Panhuysen, Études Maastricht, 136-137, n° II, d'après B. - e. Van de Kieft, "Recueil", 456-457, n° 35, d'après B et d'après une copie du XVe siècle à l'ARA de Bruxelles. - f. DiBe, n° 18121, d'après e.
Références
Habets, "Codex diplomaticus", 40, n° 62. - Nelis, Diplôme suspect, 139, n° 12. - Wauters, Table chronologique IV, 43. - Doppler, 'Collection', 275-276, n° 105. - Haas, Liste chronologique, 38, n° 66. - Nuyens, Inventaire de saint Servais, 56, n° 75.


Numéro 15
Marcelis, curé de l'église Saint-Jean à Maastricht, annonce que Gérard d'Amby et son épouse Hildegonde font don d'un demi-hectare de terre arable dans le village de Berg au monastère cistercien de Val-Dieu et au monastère des prémontrés Sint-Gerlach à Houthem. Ces terres arables dépendent de la cour de Meerssen. Après la mort des deux donateurs, les deux monastères hériteront de ces terres arables.
Marcelis, curé pléban de l'église Saint-Jean de Maastricht, promulgue que ses paroissiens Gérard d'Amby et son épouse Hildegonde ont fait don à l'abbaye du Val-Dieu et au monastère Sint-Gerlach (à Houthem) d'un demi-hectare de terre arable près de Berg, dépendant de la cour de Meerssen, dont ils hériteront après la mort des donateurs.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 30, n° de registre 12.
Notes au verso : 1o par une main du XVIIième siècle : 1257. - 2°par une main du XVIIIième siècle: Num. 84.
Sceau : un sceau attaché et suspendu, annoncé, à savoir : S1 de Marcelis, pléban de l'église Saint-Jean de Maastricht, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals monastery Sint-Gerlach', 151.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erfffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 130, sous le titre : Testimonium Marsilii, plebani, de legato dimidii bonnarii terre arabilis in confinio ville de Bergh, et en marge : Num. 84, indiquant un point de scellement, à A.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 16, no. 11, d'après A..
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 72, reg. nr. 12. - Idem, Liste chronologique, 51-52, reg. nr. 113.


Numéro 15
Hildegonde, abbesse de Thorn, demande à maître Reinier, scoliaste à Tongres et procureur en matière spirituelle d'Henri III, évêque de Liège, le droit de patronage des églises de Gilze, Baarle et Geertruidenberg, qu'elle a donné (par charte) aux chanoines et moniales de Thorn, confirmé par l'évêque de Liège. Elle transfère le droit de patronage en raison de l'extraordinaire manque de revenus des chanoines et des moniales. L'abbesse demande également à l'évêque d'ordonner que les filles des églises susmentionnées soient des demi-églises, que les chanoines et les moniales de ces églises nomment des curés qui y résideront personnellement et y célébreront des offices, et que les curés de Gilze, Mertersem, Ginneken, Etten, Baarle, Meerle et Geertruidenberg reçoivent des revenus appropriés et spécifiés.
Hildegonde, abbesse de Thorn, demande à maître Reinier, scolastique à Tongres et procureur spirituel d'Henri III, évêque de Liège, de veiller à ce que l'évêque approuve sa donation du patronage des églises de Gilze, Baarle et Geertruidenberg aux chanoines et moniales de Thorn avec les stipulations qui y sont prévues.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187B, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. prél. no. 2219.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 341-343, no. 1039, d'après A.


Numéro 15
Godefroy III, duc de Lorraine, et ses fils Henri et Adelbert, ainsi qu'Henri III de Limbourg, font don à l'abbaye de Kloosterrade de la partie des dîmes de Lommersum que Kunisa, fille d'Herman de Reifferscheid, tenait d'eux en fief et qu'elle a cédée en faveur de l'abbaye.
Godefroy III, duc de Lorraine, et ses fils Henri et Adelbert, ainsi qu'Henri III de Limbourg, font don à l'abbaye de Kloosterrade de la partie des dîmes de Lommersum que Kunisa, fille d'Herman de Reifferscheid, tenait d'eux en fief et qu'elle a cédée en faveur de l'abbaye.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 803, 1.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 89-91, n° 38, d'après A,
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 15
L'empereur Frédéric II approuve la distribution des bancs par le prévôt et le chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, en attribuant les bancs de Malines et de Tweebergen au prévôt.
L'empereur Frédéric II approuve la distribution des bancs par le prévôt et le chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, en attribuant les bancs de Malines et de Tweebergen au prévôt.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 926. Doublé. Endommagé avec perte de texte.
Notes au verso : 1o de la main du XVe siècle: S. v / De separatione prepositi et ecclesie (ci-après complété par une main postérieure) facta perFredericum,Romanorum imperatorem. - 2o de la main du XVIe siècle: Anno 1232 / 316. - 3o de la main du XVIIe siècle: 5 capsula secunda. -4o de la main du XVIIe siècle: In capsula imperialium.
Sceau : une confirmation pour le sceau annoncé de l'empereur Frédéric II (SD1).
Copies
B. fin du XIIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives du chapitre de Saint-Servace à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 10 (cartulaire) = [Liber privilegiorum], fol. 3v-4v (= nouveau fol. 20v-21v), n° 6, d'après A. - C. 1640, Ibidem, idem, inv. n° 1741 (cartulaire) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iur. no. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 71-72, sous le titre : Confirmatio et licentia Frederici secundi faciendi divisionem inter bona prepositi et capituli, après A. - D. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 12 (cartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (donc) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 33v-34v, sous caput : Imperialia, et sous le titre : Approbatio concordie seu divisionis dominiorum facte inter prepositum et capitulum ; (d'autre part) presentem et aliam confirmationem fol. 45v, vers A. - E. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 96r-96v, sous le titre : Confirmatio imperialis super divisione bonorum prepositure, anno 1232 etc., vide fol. 93v, peut-être à A. - [F]. XVIIe siècle, non disponible, mais connu par c, copie sur papier, après C. - G. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, p. 308, sous le titre : Confirmatio et licentia Frederici secundi facienda divisionem inter bona prepositi et capituli, anno 1232 secunda aprilis, copie certifiée par G.J. Lenarts, greffier municipal de Maastricht, à B. - [H]. 1784, non disponible, mais connu par c, copie par J.H. Cruts, scholaster du chapitre de Saint Servaas à Maastricht, d'après D.
Dépenses
a. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica IV-1, 322-323, d'après une copie dans un cartulaire du Chapitre de Saint-Servaas à Maastricht (conservé à Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin). - b. Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkundenbuch, 109-110, n° 157, d'après A. - c. Willemsen, 'Inventaire', 167-170, n° 7 (daté de 1232 avril), d'après [F] et [H]. - d. Hackeng, The Medieval Land Property, 317, n° 99b (incomplet), à a. - e. DiBe ID 19235, à a. - f. Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 96-99, n° 1495, d'après A.
Références
Voir Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 96.
Origine et cohérence
Selon Zinsmaier, "Die Reichskanzlei", 149, la présente charte est l'une des dix-huit chartes produites sur une courte période d'environ un an et demi par l'un des cinq fonctionnaires qui travaillaient alternativement à la chancellerie impériale. Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 97, identifient le scripteur comme étant le notarius Johannes de Capua. L'attribution du dictat est problématique. L'absence d'indication de jour dans la datatio est un phénomène courant dans les chartes de Frédéric II, voir Ficker, Beiträge, 364-365. La charte de 1232 d'Otto, prévôt du chapitre de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle et du chapitre de Saint-Servais à Maastricht, répartissant les bancs entre la proosdiction et le chapitre de Saint-Servace, se trouve à Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin, Manuscrits no 9309. Voir aussi Hackeng, Het middeleeuws grondbezit, 41, 82-85 et 316, n° 99a (édition incomplète).
Edition de texte
La distinction entre c et t n 'est pas évidente.

Numéro 16
Hendrik, administrateur du couvent Sint-Gerlach à Houthem, annonce la décision qu'il a prise à la demande du couvent, de la religieuse Anna de Sint-Gerlach et de certains de ses amis. Lors du service commémoratif de l'anniversaire de la mort du chevalier Gozewijn Dukere, cinq schellings liégeois seront versés pour régaler le couvent aux frais des biens de Weestenrode. Gozewijn avait attribué ces biens à Anna pour son entretien. Après la mort d'Anna, ces biens deviennent la propriété du couvent.
Hendrik, prévôt du couvent Sint-Gerlach (à Houthem), à la demande du couvent, d'Anna, moniale de Sint-Gerlach, et de certains de ses amis, décrète qu'à l'anniversaire de Gozewijn Dukere, chevalier, cinq "schellings" liégeois seront payés pour une pitance du couvent sur les biens de Weestenrode, que Gozewijn avait assignés à Anna pour son entretien et qui reviendront au couvent après sa mort .
Original
[A]. Non disponible, selon B scellé avec deux sceaux.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 363, sous le titre : Litera de bonis in Westenroede iacentibus, et en marge : Num. 220, indiquant deux points de scellement, à [A].
Edition
Non publié auparavant.


Numéro 16
Henri III, évêque de Liège, approuve la donation des droits de patronage des églises de Gilze, Baarle et Geertruidenberg aux chanoines et aux moniales de l'abbaye de Thorn par Hildegonde, abbesse deThorn. Il confirme également les dispositions contenues dans sa charte de donation concernant la résidence et les revenus des curés à nommer.
Henri III, évêque de Liège, approuve la concession du patronage des églises de Gilze, Baarle et Geertruidenberg par Hildegonde, abbesse de Thorn, aux chanoines et moniales de Thorn, avec les stipulations qui y sont prévues.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187B, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. prél. no. 2220.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 341-343, no. 1040, d'après A.
Cohérence
Pour la donation de ce droit de patronage par Hildegonde, abbesse de Thorn, voir Collection Thorn, n° 15.


Numéro 16
Philippe Ier, archevêque de Cologne, exhorte son neveu Goswijn à considérer comme valide, à l'exception de la gestion, la donation par Adelheid, épouse de Reinier van Beek, de l'église de Spaubeek avec la totalité de la dîme et deux fermes de 12 acres à l'abbaye de Kloosterrade, au sujet de laquelle un litige était survenu.
Philippe Ier, archevêque de Cologne, exhorte son neveu Goswijn à considérer comme valide, à l'exception de la gestion, la donation par Adelheid, épouse de Reinier van Beek, de l'église de Spaubeek avec la totalité de la dîme et deux fermes de 12 acres à l'abbaye de Kloosterrade, au sujet de laquelle un litige était survenu.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 818.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 95-97, n° 41, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 16
L'empereur Frédéric II renouvelle et confirme à la demande de Jean, chanoine du chapitre de Maastricht de Saint-Servatius, la charte accordée par l'empereur Henri IV en date de 1087 au chapitre de Maastricht de Saint-Servatius.
L'empereur Frédéric II renouvelle et confirme à la demande de Jean, chanoine du chapitre de Maastricht de Saint-Servatius, la charte accordée par l'empereur Henri IV en date de 1087 au chapitre de Maastricht de Saint-Servatius.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 39. Doublé.
Annotation au verso : 1o de la main du XIVe siècle: Confirmatio Frederici de datoMo CCo XXXIIo. - 2o de la main du XIVe siècle: De exemptione serviciarum faciendum dominis episcopalibus, confirmato per (partiellement sous pièce collée) Fredericum et inseritur exemptio prius facte per (partiellement sous pièce collée) Henricum, imperatorem, que est de data anno Domini M LXXXVII / b / E XIIII. - 3o de la main du XVIe siècle: 1232. - 4ode la main du XVIIe siècle: Capsula imperialium. - 5ode la main du XVIIIe siècle: Exemptio I. et 4(barré).
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 de l'empereur Frédéric II, en cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals', no 45.
Copies
B. 1273 15 octobre, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint-Servais à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 40, vidimus par Maître Baudouin d'Autre-Église, chanoine du chapitre cathédral de Liège et official de Liège, d'après A. - C. 1282 9 avril, Ibidem, idem, inv. n° 42, insertion dans une charte du roi romain Rodolphe Ier, vers A. - D. fin XIIIe siècle, Ibidem, idem, accès n° 14.B002A, Archives du Chapitre de Saint Servais à Maastricht, 1062-1797, inv. no. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 1r-1v (= nouveau fol. 18r-18v), no. 1, d'après A. - E. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 12 ( cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 1r-1v (= nouveau fol. 18r-18v), no. 1, d'après A. - E. XVIIe siècle, Ibidem, idem, inv. no. 12 (cartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (sic!) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 34v-36v, sous caput : Imperialia, et sous rubrique : Capitulum Sancti Servatii soli pontifici et imperatoribus subest, dignitas cleri, sedes 20 episcoporum, après A. - [F]. non disponible, mais connu par G, cartularium du chapitre de Saint Servais à Maastricht = Liber A, fol. 198. - G. avant 1768, Ibidem, n° d'accès 22.001A, Collection de manuscrits (ancienne) Archives municipales de Maastricht, XIVe-XXe siècle, inv. n° 199a (cartulaire) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, p. 8, sous le titre : Fredericus 2, imperator, confirmat privilegium Henrici quarti, Romanorum regis, capitulo Sancti Servatii, datum X indictio 1087, de eorum exemptione, in decembris, 7 indictione, peut-être à [F]. - H. avant 1768, Ibidem, idem, p. 373, sous le titre : Fredericus, imperator, confirmat privilegium Henrici quarti, imperatoris, quo remittit ecclesie Sancti Servatii omne ius beneficialis servitii, anno 1252 6ta (plus tard barré et changé en décembre 1232) decembris, peut-être à D. - [I]. 1784, non disponible, mais connu par Willemsen, 'Inventaire', 167-170, no. 7, copie par J.H. Cruts, scholaster du chapitre de Saint Servais à Maastricht, d'après E.
Dépenses
a. Hackeng, The Medieval Land Property, 312, no. 96e (incomplet), d'après A. - b. DiBe ID 19371, d'après une édition du XVIIIe siècle. - c. Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 223-227, n° 1543, d'après A, voir plus loin.
Références
Voir Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 224.
Origine et cohérence
Selon Zinsmaier, "Die Reichskanzlei", 149, la présente charte est la dernière d'une série de dix-huit chartes produites sur une courte période d'environ un an et demi par l'un des cinq fonctionnaires qui travaillaient alternativement à la chancellerie impériale.
Friedl et al, o.c., 224, identifient le scripteur comme notarius Johannes de Capua ; le chrismon et le nom de l'empereur peuvent avoir été écrits par Johannes de Lauro ou Albertus de Catania. L'absence d'indication de jour dans la datatio est un phénomène courant dans les chartes de Frédéric II, voir Ficker, Beiträge, 364-365. Pour la charte inscrite d'Henri IV datée de 1087, voir Collection de Saint-Servatien, n° 2. Pour la confirmation et le renouvellement de la présente charte par le roi romain Rodolphe Ier en date du 9 avril 1282, voir Collection du chapitre de Saint-Servais, n° 49. Deux chartes ont été émises en septembre 1233 authentifiant la présente charte à la demande des chanoines du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht : l'une par le doyen et le chapitre de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle et l'autre par le chantre et les chanoines du chapitre de Saint-Adelbert à Aix-la-Chapelle. Les deux chartes ont survécu en copie dans un cartulaire de Saint Servatius (conservé à Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no 10180, fol. 243v). Pour le vidimus daté du 15 octobre 1273 de maître Baudouin d'Autre-Église, chanoine du chapitre cathédral de Liège et official de Liège, voir Collection du chapitre de Saint-Servatien, n° 35.
Edition de texte
La distinction entre c et t n 'est pas évidente.


Numéro 17
Walram de Monschau, seigneur de Valkenburg, annonce qu'il a exempté Jan Ruffus, citoyen d'Aix-la-Chapelle et gendre du seigneur Godefroid de Klimmen, ainsi que ses cohéritiers et les futurs héritiers de Jan lui-même, de tous les tributs sur la ferme de Cardenbeek qui sont dus à lui et à ses héritiers. Ceci à la condition que Jan Ruffus et ses cohéritiers, ainsi que leurs héritiers, livrent à Walram et à ses héritiers 1 livre de cire chaque année le 2 février.
Walram de Monschau, seigneur de Valkenburg, libère Jan Ruffus, citoyen d'Aix-la-Chapelle, gendre du seigneur Godefroid de Klimmen, ses héritiers et ses associés dans les biens de Godefroid, de tous les tributs sur la ferme de Cardenbeek, à condition que Jan lui livre annuellement 1 livre de cire.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 57, n° de registre 13.
Notes au verso : 1o d'une main du XIVième siècle : Littera de curte in Cardenbeck quod sit libera ab exactione.- 2° d'une main du dernier quart du XIVième siècle : J j.- 3° d'une main du XVIIième siècle : Vrijdom van Cartebeeck, 46.- 4°par une main du XVIIIième siècle : Num. 93.
Sceau : un sceau attaché, suspendu, et annoncé, à savoir : S1 de Walram de Monjoie, seigneur de Valkenburg, de cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals monastery Sint-Gerlach', 158-159.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, numéro d'accès 14.D003, archives du couvent Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 1 (cartulaire), p. 140-141, sous le titre : Litere domini Walrami de curte in Cartenbecke, quod sit libera ab omni exactione, et en marge : Num. 93, indiquant un point de scellement, à A.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 17, no. 12, d'après A..
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 72, reg. no. 13. - Idem, Liste chronologique, 62, reg. no. 149.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 17
Hildegonde, abbesse de Thorn, ratifie le décret d'Henri III. L'évêque a pris cette décision à la suite d'une visite de maître Reinier, scoliaste à Tongres et son proviseur en matière spirituelle, qui a constaté que les chanoines et les moniales de Thorn ne pouvaient pas vivre suffisamment de leurs prébendes et s'acquitter de leurs obligations. Le religieux à nommer devra recevoir ou avoir reçu l'ordination sacerdotale, renoncer volontairement à tout autre bénéfice et résider à Baarle dans l'année qui suivra sa nomination. Il recevra un bénéfice approprié ; le reste des bénéfices de l'église de Baarle sera utilisé par les chanoines et les moniales de Thorn pour augmenter leurs prébendes.
Hildegonde, abbesse de Thorn, ratifie la décision d'Henri III, évêque de Liège, datée du 13 octobre 1262, concernant l'installation du curé de Baarle et la détermination de ses revenus.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 28.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 341-343, no. 1044, d'après A.
Dates
La datation de la présente charte semble contredire celle de la charte ratifiée, qui n'a été publiée que le 13 octobre 1262 ((voir Collection Thorn, n° 19). Comme l'abbesse se réfère explicitement dans la corroboratio à cette charte de l'évêque qui était apparemment déjà rédigée le 10 octobre 1262, la contradiction des dates ne peut s'expliquer par une différence de temps entre l'actio et la conscriptio. L'abbesse se réfère probablement au mundum préparé pour l'évêque à Thorn, qui a été validé et daté seulement trois jours plus tard dans la chancellerie épiscopale.
Origine et cohérence
Cette charte de l'abbesse et du couvent de l'abbaye de Thorn de 1262 a été rédigée de la même main que celles émises par l'abbesse de Thorn en 1262 et en 1265, et par d'autres rédacteurs au nom de l'abbaye, notamment par Dirk van Heeswijk en 1267, par l'abbé et le couvent de l'abbaye Saint-Paul d'Utrecht en 1269 (deux originaux), par le curé d'Oeteren en 1270, par Michael, chanoine du chapitre Notre-Dame de Maastricht et par Godfrey Bec d'Übach en 1272, par plusieurs chevaliers en 1272 et par l'abbesse, le couvent et le seigneur de Horn en 1273, voir Collection Thorn, nos. 18, 23, 26, 28, 34, 37, 38 et 39. Par conséquent, ce scripteur peut être localisé dans l'abbaye de Thorn.
Pour des dispositions supplémentaires sur les revenus de l'église de Baarle, voir la charte d'Engelbert d'Isenburg, archidiacre de Liège, datée du 15 mai 1270 (Collection Thorn, n° 35).


Numéro 17
Philippe Ier, archevêque de Cologne, confirme le monastère de Marienthal dans la possession des biens nommés, y compris la ferme de Nentrode donnée par l'abbaye de Kloosterrade, sous réserve de neuf parts de forêt appartenant à Ahrweiler ; trois de ces parts avaient été transférées plus tard à Marienthal.
PhilippeIer, archevêque de Cologne, confirme le monastère de Marienthal dans la possession des biens nommés, y compris la ferme Nentrode donnée par l'abbaye de Kloosterrade, sous réserve de neuf parts de la forêt appartenant à Ahrweiler ; trois de ces parts avaient été transférées plus tard à Marienthal.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 1649 (anciennement Rolduc, chartes, n° 8). Quelques pertes de texte dues à l'usure, surtout en haut à droite.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 97-101, n° 42, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.
Edition de texte
En raison de l'usure, certaines lettres sont devenues illisibles. Pour le supplément, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 17
Le roi romain Henri VII ordonne au bailli d'Aix-la-Chapelle de contraindre les évêques et les citoyens du diocèse de Liège à cesser d'obéir à l'évêque, après plusieurs exhortations à l'évêque de Liège de cesser d'importuner le chapitre de Saint-Servace à Maastricht et de rembourser au chapitre les frais de cent marks.
Le roi romain Henri VII ordonne au bailli d'Aix-la-Chapelle de contraindre les évêques et les citoyens du diocèse de Liège à cesser d'obéir à l'évêque, après plusieurs exhortations à l'évêque de Liège de cesser d'importuner le chapitre de Saint-Servace à Maastricht et de rembourser au chapitre les frais de cent marks.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 53.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle: Mandatum regis / M VIII. - 2o de la main du XIVe siècle: [Litte]ra quod episcopus Leodiensis aliquid agatur contra nos. - 3o de la main du XVIe siècle: Q 2. -4o de la main du XVIIe siècle: 39. -5o de la main du XVIIe siècle: M VIII 3 - 6o de la main du XVIIe siècle: In capsula imperialium. - 7o de la main du XVIIIe siècle: 44 barré.
Le sceau n'a pas été annoncé et il n'y a aucune trace de sceau, contrairement à ce qu'affirme Zinsmaier, qui parle d'un sceau détaché.
Copie
B. XVIIe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 12 (cartulaire) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (thus) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 15r-v, avec caput : Mandatum Henrici, imperatoris, ad scholtetum Aquensem ut compellat scholtetos et cives diocesis Leodiensis non solvere episcopo Leodiensi donec etc, peut-être à A.
Dépenses
a. Zinsmaier, 'Acht ungedruckte Königsurkunden', 64, no. 7, à A. - b. DiBe ID 28119, à a.
Références
Doppler, " Verzameling ", 284-285, n° 125 - Böhmer et Zinsmaier, Regesta imperii V-4, 83, n° 571. - Haas, Liste chronologique, 42-43, n° 82. - Nuyens, Inventaire de saint Servais, 53, n° 53.
Dates
La présente charte se situe dans la septième année d'indiction sous le règne du roi romain Henri VII et peut être datée de 1234. Cette date est confirmée par la charte royale émise le même jour, voir sous Origine et cohérence.
Origine et cohérence
Selon Zinsmaier, "Acht ungedruckte Königsurkunden", 643, la présente charte a été éditée et rédigée à la chancellerie royale. Pour une édition de la charte mentionnée dans le dispositio du roi romain Henri VII du 20 septembre 1234 aux baillis et citoyens de Liège, Maastricht, Saint-Trond, Huy, Tongres et Dinant, voir DiBe ID 19834.


Numéro 18
Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, accorde au couvent Sint-Gerlach de Houthem la possession à perpétuité de la route traversant le village. Ceci pour le bien de sa propre âme et pour combattre la pauvreté des religieuses. Cette route doit rester librement accessible à tous les croyants, afin qu'ils puissent faire l'aumône aux sœurs.
Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, a fait don de la route traversant le village de Sint-Gerlach au monastère Sint-Gerlach (à Houthem).
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 41, n° de registre 14.
Notes sur le revers : 1° de la main du XIIIe siècle: Dominus Walramus contulit stratam publicam nostre ecclesie in vera elemosina. - 2° par la main du dernier quart du XIVe siècle: E j. - 3o par la main du XVIIe siècle : 1270. - 4o de la main du 18e siècle: Num. 72.
Sceau : un sceau doublement percé, accroché, qui est annoncé, à savoir : S1 de Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, de cire verte, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, "Seals convent Sint-Gerlach", 158-159.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, accès n° 14.D003, archives couvent Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 1 (cartulaire) = Privelegien en register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 118-119, sous la rubrique : Litere domini Walrami de Valckenburgh de platea, et en marge : Num. 72, avec spécification d'un seul lieu de scellement, après A.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 17-18, n° 13. d'après A.
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 72, reg. no. 14. - Idem, Liste chronologique, 63, reg. no. 153.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.
Traduction
Selon Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 19-20, nr. 14, une traduction simultanée de cette charte en moyen néerlandais a été effectuée. Cette traduction sur parchemin est toujours conservée avec l'original. Les recherches paléographiques montrent toutefois que la traduction n'est pas un document du XIIIe siècle, mais une édition ultérieure. Cette traduction n'a pas été copiée dans le cartulaire du XVIIIe siècle et porte le numéro 79 en dorso, qui correspond au texte latin de la présente charte.


Numéro 18
Hildegonde, abbesse de Thorn, annonce que maître Reinier, scoliaste à Tongres et conseiller spirituel d'Henri III, évêque de Liège, a visité le monastère. Il a découvert que la dîme de Gilze, dont les nobles de Breda s'étaient emparés illégalement pendant de nombreuses années, avait été volontairement restituée à l'abbaye. L'évêque révoque la dîme en tant que droit et propriété de l'abbaye et stipule que les prébendes des chanoines et des moniales seront égales à perpétuité et que l'abbesse, avec leur consentement, nommera un curé dans l'église de Gilze et des chapelains dans les églises subsidiaires. L'évêque de Liège accordera également un bénéfice approprié à ce curé. Cette ordonnance de l'évêque de Liège est ratifiée par l'abbesse de Thorn.
Hildegonde, abbesse de Thorn, ratifie la stipulation d'Henri III, évêque de Liège, datée du 13 octobre 1262, concernant la restitution de la dîme de Gilze, l'installation du curé de cette paroisse et la détermination de ses revenus.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187B, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. prél. no. 2221.
Edition
a. Dillo et Van Synghel, ONB II, 355-357, no. 1045, d'après A.
Dates
La datation de la présente charte semble contredire celle de la charte ratifiée ̶ perdue ̶ qui n'a été publiée que le 13 octobre 1262 (voir Collection Thorn, n° 19). Comme l'abbesse se réfère explicitement dans la corroboratio à cette charte de l'évêque, qui était apparemment déjà rédigée le 10 octobre 1262, la contradiction dans les dates ne peut s'expliquer par un décalage temporel entre l'actio et la conscriptio. L'abbesse se réfère probablement au mundum préparé pour l'évêque à Thorn, qui a été validé et daté seulement trois jours plus tard dans la chancellerie épiscopale.
Origine
Cette charte a été mondé par un scripteur de l'abbaye de Thorn, qui a travaillé de 1262 à 1273. Pour localiser ce scripteur, voir Collection Thorn, n° 17.

Numéro 18
Philippe Ier, archevêque de Cologne, promulgue que Kunisa de Reifferscheid, avec son père, ses héritiers et son mari d'une part, et le duc Godefroi III de Louvain en tant que seigneur féodal, avec ses fils Henri, Adelbert et Henri III de Limbourg d'autre part, cèdent à l'abbaye de Kloosterrade la partie des dîmes de Lommersum que Kunisa tenait en fief de Godefroi.
Philippe Ier, archevêque de Cologne, promulgue que Kunisa de Reifferscheid, avec son père, ses héritiers et son mari d'une part, et le duc Godefroi III de Louvain en tant que seigneur féodal, avec ses fils Henri, Adelbert et Henri III de Limbourg d'autre part, cèdent à l'abbaye de Kloosterrade la partie des dîmes de Lommersum que Kunisa tenait en fief de Godefroi.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 803, 2. Gravement endommagé par une déchirure, réparée avec une bande de parchemin au verso.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 101-102, n° 43, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 18
Le chapitre Notre-Dame de Maastricht déclare avoir vu la charte de l'empereur Henri IV, datée de 1087, qui n'est ni biffée ni effacée, et dont il reproduit le texte.
Le chapitre de Notre-Dame de Maastricht possède une charte de l'empereur Henri IV datant de 1087.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 37.
Notes sur le revers : 1o par des mains desXIVe et XVIe siècles: Transumptum privilegii Henrici imperatoris de exemptione ecclesie et prepositure sub sigillo capituli BeateMarie Traiectensis, datumMo LXXXVIIo. - 2ode la main du XVIe siècle: v / 2 4. - 3ode la main du XVIe siècle: Anno 1087. - 4o de la main du XVIe siècle : f II. - 5o de la main du XVIIe siècle: In capsula imperialium. - 6o dela main du XVIIIe siècle: R. MJ nu. 25.
Sceau : une confirmation, vraisemblablement pour le sceau annoncé du Chapitre Notre-Dame de Maastricht (SD1).
Copie
B. XVe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B001, archives chapitre de Notre-Dame de Maastricht, 1096-1796, inv. n° 31 (cartulaire), fol. 176r-177r, sous le titre : Item tenores omnium et singulorum exhiborum sequuntur per ordinem in hunc modum et sunt tales, peut-être d'après A.
Edition
Non publié auparavant.
Références
Haas, Liste chronologique, 106, n° 295 (daté du 13e siècle). - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 51, n° 37 (daté du 13e siècle).
Cohérence
Pour l'enregistrement vidéo de la charte de l'empereur Henri IV, voir Collection de Saint-Servatien, n° 2.
Dates
La charte actuelle n'est pas datée. Haas et Nuyens la datent du 13e siècle. Les recherches paléographiques montrent que le type d'écriture est apparenté à celui d'une charte d'Arnoud, prévôt du chapitre de Saint Geron à Cologne, d'une charte du chapitre de Notre-Dame à Maastricht, datées de 1232 mai et 1233 septembre (voir Maastricht, HCL, access no. 14.B001, archives chapitre de Notre-Dame à Maastricht, 1096-1796, inv. nos 909 et 910), et une charte du doyen et du chapitre de Saint-Lambert à Liège, datée de 1244 mai (voir Ibidem, no d'accès 14.D033, archives proosdij Meerssen, 968-1746, inv. no 1024). Par conséquent, nous datons cette charte du deuxième quart du XIIIe siècle. Une datation vers 1232-1233 n'est pas improbable, car le chapitre de Saint-Servaas à Maastricht a fait renouveler la charte de l'empereur Henri IV de 1087 et l'a fait confirmer par l'empereur Frédéric II en décembre 1232 (voir Collection de Saint-Servaas, n° 16) et a demandé l'authentification de la charte auprès de l'empereur Frédéric II. 16) et demande une authentification au doyen et au chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle ainsi qu'au chantre et aux chanoines de Saint-Adelbert d'Aix-la-Chapelle en septembre 1233 (conservé à Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin, Manuscrits n° 10180, fol. 243v).


Numéro 19
Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, atteste que le chevalier Gerard van der Huven a reconnu en sa présence la vente d'une partie de la dîme de Spaubeek. Et ce, moyennant 21 livres liégeoises à l'administrateur, au magistère et au couvent du couvent Sint-Gerlach à Houthem. Il s'agissait de deux muids maastrichtois de seigle, à payer à perpétuité annuellement le jour de la Saint-André (le 30 novembre). Cette vente a eu lieu en présence et avec le consentement de feu son père, Dirk II, seigneur de Valkenburg. Au moment de la vente, le chevalier Gérard tenait cette dîme en fief de Dirk II. Au moment du témoignage du Seigneur Walram, cette dîme était en sa possession en tant que seigneur féodal. Lui aussi approuve cette vente.
1271 (3 avril - 1272 21 avril)
Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, approuve la vente faite par Gerard van der Huven, chevalier, en présence et avec le consentement de son père (Dirk II), seigneur de Valkenburg, de deux muids de seigle de la dîme de Spaubeek pour 21 livres liégeoises au prévôt, au magistère et au couvent du monastère Sint-Gerlach (à Houthem).
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 87, n° de registre 15.
Notes au verso : 1o d'une main du XIIIième siècle : Littera de II modiis siliginis in Spauberch. - 2° par une main du XVIIième siècle : 1271. - 3° par une main du XVIIIième siècle : Num. 83.
Sceau: un sceau suspendu, doublement percé, annoncé, à savoir : S1 de Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, en cire brune, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals monastery Sint-Gerlach', 158-159.
Copie
B. 1735, RHCL, no d'accès 14.D003, archives couvent Sint-Gerlach à Houthem, inv. no. 1 (cartulaire) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 129-130, sous le titre : Reditus duorum modiorum siliginis ex decimis in Spaubeek, et en marge : Num. 83, indiquant un point de scellement, à A.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 20-21 (daté de 1271), d'après A..
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 73, registre n° 15 (daté de 1271). - Idem, Liste chronologique, 65, n° d'enregistrement 160 (daté de 1271).
Dates
L'utilisation du style pascal dans le diocèse de Liège a été supposée, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.

Numéro 19
Henri III, évêque de Liège, annonce que Reinier, scholastre à Tongres et son proviseur en matière spirituelle, a revisité l'abbaye de Thorn à la demande de l'évêque et muni d' instructions spéciales. Reinier ayant constaté que les prébendes des chanoines et des moniales sont trop petites pour en vivre, l'évêque décide que l'abbesse, qui détient le droit de patronage de l'église de Baarle, y installera un prêtre avec l'accord des chanoines et des moniales. L'ecclésiastique à nommer devra recevoir ou avoir reçu l'ordination sacerdotale, renoncer volontairement à tout autre bénéfice et résider à Baarle dans l'année qui suit sa nomination. Il recevra un bénéfice approprié. Le reste des fruits de l'église de Baarle sera utilisé par les chanoines et moniales du couvent de Thorn pour augmenter leurs prébendes, qui seront égales et resteront égales pour toujours.
Henri III, évêque de Liège, après la visite de l'abbaye de Thorn par Reinier, scholâtre à Tongres et son proviseur en matière spirituelle, décide que l'abbesse de Thorn, qui détient le droit de patronage de l'église de Baarle, installera un curé avec l'approbation des chanoines et des moniales de Thorn, et il détermine également les revenus du curé.
Original
[A]. Non disponible.
Copie
B. première moitié du XVe siècle, Maastricht, HCL, n° d'accès 01.187B, archive Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. n° 1628 (anciennement cartularium n° 1) = Cartularium abbatiae imperialis Thorensis, 966-1600, p. 161-162 (anciens fol. 85r -85v), sous le titre : De ecclesia de Baerle incorporatio), copie authentifiée par S. van Neeroeteren, à [A].
Edition
a. Dillo-Van Synghel, ONB II, 357-359, à 1046, après B.
Dates
La datation de la présente charte semble contredire celle de la charte de l'abbesse de Thorn qui, trois jours plus tôt, ratifie les dispositions de l'évêque de Liège concernant Baarle (voir Collection Thorn, n° 17). Comme l'abbesse se réfère explicitement dans la corroboratio à la charte de l'évêque concernant Baarle, qui était apparemment déjà rédigée le 10 octobre 1262, la contradiction des dates ne peut s'expliquer par un décalage temporel entre l'actio et la conscriptio. L'abbesse fait probablement référence au mundum préparé pour l'évêque à Thorn, qui a été validé et daté seulement trois jours plus tard dans la chancellerie épiscopale.
Cohérence
Pour des dispositions supplémentaires concernant les revenus de l'église de Baarle, voir la charte d'Engelbert d'Isenburg, archidiacre de Liège, datée du 15 mai 1270 (voir Collection Thorn, n° 35).


Numéro 19
Accord entre Godschalk van Aubel et sa femme, d'une part, et l'abbé Erpo et tout le couvent de Kloosterrade, d'autre part, par lequel les premiers font don de plus de 43 marks d'argent à l'abbaye pour l'acquisition de certains biens, à condition qu'ils en aient l'usufruit.
Accord entre Godschalk van Aubel et sa femme, d'une part, et l'abbé Erpo et tout le couvent de Kloosterrade, d'autre part, par lequel les premiers font don de plus de 43 marks d'argent à l'abbaye pour l'acquisition de certains biens, à condition qu'ils en aient l'usufruit.
Originaux
A1. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 860. Chirographe, compte tenu du lieu de découverte destiné à l'abbaye.
[A2]. Non disponible, mais il semble s'agir d'un chirographe en coupe, destiné à l'autre partie.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 108-110, n° 48, à A1.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 19
Le roi romain Guillaume (comte de Hollande) ordonne aux gardiens, schouten, échevins et citoyens de Maastricht de respecter les droits et privilèges du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht et de son personnel.
Le roi romain Guillaume (comte de Hollande) ordonne aux gardiens, schouten, échevins et citoyens de Maastricht de respecter les droits et privilèges du chapitre de Saint-Servaas à Maastricht et de son personnel.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 20.
Sceau : un sceau confirmé suspendu, annoncé, à savoir : S1 du roi romain Guillaume, comte de Hollande, de cire blanche, endommagé. Pour une description et une illustration du sceau, voir Venner, 'Seals', no 47.
Copies
Voir Hägermann et Kruisheer, Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland, 263-264, n° 211.
Edition
a. Hägermann et Kruisheer, Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland, 263-264, n° 211, d'après A.
Références
Voir Hägermann et Kruisheer, Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland, 263-264, n° 211.
Dates
La présente charte se situe dans la dixième année d'accusation du règne du roi romain Guillaume. Par conséquent, cette charte peut être datée de l'année 1252.
Origine
Selon Hägermann, Studien, 264, la présente charte a été éditée et rédigée par le chancelier WA.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.

Numéro 20
Margareta, religieuse du couvent Sint-Gerlach à Houthem, fille de Wolter et Oda van Stercbeeke, a acheté six arpents de terre à Dirgarden en vue d'une donation annuelle de vin au couvent ; elle a également acheté douze "schellings" liégeois à Heek en vue d'une donation au couvent aux fêtes de Sainte Catherine, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Nicolas. Elle a également acheté un demi-muid de seigle à Haasdal, afin de payer le couvent pour le service commémoratif de l'anniversaire de la mort de Mathilde, l'ancienne dame de Berg. Dans la ferme de Raar, elle a acheté trois arpents de terrain pour organiser tous les ans perpétuellement des cérémonies commémoratives, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son père Wolter et de sa mère Oda van Stercbeeke. Pour la lampe de St. Gerlach dans l'église de Sint-Gerlach , elle a acheté un demi-hectare de terre, situé dans les champs, et dans la ferme de Raar un demi-muid de seigle, à payer annuellement pour la lampe suspendue au chœur du couvent de Sint-Gerlach.
Il est proclamé que Margareta, religieuse du couvent Sint-Gerlach (à Houthem), fille de Wolter et Oda van Stercbeeke, a acheté six arpents de terre à Dirgarden au profit de la pitance de vin au couvent, ainsi que douze "schelling" liégeois à Heek au profit d'une pitance au couvent pour les fêtes de Sainte Catherine, Jean Evangéliste et Nicolas, un demi-muid de seigle à Haasdal pour la fête annuelle de Mathilde, autrefois la Dame de Berg, à payer au couvent, à la cour de Raar trois morgen de terre pour la fête de ses parents, un demi-hectare de terre pour la lampe de saint Gerlach dans l'église et un demi-muid de seigle pour la lampe au-dessus du chœur du couvent.
Original
[A]. Non disponible, selon B scellé avec un seul sceau.
Copie
B. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 122-123, sous le titre : Litere Margarete, monialis sancti Gerlaci, de 6 bonnariis apud Dirgarde, in Heeke 12 flor. Leodienses etc., et en marge : Num. 76, spécifiant un point de scellement, à [A].
Edition
Non publié auparavant.


Numéro 20
Le couvent de l'abbaye de Thorn annonce qu'Aleid van Nathen, Aleid et Elisabeth, moniales du couvent, ainsi que les laïcs Christiaan et Dirk et beaucoup d'autres personnes appartenant à la familia du couvent, doivent une accise personnelle à l'église de Thorn chaque année le 11 novembre. En cas de décès, une somme doit être payée pour la mainmorte, ainsi que pour la permission de se marier. De plus, l'église est leur unique tuteur.
Le couvent de l'abbaye de Thorn déclare qu'Aleid van Nathen, Aleid et Elisabeth, conventuelles, Christiaan et Dirk, laïcs, et beaucoup d'autres personnes appartenant à la familia de l'église Notre-Dame de Thorn, doivent à l'église de Thorn une taxe annuelle de deux deniers líégeois, ainsi que deux deniers dans le cas de leur décès ou de leur mariage, et qu'ils n'auront pas d'autre tuteur que l'église de Thorn.
Originaux
A1. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Rijksheerlijkheid de Thorn, inv. n° 33. Section chirographaire gauche, avec les lettres inférieures de la devise : C[Y]RO[G]RAPH[V]M. Endommagé avec perte de texte.
Notes au verso : 1ode la main du XVIe siècle: Pro licentia nubendi sive contrahendi matrimonium dabit et duos denarios, 1263. - 2o de la main du XVIIe siècle: R barré, Z.
Sceau : un seul point d'attache, probablement pour le sceau annoncé de l'abbaye de Thorn (LS1).
[A2]. non disponible, mais connu par A1, partie droite du chirographe.
Dépenses
a. Franquinet, Beredeneerde inventaris Thorn, 27-28, n° 17, à A1. - b. Habets, Archives Thorn, 26, n° 33, vers A1.
Regest
Haas, liste chronologique, 55, no. 126.


Numéro 20
Rutger, abbé de Kloosterrade, règle un différend entre Gérard de Merz, fidèle de l'abbaye, et Rutger, citoyen d'Ahrweiler, exigeant de ce dernier qu'il renonce à ses prétentions sur des vignobles qu'il avait d'abord mis en gage en faveur dudit Gérard et qu'il avait ensuite vendus, moyennant le paiement de seize schellings de Cologne.
Rutger, abbé de Kloosterrade, règle un différend entre Gérard de Merz, fidèle de l'abbaye, et Rutger, citoyen d'Ahrweiler, exigeant de ce dernier qu'il renonce à ses prétentions sur des vignobles qu'il avait d'abord mis en gage en faveur dudit Gérard et qu'il avait ensuite vendus.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 846.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 114-116, n° 52, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 20
Garsilius, doyen, et le chapitre de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle approuvent l'accord entre Koenraad, chantre du chapitre, d'une part, et le doyen et le chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, d'autre part, par lequel Koenraad, au nom du chapitre de Notre-Dame, transfère la neuvième partie (des revenus) du village et de l'allodium de Dilsen en bail perpétuel au chapitre de Saint-Servaas, moyennant le paiement annuel de cinquante shillings liégeois. et de l'allodium de Dilsen en bail perpétuel au chapitre de Saint-Servais moyennant un paiement annuel de cinquante shillings liégeois.
Garsilius, doyen, et le chapitre de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle approuvent l'accord entre Koenraad, chantre du chapitre, d'une part, et le doyen et le chapitre de Saint-Servatius à Maastricht, d'autre part, par lequel Koenraad, au nom du chapitre de Notre-Dame, transfère la neuvième partie (des revenus) du village et de l'allodium de Dilsen en bail perpétuel au chapitre de Saint-Servaas, moyennant le paiement annuel de cinquante shillings liégeois. et de l'allodium de Dilsen en bail perpétuel au chapitre de Saint-Servais moyennant un paiement annuel de cinquante shillings liégeois.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 321.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle: De censu dando cantori Aquenside silva de Dilsene. - 2o de la main du XVIe siècle: R. 49. - 3o de la main du XVIe siècle: 1255. -4o de la main du XVI esiècle: 26 / C XVII.
Sceau : deux points d'attache, vraisemblablement pour les sceaux annoncés du chapitre Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle et de Koenraad, chantre du chapitre (LS1 et LS2).
Copie
Non disponible.
Edition
Non publié auparavant.
Références
Doppler, 'Collection', 306, n° 170 - Haas, Liste chronologique, 49, n° 103. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 87, n° 321. - Mummenhoff, Regesten Aachen I, 29, n° 65.


Numéro 21
Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, a, sur l'avis de ses conseillers le chevalier Arnoud, seigneur de Stein, le chevalier Gozewijn de Borgharen, le chevalier Jan de Haasdal et de Raas de Printhagen, vendu trente mètres cubes de sa forêt de Buchoit à Arnoud van Houthem. Ceci dans l'intention d'en faire des terres arables. Ces trente acres, tout comme les autres fiefs qu'Arnoud van Houthem tient de Walram, ont été transférés en tant que fief.
Walram, seigneur de Valkenburg et Monjoie, annonce qu'il a donné en fief à Arnoud van Houthem trente hectares de forêt de Buchoit, qu'il lui avait vendus sur l'avis de ses conseillers Arnoud, seigneur de Stein, Gozewijn van Borgharen, Jan van Haasdal, chevaliers, et Raas van Printhagen, ainsi que les autres fiefs qu'Arnoud tient de lui.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 179, n° de registre 16.
Notes au verso : 1º par une main du XVième siècle : De XXX bonaria terre. - 2' par unemain du XVIIième siècle : 1273.
Sceau : un sceau suspendu, annoncé, à savoir : S1 de Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, de cire blanche, endommagé. Pour une description et une image de S1, voir Venner, 'Seals monastery Sint-Gerlach', 158-159.
Copie
Non disponible.
Edition
a. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 21, no. 16, d'après A..
Références
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 73, n° d'enregistrement 16. - Idem, Liste chronologique, 66, reg. nr. 164.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 21
Après examen méticuleux, Engelbert d'Isenbourg, archidiacre de Liège, et maître Reinier, scoliaste à Tongres et proviseur d'Henri III, évêque de Liège, mettent fin au litige entre l'archidiacre d'une part et les chanoines et moniales de Thorn d'autre part, au sujet de la perception des dîmes de Mertersem et de ses dépendances. Seule la dîme de Gilze, Burgst et Overveld, qui se trouve dans la zone de dîme de l'église de Mertersem, appartient au curé de l'église de Gilze. Le reste de la dîme de Mertersem servira pour toujours à l'augmentation des prébendes des chanoines et des sœurs du couvent de Thorn.
Engelbert d'Isenbourg, archidiacre de Liège, et maître Reinier, scolastique à Tongres et procureur d'Henri III, évêque de Liège, règlent le litige entre l'archidiacre d'une part et les chanoines et les sœurs du couvent de Thorn d'autre part au sujet des dîmes de Mertersem, Burgst et Overveld.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 01.187B, archives Rijksheerlijkheid de Thorn, inv. n° 2222.
Edition
a. Dillo-Van Synghel, ONB II, 379-381, n° 1060, d'après A.


Numéro 21
Henri Ier, duc de Lorraine et margrave, confirme à la demande de l'abbé et du couvent de Kloosterrade et de son oncle Hendrik III, duc de Limbourg, la donation de l'église paroissiale de Lommersum et des dîmes y compris le droit d'acquérir d'autres biens attachés à l'église. Cette donation a été faite à l'abbaye par son arrière-grand-mère Jutta, veuve de Walram II, duc de Limbourg, lors de son entrée au couvent, et confirmée par la suite par ses descendants.
Henri Ier, duc de Lorraine et margrave, confirme à la demande de l'abbé et du couvent de Kloosterrade et de son oncle Hendrik III, duc de Limbourg, la donation de l'église paroissiale de Lommersum et des dîmes y compris le droit d'acquérir d'autres biens attachés à l'église. Cette donation a été faite à l'abbaye par son arrière-grand-mère Jutta, veuve de Walram II, duc de Limbourg, lors de son entrée au couvent, et confirmée par la suite par ses descendants.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 802, 3.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 116-119, n° 53, d'après A.
Authenticité
Sur le caractère éventuellement fallacieux de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 21
Les échevins de Maastricht ont donné mandat à Benedicta, veuve (d'Adelbert van Wyck), et à ses fils Godfrey et Jan, prêtres, de vendre à Jan van Wyck, fils de Basilea, un droit annuel de cinq shillings Luiks et deux chapons sur une maison située à Wyck (à Maastricht).
Les échevins de Maastricht ont donné mandat à Benedicta, veuve (d'Adelbert van Wyck), et à ses fils Godfrey et Jan, prêtres, de vendre à Jan van Wyck, fils de Basilea, un droit annuel de cinq shillings Luiks et deux chapons sur une maison située à Wyck (à Maastricht).
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 443.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle: Littera V solidorum et II caponum tenetur relicta quondamAlbertiin Wiic. - 2o de la main du XVIe siècle: n 39. -3o de la main du XVIe siècle: 286 / 1257.
Sceau : deux sceaux apposés, annoncés, à savoir : S1 de Boudewijn de Molendino, échevin de Maastricht, de cire brune, endommagé. - S3 premier sceau de Daniel supra Forum, échevin de Maastricht, en cire brune, endommagé ; et un point d'attache, vraisemblablement pour le sceau annoncé de Godfrey, fils de Lady Osa, échevin de Maastricht (LS2). Pour une description et une illustration de S1 et S3, voir Venner, " Seals convent of Sint-Gerlach", 161-162, et Idem, " Maastricht aldermen's seals ", 170-171, fig. 14, respectivement.
Copie
Non disponible.
Dépenses
a. Doppler, 'Schepenbriefs', 19-20, no. 1, d'après A. - b. Nève, The thirteenth-century schepenoorkonden, 11-12 (avec traduction incomplète), no. 1257.05.12, d'après A.
Références
Haas, Liste chronologique, 51, n° 110. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 100, n° 443.
Identification
Selon l'annotation dorsale, Benedicta est la veuve d'Adelbert van Wyck.
Origine
Cette charte a été rédigée par un scripteur qui a rédigé des chartes échevinales de Maastricht pour le monastère des Blanches de Maastricht daté du 22 décembre 1256 (voir Maastricht, HCL, no. d'accès 14.D030, archives Monastère des Blanches de Maastricht, 1253-1796, inv. no 59), pour les Prêcheurs de Maastricht le 6 novembre 1263 (voir Maastricht, HCL, no d'accès 14.D028, archives Monastère des Prêcheurs de Maastricht, 1261-179, inv. no 83) et pour deux béguines le 25 janvier 1267 (voir Collection du Chapitre de Saint-Servatius, no 26). Par conséquent, ce scripteur peut être situé dans l'environnement de la cour échevinale de Maastricht.
Edition de texte
La distinction entre c et t est difficile à percevoir.


Numéro 22
Engelbert d'Isenbourg, archidiacre du diocèse de Liège, ordonne que le curé de Meerssen proclame un projet de nomination d'un curé à Oirsbeek à trois fêtes religieuses, afin que d'autres puissent s'opposer à l'archidiacre le 12 juin et que le monastère Sint-Gerlach de Houthem puisse prendre une autre décision de nomination. En effet, Walram, jeune seigneur de Valkenburg et de Monjoie, avait déjà fait don du droit de patronage d'Oirsbeek au monastère Sint-Gerlach.
Engelbert d'Isenbourg, archidiacre de Liège, ordonne au curé de Meerssen de promulguer le pardon du pastorat d'Oirsbeek, qui avait été donné par Walram, jeune seigneur de Valkenburg et Monjoie, à la prévôté, à la magistra et au couvent de Sint-Gerlach, pour trois jours de fête, afin que d'autres intéressés puissent s'y opposer devant l'archidiacre le 12 juin et que le monastère puisse revenir sur ses pas.
Original
[A]. Non disponible, selon D scellé avec un seul sceau.
Copies
[B]. 1376 25 janvier, non disponible, mais connu par C, charte de l'official de Liège et de l'archidiacre de la Campine, à [A]. - C. 25 janvier 1376, Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 173, reg. n° 71, copie certifiée par Albert Loze de 's-Hertogenbosch, notaire public et impérial, à la demande de l'official de Liège et de l'archidiacre de la Campine, première charte, à [B]. - D. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = "Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach", p. 275-276, sous le titre : Collatio iuris patronatus ecclesie in Oirsbeek, et en marge : Num. 170, indiquant l'apposition du sceau, à [A]. - E]. avant 1869, non disponible, mais connu par b, encore présent dans les archives de l'église d'Oirsbeek en 1869.
Dépenses
a. Hugo, Annales, col. 737, n° XVI. - b. Habets, 'Houthem-Sint-Gerlach', 213-214, no. 7, d'après [E]. - c. Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 22, n° 17, d'après C.
Regest
Haas, Inventaire Saint Gerlach, 73, n° d'enregistrement 17.
Cohérence
Pour la désignation du curé d'Oirsbeek, voir infra nr. 23.
Edition de texte
En l'absence de l'original et de parties du texte dans le cartulaire du XVIIIe siècle, le présent texte a été publié sur la base de l'exemplaire C, avec les variantes significatives de D, a et b dans les annotations.

Numéro 22
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, à la demande de Jean, prévôt, de Gillis, doyen, de l'archidiacre et du chapitre cathédral de Liège ainsi qu'avec le consentement de Marsilius, Gundulf et Nicolaas van Welheim, prêtres, et de Koenraad, chanoine de Thorn, distribuent les biens du couvent en acquittement des dettes.
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, à la demande de Jean, prévôt, de Gillis, doyen, de l'archidiacre et du chapitre cathédral de Liège ainsi qu'avec le consentement de Marsilius, Gundulf et Nicolaas van Welheim, prêtres, et de Koenraad, chanoine de Thorn, distribuent les biens du couvent en acquittement de leurs dettes. (Deperditum)
Notice
Cette charte est connue par le dispositio de la charte datée de 1265 (3 avril-1266 25 mars) de Hildegonde, abbesse, et du couvent de l'abbaye de Thorn (voir Collection Thorn, no. 23), où la présente charte est mentionnée : nobis ab ecclesia [***] ordinationem sive divisionem inter nos fecimus de bonis et reditibus nostris propter debita n[o]stra [***], [s]icut in [l]itteris super hoc confectis et sigillis nostris sigillatis plenius continetur.
Edition
Non publié auparavant.
Cohérence
Pour la demande de confirmation de ce partage des biens au chapitre cathédral de Liège, voir Collection Thorn, n° 23.


Numéro 22
Rutger, abbé de Kloosterrade, acte régulièrement l'acquisition de biens et de revenus par l'abbaye dans la période précédente.
Rutger, abbé de Kloosterrade, acte régulièrement l'acquisition de biens et de revenus par l'abbaye dans la période précédente.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 824.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 122-125, n° 55, d'après A.
Datation et authenticité
Pour la datation et l'éventuelle fausseté de cette charte, voir l'édition de Polak et Dijkhof.


Numéro 22
Charte des échevins de Maastricht selon laquelle Dirk, moine de l'abbaye du Val-Dieu (à Aubel), en tant que procureur de l'abbé et du couvent, d'une part, et Hendrik Herync, citoyen de Maastricht, d'autre part, ont conclu un accord sous d'autres conditions concernant le paiement par Hendrik d'un droit de succession annuel d'une livre liégeoise à l'abbaye, à payer à partir de sa résidence de Vrijthof (à Maastricht).
Charte des échevins de Maastricht selon laquelle Dirk, moine de l'abbaye du Val-Dieu (à Aubel), en tant que procureur de l'abbé et du couvent, d'une part, et Hendrik Herync, citoyen de Maastricht, d'autre part, ont conclu un accord sous d'autres conditions concernant le paiement par Hendrik d'un droit de succession annuel d'une livre liégeoise à l'abbaye, à payer à partir de sa résidence de Vrijthof (à Maastricht).
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 444.
Notes au verso : 1ode la main du XIVe siècle: Henricus dictus Herinc. - 2o de la main du XIVe siècle: De XX solidis supra domum in qua moratur Manesius et alia domo contigua. - 3o de la main du XVIe siècle: 333 / E 44. - 4o de la main du XVIe siècle: 1261. -5o de la main possiblement du XVIe siècle: (après les mots biffés) MR G.
Sceau : deux sceaux apposés, annoncés, à savoir : S1 de Boudewijn de Molendino, échevin de Maastricht, de cire brune, endommagé. - S2 de Godfrey, fils de Lady Osa, échevin de Maastricht, en cire brune, endommagé. Pour une description et une illustration de S1 et S2, voir Venner, 'Seals monastery Sint-Gerlach', 161-162 et 162.
Copie
Non disponible.
Edition
a. Nève, Les chartes échevinales du XIIIe siècle, 13-14 (avec traduction incomplète), n° 1262.01.23, d'après A.
Références
Doppler, 'Schepenbrieven Supplement', 80, no. 1805. - Haas, Liste chronologique, 52, n° 115. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 101, n° 444.
Dates
L'utilisation du style pascal dans le diocèse de Liège a été supposée, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII.
Origine
Cette charte a été rédigée par un scribe qui a mondé des chartes échevinales de Maastricht pour le couvent des Soeurs blanches de Maastricht datées de 1253 31 mars, 1255 28 octobre, 1256 27 février, 1260 29 juillet, 1262 24 novembre et 1266 13 janvier (voir Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D030, archives Klooster der Witte Vrouwen Maastricht, 1253-1796, inv. nº 30, 58, 38, 60, 61-1 et 32). 30, 58, 38, 60, 61-1 et 32), pour un prêtre de Maastricht daté du 6 septembre 1265 (voir Collection du chapitre de Saint-Servaas, n° 25), ainsi qu'une charte de Manegold, commandeur de l'ordre Teutonique à Malines, au profit du couvent des Sœurs blanches datée du 24 novembre 1262 (voir Ibidem, idem, accès n° 14.D030, archives Monastère des Sœurs blanches Maastricht, 1253-1796, inv. n° 61-2). Par conséquent, ce scripteur peut être situé dans le voisinage de la cour des échevins de Maastricht.


Numéro 23
Engelbert d'Isenburg, archidiacre du diocèse de Liège, informe Anselme, doyen du clergé de Susteren, qu'il a nommé Théobald, chanoine de Sint-Gerlach à Houthem, nouveau curé d'Oirsbeek en raison du décès de son prédécesseur Arnoud van Haren. Theobald a été proposé pour cette nomination par le prévôt et le couvent du monastère Sint-Gerlach. L'archidiacre Engelbert charge le doyen Anselm de mettre effectivement Théobald en possession de cette charge pastorale et de lui envoyer une confirmation écrite.
Engelbert d'Isenbourg, archidiacre de Liège, informe Anselme, doyen de Susteren, que, sur recommandation du prévôt et du couvent de Sint-Gerlach (à Houthem), patrons de l'église d'Oirsbeek, en raison du décès d'Arnoud van Haren, curé d'Oirsbeek, il a nommé Théobald, chanoine de Sint-Gerlach, curé de cette paroisse et qu'il le charge de mettre Théobald en possession effective de l'église.
Original
[A]. Non disponible.
Copies
[B]. 1376 25 janvier, non disponible, mais connu par C, charte de l'officialité de Liège et de l'archidiacre de la Campine, à [A]. - C. 25 janvier 1376, Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 173, reg. n° 71, copie certifiée par Albert Loze de 's-Hertogenbosch, notaire public et impérial, à la demande de l'officialité de Liège et de l'archidiacre de la Campine, deuxième charte, à [B] . - D. 1735, Maastricht, RHCL, access no. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, inv. no. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, p. 276-277, sous le titre : Institutio fratris Thibodonis, canonici regularis ecclesie sancti Gerlaci, ordinis Premonstratensis, et en marge : Num. 171, indiquant un point de scellement, à [A].
Edition
Non publié auparavant.
Références
Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV,22-23, nr. 18. - Haas, inventaire St. Gerlach, 74, reg. nr. 18.
Cohérence
Pour la donation du droit de patronage de l'église d'Oirsbeek au monastère Sint-Gerlach à Houthem, voir infra n° 22.
Edition de texte
En l'absence de l'original, le présent texte a été publié sur la base de la copie C, avec les variantes significatives de D dans les annotations.


Numéro 23
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn annoncent que Jean, prévôt, Gillis, doyen, archidiacre et le chapitre cathédral de Liège ont constaté que l'abbaye était grevée de nombreuses et lourdes dettes. Pour acquitter ces dettes, l'abbesse et le couvent, à l'instigation de Jean, de Gillis, de l'archidiacre et du chapitre cathédral, sur l'ordre de la communauté monastique et sur les conseils de Marsilius, Gundulf et Nicolaas de Welheim, prêtres, et de Koenraad, chanoine de Thorn, ont dressé un inventaire des biens et des revenus, avec lesquels les dettes ont été acquittées. Ils demandent à Jan, à Gillis, à l'archidiacre et au chapitre cathédral de Liège d'approuver ce partage des biens et des revenus.
Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn demandent au chapitre cathédral de Liège d'approuver le partage des biens monastiques, tel qu'il a été établi à la demande de Jean, prévôt, de Gillis, doyen, de l'archidiacre et du chapitre cathédral de Liège, ainsi qu'avec le consentement de Marsilius, Gundulf et Nicolas de Welheim, prêtres, et de Koenraad, chanoine de Thorn.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Rijksheerlijkheid de Thorn, inv. no 34. Très endommagé avec perte de texte.
Notes au verso : 1ode la main du XVIe siècle: Supplicatio ad capitulum Sancti Lamberti ut dignetur divisionem inter abbatissam et capitulum approbare, 1265. - 2ode la main du XVIIe siècle: S barré, Z.
Sceau : un sceau pendant, apposé, et non annoncé, à savoir S2 de Hildegonde, abbesse de Thorn, de cire blanche,très abîmé. Pour une description et une image de S2, voir Venner, "Seals Thorn", 33. Étant donné l'emplacement du sceau à l'extrême droite du parchemin, il est fort probable qu'un sceau ait également été apposé sur le côté gauche de l'original.
Dépenses
a. Franquinet, Inventaire révisé Thorn, 28-29, n° 18 (daté de 1265), d'après A. - b. Habets, Archives Thorn, 27, n° 34 (daté de 1265), d'après A et a.
Regest
Haas, Liste chronologique, 57, n° 131 (daté de 1265).
Dates
Nous supposons que le style pascal a été utilisé par les institutions cléricales du diocèse de Liège, voir Camps, ONB I, XXI, et Dillo et Van Synghel, ONB II, XVII.
Origine et cohérence
Cette charte a été mondée par un scriptor de l'abbaye de Thorn, qui a travaillé de 1262 à 1273. Pour localiser ce scripteur, voir ,Thorn no 17.
La présente charte renvoie à une charte de l'abbesse et du couvent de Thorn dans laquelle est effectuée la distribution des biens du monastère pour acquitter les dettes, voir Collection Thorn, n° 22.
Edition de texte
Certaines lacunes dans A ont été comblées selon a, lorsque ces passages étaient encore lisibles.


Numéro 23
Henri III, duc de Limbourg et margrave d'Arlon, proclame à plusieurs reprises l'acquisition de biens par Rutger, abbé de Kloosterrade.
Henri III, duc de Limbourg et margrave d'Arlon, proclame à plusieurs reprises l'acquisition de biens par Rutger, abbé de Kloosterrade.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 825.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 138-140, n° 63, d'après A.


Numéro 23
Dirk, abbé de Siegburg, informe Louis, doyen, et le chapitre de Saint-Servatius à Maastricht qu'ils reconnaissent que la dîme contestée des biens, appelée Manewerc, à Güls, ainsi que l'autre dîme de Güls, appartiennent au chapitre.
Dirk, abbé de Siegburg, informe Louis, doyen, et le chapitre de Saint-Servatius à Maastricht qu'ils reconnaissent que la dîme contestée des biens, appelée Manewerc, à Güls, ainsi que l'autre dîme de Güls, appartiennent au chapitre.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 339.
Notes au verso : 1o de la main du XVe siècle: De decima de Gulse. - 2o de la main du XVIe siècle: C/II. - 3o de la main du XVIIe siècle: Littera Theodorici, abbatis Siburgensis, quibus decimas de omnibus suis bonis prestandas recognosci / B II et 1263.
Sceau : une confirmation, probablement pour le sceau annoncé de Dirk, abbé de Siegburg (SD1).
Copie
Non disponible.
Dépenses
a. Wisplinghoff, Urkunden Siegburg, 256, n° 142, d'après A. - b. Hardt, Urkundenbuch Mittelrheinischen Territorien, 323-324, n° 469, d'après A.
Références
Doppler, " Collection ", 306-307, n° 173. - Haas, Liste chronologique, 54, n° 123. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 90, n° 339.
Cohérence
Pour la charte mentionnée dans le dispositio daté (1188 25 décembre - ) 1189 (23 septembre) concernant le litige sur la dîme de Güls entre le chapitre de Saint-Servaas et l'abbaye de Siegburg, voir Collection Saint-Servaas, n° 8.
Edition de texte
La distinction entre c et t est difficile à percevoir.


Numéro 24
Guillaume, gouverneur, et le couvent de Sint-Gerlach à Houthem déclarent qu'avec le consentement du doyen et du chapitre de l'église Saint Servatius à Maastricht, ils ont construit un mur autour de leur couvent dans la pleine propriété du chapitre. A cet effet, ils ont acquis, de cette pleine propriété, tant sous le mur qu'à l'intérieur de celui-ci, un acre de longueur et un acre de largeur du côté de Berg, dans la partie du mur située du côté de Berg. Pour cela, ils paieront un intérêt annuel héréditaire de deux pence à Berg à l'église de St Servatius le premier dimanche après la St André. Avec cette autorisation de libre possession, le prévôt et le couvent de Sint-Gerlach reconnaissent qu'ils n'ont pas acquis d'autres droits sur les biens de Saint Servatius.
Guillaume, prévôt, et le couvent de Sint-Gerlach (à Houthem) déclarent qu'avec le consentement du doyen et du chapitre de l'église Saint-Servais à Maastricht, ils ont construit un mur autour de leur couvent dans l'allodium du chapitre sur une pièce de terre de 100m de longueur et d'un "roede" en largeur du côté de Berg contre un intérêt annuel héréditaire de deux "penning" liégeois.
Original
[A]. Non disponible.
Copie
B. 1279 6 septembre, Maastricht, RHCL, accès n° 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 31, reg. n° 21, vidimus par le doyen et le chapitre de l'église St Servais à Maastricht, voir infra n° 25, à [A].
Edition
Non publié auparavant.
Regest
Non disponible.
Origine et cohérence
Cette charte a été promulguée en même temps que deux autres chartes concernant la construction du mur le même jour, voir infra nos 25 et 26.


Numéro 24
Henri, évêque d'Utrecht, en raison de la grande pauvreté de l'abbaye de Thorn, décide, après avoir consulté des juristes, que l'abbesse de Thorn - à qui appartient le droit de nomination et de désignation de l'église d'Avezaath - y nommera un curé dès que l'office sera vacant. L'ecclésiastique à nommer devra recevoir son ordination sacerdotale, renoncer volontairement à tout autre bénéfice et résider à Avezaath dans l'année qui suivra sa nomination. L'évêque dote le pasteur d'un bénéfice d'un sixième de la grande et de la petite dîme de Zoelen, des biens et des champs de l'église d'Avezaath, des dons et de toute nouvelle donation à l'église. Tous les autres revenus de l'église reviennent aux chanoines et aux sœurs du couvent de Thorn pour augmenter leurs prébendes en raison de leur pauvreté.
Henri, évêque d'Utrecht, décide que l'abbesse de Thorn, détenant le droit de patronage de l'église d'Avezaath, installera un curé avec l'approbation des chanoines et des moniales de Thorn, et Henri détermine également les revenus du curé.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 36.
Edition
a. Ketner, OSU III, 433-434, n° 1690, d'après A.


Numéro 24
Walram III, comte de Luxembourg et de La Roche et margrave d'Arlon, règle un litige entre l'abbaye de Kloosterrade et le chevalier Rutger de Beggendorf, l'abbaye rachetant la remise annuelle d'un manteau avec une somme de deux marks.
Walram III, comte de Luxembourg et de La Roche et margrave d'Arlon, règle un litige entre l'abbaye de Kloosterrade et le chevalier Rutger de Beggendorf, l'abbaye rachetant la rente annuelle d'une cappa avec une somme de deux marks.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 777.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 143-144, n° 65, d'après A.


Numéro 24
Louis, doyen, et le chapitre de Sint-Servaas à Maastricht intègrent Arnoud Nauta de Güls et son épouse Cristantia dans leur fraternité et leur donnent en usufruit à vie les vignobles de Güls, dont ils font don au chapitre.
Louis, doyen, et le chapitre de Sint-Servaas à Maastricht intègrent Arnoud Nauta de Güls et son épouse Cristantia dans leur fraternité et leur donnent en usufruit à vie les vignobles de Güls, dont ils font don au chapitre.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 340. Endommagé avec perte de texte.
Notes au verso : 1o de la main du XVe siècle: De Gulse. - 2o de la main du XVe siècle: P XIIII. - 3o de la main du XVIe siècle: B 12 et 1265. -4o de la main du XVIIe siècle: Littera donationis quorundam bonorum in Gulse.
Sceau : un point d'attache, vraisemblablement pour le sceau annoncé du Chapitre de Saint-Servatius à Maastricht (LS1).
Copie
Non disponible.
Edition
Non publié auparavant.
Références
Doppler, " Collection ", 307, n° 174. - Haas, Liste chronologique, 55-56, n° 127. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 90, n° 340.
Texte , édition
La distinction entre c et t est difficile à percevoir.


Numéro 25
Le doyen et le chapitre de l'église Saint Servatius de Maastricht déclarent avoir reçu une charte de l'administrateur et du couvent de Sint-Gerlach à Houthem, datée du 6 septembre 1279, et en reproduisent le texte. Cette charte concerne la construction d'un mur autour du couvent Sint-Gerlach.
Le doyen et le chapitre de l'église Saint Servaas à Maastricht valident une charte du prévôt et du couvent de Sint-Gerlach (à Houthem) datée du 6 septembre 1279, concernant la construction d'un mur autour du monastère Sint-Gerlach et confirment avoir reçu cette charte.
Original
A. Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.D003, archives monastère Sint-Gerlach à Houthem, n° d'inv. 31, n° de registre 21. Ligné.
Notes au verso : 1º par une main du dernier quart du XIVième siècle : H II. - 2' d'une main du XVième siècle : De quittatione allodii unius bonarii terre siti infra muros monasterii. - 3º Par une main du XVIIième siècle : 1279. - 4º d'une main du XVIIIième siècle: Num. 74.
Sceau : un sceau suspendu confirmé, qui a été annoncé, à savoir : le sceau S1 du chapitre de l'église Saint Servatius de Maastricht, en cire verte, endommagé. Pour une description et une image, voir Venner, 'Seals convent Sint-Gerlach', 155.
Copie
B. 1735 Maastricht, RHCL, accès n° 14.D003, archives couvent Sint-Gerlach à Houthem, inv. n° 1 (cartulaire), p. 120-121, sous la rubrique : Litere domini decani et capituli sancti Servatii Traiectensis de quittatione allodii unius bonnarii terre infra murum monasterii, et en marge : Num. 74, avec spécification d'un lieu de scellement, après A.
Edition
a. Hackeng, La propriété foncière médiévale, 320, n° 101, incomplet, d'après A.
Références
Franquinet, Inventaire raisonné St. Gerlach, IV, 24, nr. 20. - Haas, Inventaire St. Gerlach, 75, reg. nr. 21. - Idem, Liste chronologique, 73, reg. nr. 186.
Origine et cohérence
Cette charte a été émise en même temps que deux autres chartes le même jour, voir infra n° 24 et 26. L'écriture de cette charte se distingue fortement des autres chartes du fonds de Sint-Gerlach par l'utilisation du minuscule diplomatique avec des tiges extrêmement longues, une très grande interligne avec des intervalles supplémentaires entre les lignes 4 et 5 et 10 et 11, la grande initiale très décorée et la forme étrangement retournée. Une éventuelle localisation de ce scripteur dans le chapitre de Sint-Servaas s'est avérée impossible en raison du manque de matériel comparatif de cette période. Un seul original a survécu, daté de 1275.03.20 (Maastricht, RHCL, n° d'accès 14.B002A, chapitre des archives de Saint Servatius à Maastricht, 1062-1797, inv. n° 422), émis par le prévôt de Saint Servatius, et cette charte est écrite en italique gothique.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 25
Jean, prévôt, Gillis, doyen, l'archidiacre et le chapitre de la cathédrale de Liège rendent un jugement dans le litige opposant Willem van Buggenum, curé de Beek, aux chanoines de Thorn au sujet du prélèvement, de la perception et de la possession des grandes dîmes dans le territoire de l'église de Beek. Guillaume, estimant avoir le droit de percevoir l'intégralité des grandes dîmes à Beek, déclare que les chanoines perçoivent à tort les deux tiers de ces dîmes. Il demande donc que les chanoines de Thorn soient condamnés à lui restituer la valeur estimée de ces dîmes, qu'ils ont perçues illégalement, estime-t-il. Après les déclarations écrites et orales des deux parties, le prévôt, le doyen, l'archidiacre et le chapitre de la cathédrale de Liège ont rendu un jugement définitif en faveur des chanoines de Thorn.
John, prévôt, Gillis, doyen, l'archidiacre et le chapitre cathédral de Liège rendent un jugement dans le litige entre Willem van Buggenum, curé de Beek, et les chanoines de Thorn au sujet des grandes dîmes de Beek.
Original
A. Maastricht, HCL, numéro d'accès 01.187A, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. no. 37.
Notes au verso : 1ode la main du XVIe siècle: 1266. - 2o de la main du XVIIe siècle : Q. - 3ode la main du XVIIIe siècle: Maiores decimas de Beken. - 4o de la main du XVIIIe siècle : B.
Sceau : un sceau pendant apposé, non annoncé, à savoir : S1 du chapitre cathédral de Liège, en cire brune. Pour une description et une illustration de S1, voir Venner, 'Seals Thorn', 21-23.
Copies
B. première moitié du XVe siècle, Ibidem, n° d'accès 01.187B, archives Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. n° 1628 (anciennement cartularium n° 1) = Cartularium abbatiae imperialis Thorensis, 966-1600, pp. 57-58 (ancien fol. 33r-v), sous le titre : De decima de Beke, en marge C, à A. - C. XVIIIe siècle, Ibidem, n° d'accès 01.187B, archives Free State Lordship Thorn, inv. n° 1629 = Codex ou cartularium IV, 992-1762 (bande de transcriptions notariées abbaye de Thorn), p. 35-37, copie simple. - D. Ibidem, idem, p. 63, sous le titre : De decima de Beke, marge gauche : Copia N. 2, copie, avec mention du sceau, à A.
Edition
Non publié auparavant.
Références
Franquinet, Inventaire révisé Thorn, 30-31, no. 20. - Habets, Archives Thorn, 30-31, n° 20. - Haas, Liste chronologique, 58, n° 135.
Edition de texte
La distinction entre c et t n'est pas clairement visible.


Numéro 25
Coenraad, évêque de Porto et de Sainte-Rufina et légat du pape, prend sous sa protection l'abbaye de Kloosterrade avec tous ses biens et la confirme dans la possession des biens remis par Jutta et sa fille Margaret.
Coenraad, évêque de Porto et de Sainte-Rufina et légat du pape, prend sous sa protection l'abbaye de Kloosterrade avec tous ses biens et la confirme dans la possession des biens remis par Jutta et sa fille Margaret.
Original
A. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.D004, archives de l'abbaye de Kloosterrade, inv. n° 945.
Edition
a. Polak et Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 153-154, n° 72, d'après A.


Numéro 25
Les échevins de Maastricht ont donné à Dirk, moine de l'abbaye du Val-Dieu (à Aubel), avec le consentement de l'abbé et du couvent, leur maison et leur cour, qui appartenaient à Hendrik van Hagen, prêtre, et étaient situées sur le Vrijthof (à Maastricht), à Lambert supra Forum, prêtre, aussi longtemps qu'il vivra, et lui ont accordé un cijns annuel de douze shillings liégeois d'une autre maison sur le Vrijthof, dans laquelle Adam réside.
Les échevins de Maastricht ont donné à Dirk, moine de l'abbaye du Val-Dieu (à Aubel), avec le consentement de l'abbé et du couvent, leur maison et leur cour, qui appartenaient à Hendrik van Hagen, prêtre, et étaient situées sur le Vrijthof (à Maastricht), à Lambert supra Forum, prêtre, aussi longtemps qu'il vivra, et lui ont accordé un cijns annuel de douze shillings liégeois d'une autre maison sur le Vrijthof, dans laquelle Adam réside.
Originaux
A1. Maastricht, HCL, n° d'accès 14.B002A, archives Chapitre de Saint Servace de Maastricht, 1062-1797, inv. n° 445. Endommagé.
Notes au verso : 1o de la main du XIVe siècle: Lambertus, presbiter, recepit a domo VallisDeiquoad mortem suam unam domum inTraiectocoram scabinis Traiectensibus. - 2o de la main du XIVe siècle: Littera de domo Iohannis de Libra ? [***] Atrium. -3o de la main du 16e siècle: 1265. -4o de la main du 16e siècle: m 23.
Sceau : deux points d'attache, vraisemblablement pour les sceaux annoncés de Baudouin de Molendino et de Godfried, fils de Lady Osa, échevins de Maastricht (LS1 et LS2).
[A2]. non disponible, mais connu par la corroboratio de A1, copie pour l'abbaye du Val-Dieu.
Copie
Non disponible.
Edition
a. Nève, Les chartes échevinales du XIIIe siècle, 34-35 (avec traduction incomplète), n° 1265.09.06, à A1.
Références
Doppler, 'Schepenbrieven Supplement', 80-81, no. 1806. - Haas, Liste chronologique, 56, n° 130. - Nuyens, Inventaire de saint Servatius, 101, n° 445.
Origine
Cette charte a été rédigée par un scriptor qui frappe les chartes des échevins de Maastricht et peut être retrouvée dans l'environnement de la cour des échevins de Maastricht, voir Collection de Saint Servatius, n° 22.
Edition de texte
La distinction entre c et t est difficile à percevoir.
Il n'y a pas d'enregistrements dans notre base de données qui correspondent aux mots de recherche ou aux filtres que vous avez appliqués. Réinitialisez tous les filtres et réessayez.
partenaires




donateurs







.avif)









